Presque aucun des fidèles ne se retenait de s’esclaffer, et ils avaient l’air d’une bande d’anthropophages chez qui une blessure faite à un blanc a réveillé le goût du sang. Car l’instinct d’imitation et l’absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. Et tout le monde rit de quelqu’un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer dix ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C’est de la même façon que le peuple chasse ou acclame les rois. Marcel Proust
Au fond, je n’ai jamais cru en Fillon. (…) C’est Sarko que j’aime. C’est un bandit mais je l’aime. Il est comme moi : un affectif, un métèque. D’ailleurs, je ne l’ai jamais trahi, je lui racontais tout de mes discussions avec Fillon. (…) J’ai appuyé sur la gâchette. (…) À la fin, il m’a dit “T’as vu Robert : On l’a bien niqué.” Robert Bourgi
Ce n’est qu’au prix de beaucoup d’hypocrisie que l’on se voile la face sur la collusion entre certains juges et les médias. Les premiers livrent aux seconds des informations couvertes par le secret professionnel, ils reçoivent en contrepartie un soutien tactique de leur action par une promotion médiatique compréhensive de leur démarche. Il ne s’agit rien de moins que d’une instrumentalisation réciproque avec les dangers que cela comporte, chacun pouvant finalement être dupe de l’autre, et le citoyen des deux. Jean-Claude Magendie
L’habit ne fait pas le moine. Que @francoisfillon soit transparent sur ses frais, ses collaborateurs et Force Républicaine ! Rachida Dati (09.07.2014)
Si Fillon donne sa circo à NKM, ce sera la guerre, et, faites gaffe, j’ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne. Rachida Dati (18.01.2017)
Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d’autorité quand on n’est pas soi-même irréprochable. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? François Fillon (28.08.2016)
De nous, les Français attendent transparence et intégrité : pour rétablir ordre et confiance, l’exemple doit venir d’en haut. François Fillon (18.09.2016)
Lorsque j’ai été élue au Parlement européen en 2009, le MoDem avait exigé de moi qu’un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J’ai refusé en indiquant que cela me paraissait d’une part contraire aux règles européennes, et d’autre part illégal. Le MoDem n’a pas osé insister mais mes collègues ont été contraints de satisfaire à cette exigence. Corinne Lepage (2004)
Est-il normal qu’un parlementaire embauche un membre de sa famille ? C’est parfaitement légal en France, parfaitement illégal au niveau européen et c’est du reste la raison pour laquelle Marine Le Pen a rencontré des difficultés pour l’emploi de son compagnon Monsieur Alliot. C’est légal, est-ce éthique ? Le sujet dépasse bien évidemment François Fillon puisqu’il concernerait le cinquième des membres du Parlement. Pour autant, il semble bien que les Français n’acceptent plus cette forme de népotisme. Mais il est évident que François Fillon n’est pas dans un cas particulier même s’il était quelque peu choquant de l’entendre dire que le parlementaire faisait ce qu’il voulait de l’enveloppe qui lui était remise dans la mesure où il s’agit quand même de fonds publics. Il n’est probablement pas contestable que Pénélope Fillon ait soutenu son mari dans sa carrière politique. Pour autant, était-ce un travail d’attaché parlementaire et ce travail a-t-il été différent lorsque elle était rémunérée et lorsqu’elle ne l’était pas. Deux autres questions se posent : quel type de travail a-t-il été fait durant la période où Madame Fillon a été employée par le suppléant de son mari ; quel a été le travail fait pour la revue des deux mondes en dehors des deux notes de lecture dont il a été fait état. C’est à toutes ces questions qu’il faudra répondre très rapidement pour évacuer ou non la question juridique. Il n’en reste pas moins que les affirmations de Madame Fillon elle-même, les contradictions entre les déclarations de François Fillon et celles de ses soutiens dont Bernard Accoyer sur la présence de Madame Fillon au Parlement, les pressions qui auraient été exercées sur Christine Kelly qui doit être entendue aujourd’hui par les enquêteurs laissent une impression désagréable. Au-delà, c’est tout un mode de fonctionnement du monde politique qui est interpellé. Corinne Lepage (27.01.2017)
Je vois les incroyables conséquences de toutes ces affaires. La première, c’est que, évidemment, lorsque vous vous présentez avec un programme très dur devant les gens, en leur demandant des sacrifices et des efforts et qu’il se découvre que pour vous-même, vous n’avez pas les mêmes règles, les mêmes disciplines ou les mêmes exigences, ça rend extrêmement difficile ce programme. Ça, c’est la première chose. (…) Et puis, deuxième chose, il y a une idée que je combattrai sans cesse avec indignation, cette idée qu’on essaie de faire passer, c’est que tout le monde fait la même chose. Et je veux dire que ce n’est pas vrai ! Je veux dire qu’il y a en France des élus qui respectent les règles, des gens qui trouvent normal d’avoir la discipline élémentaire d’être simplement dans une démarche de bonne foi, et je trouve scandaleux et même infâme qu’on essaie de faire croire que tout le monde ferait la même chose. François Bayrou (26.02.2017)
J’ai accompagné François Fillon au Trocadéro car je pensais qu’il abandonnait. François Baroin
François pensait que c’était un bon moyen d’accompagner Fillon vers la sortie. Il estimait que plus on taperait sur Fillon, plus on le braquerait, c’est pour ça qu’il était là au Trocadéro ! Proche de François Baroin
En dépit d’une présentation arrangée et orientée à dessein, il n’est fait état de strictement aucune forme d’illégalité dans cet article. Par conséquent, il n’y a rien à commenter. Seule la loi doit primer, l’État de droit, rien que l’État de droit, pas un pseudo ordre moral. Proche de Richard Ferrand
Muriel Penicaud n’a pas contesté l’irrégularité (…) Maintenant il y a une enquête. Cette enquête doit permettre d’y voir clair. Je vous invite à attendre les résultats de l’enquête avant de montrer du doigt tel ou tel qui serait en responsabilité. Et je vous invite même à ne pas chercher à affaiblir tel ou tel (…) parce que vous avez raison, nous sommes dans un moment important pour la ministre du Travail. Christophe Castaner (porte-parole du gouvernement Philippe)
Garrido et Corbière vivent-ils indûment dans un HLM ? Les accusations portées à l’encontre du couple sont inexactes mais la défense de Raquel Garrido l’est également. Car de fait, ils vivent bien dans un HLM, depuis peu, même si ce n’était pas le cas au départ. (…) Le nouvel appartement, dans l’extrême est parisien, est un F4 d’un peu plus de 80 mètres carrés dans lequel le couple vit désormais avec trois enfants. Lors de l’emménagement en 2003, l’appartement est un logement «à loyer libre». Au début des années 2000, le parc immobilier des bailleurs sociaux parisiens compte environ 50 000 de ces logements particuliers. Pour y entrer, aucun plafond de ressource, ni de plafonnement des loyers similaire aux seuils en vigueur pour les HLM. Du coup, ces appartements sont en dessous des prix du marché, mais au-dessus des loyers HLM. Actuellement, le couple paye 1 230 euros (955 hors charges) pour 84 mètres carrés. En décembre 2007, Jean-Paul Bolufer, le directeur de cabinet de Christine Boutin (alors ministre du Logement), est épinglé pour son appartement, dans le Ve arrondissement de Paris, de 190 mètres carrés pour 1 200 euros par mois, soit à peine 6,30 euros du mètre carré. Il s’agit évidemment… d’un logement à loyer libre, loué par la même RIVP. Plusieurs élus sont dans la même situation. La municipalité socialiste de Paris demande alors aux ministres et parlementaires concernés de rendre leurs logements sociaux et annonce sa volonté de «reconventionner» ces logements, c’est-à-dire de les reverser au parc HLM. L’objectif : «créer» du logement social à moindres frais et «moraliser» le parc social. Ce que Raquel Garrido ne précise pas, c’est que l’immeuble où se situe l’appartement du couple fait partie de ceux qui ont été reconventionnés, nous indique une source de la RIVP. Plus précisément, le logement est depuis 2016 un prêt locatif à usage social (PLUS), le plus commun des HLM. Il s’agit de la catégorie intermédiaire, entre les PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), correspondant aux logements dits «très sociaux», et les PLS (prêt locatif social), sorte de HLM «de luxe». (…) Ce qui signifie que si le couple de porte-parole n’a pas intégré de logement social en 2003, il vit bien dans un HLM depuis environ un an, contrairement à ce qu’a affirmé Raquel Garrido. (…) le couple jouit aujourd’hui d’un loyer très en deçà des prix du marché, sans pour autant que leur situation n’apparaisse choquante à la RIVP. Celle-ci a en effet la possibilité de faire jouer l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 pour augmenter un loyer, si celui-ci est manifestement sous-estimé au regard des prix du marché. C’est l’extrêmité à laquelle la régie est arrivée concernant Jean-Pierre Chevènement : alors sénateur, il occupait un de leurs logements sociaux, un «bel appartement de 120 mètres carrés dans le quartier du Panthéon, pour 1 519 euros mensuels, un loyer qui s’élèverait dans le privé à 3 500 euros», comme nous l’écrivions en 2011. Compte tenu de son patrimoine immobilier par ailleurs important, la RIVP avait fait jouer l’article 17-2 et révisé son loyer à la hausse. Le fait que Garrido et Corbière ne soient pas visés par une telle démarche de la RIVP montre donc que leur situation, pour être avantageuse, n’est en rien comparable à celle de l’ancien maire de Belfort. Libération
C’est compliqué de trouver en deux semaines, mais oui, je vais habiter dans ma circonscription. Est-ce que ça aura lieu dans trois, quatre ou cinq mois, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si ce sera à Bagnolet ou à Montreuil, je ne sais pas si je vais acheter ou louer, et je je dois aussi négocier avec mes trois enfants… Mais je tiendrai parole. Alexis Corbière
Ce fut une très fructueuse opération pour chacun, une sorte de hold-up républicain dont le gras butin permit de rétribuer généreusement chacun des complices. (…) Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que la majorité macronienne, hors abstention, votes blancs et nuls, suffrages d’opposition et désormais votes modémistes est en réalité très faible dans le pays. Le soufflé En marche ne s’est pas pour le moment transformé en meringue solide et ce n’est pas la relation ambiguë qu’entretiennent Macron et son Premier ministre, Philippe, qui facilitera ce travail de densification. (…) Le divorce Macron-Bayrou n’est donc pas la fin d’un marché de dupes mais la manifestation d’une rapide clarification. Le problème est qu’on ne sait pas ce qu’elle clarifie vraiment, le macronisme étant l’expression d’un pouvoir personnel purement opportuniste, prêt à s’adapter sans souci de formes à toutes les circonstances, s’appuyant sur des élus ayant tous trahi leurs formations d’origine. Quand la réalité est volatile, l’extrême souplesse est un atout qui peut tourner à la confusion. Dans cette sarabande, Bayrou, désormais à nouveau dans l’opposition, va pouvoir retrouver son goût inné pour cette dernière. Ivan Rioufol
L’affaire Richard Ferrand, sortie par Le Canard Enchaîné dans son édition du 24 mai, aurait pu être révélée par l’AFP. Des journalistes de l’Agence étaient en effet en possession des informations, mais la rédaction en chef France n’a pas jugé le sujet digne d’intérêt. Qu’un possible scoop sur une affaire politico-financière impliquant le numéro deux du nouveau parti au pouvoir ne soit pas jugé intéressant, voilà qui est troublant. Surtout après les affaires Fillon et Le Roux qui ont émaillé la campagne présidentielle, et alors que le nouveau président Emmanuel Macron affirme vouloir moraliser la vie politique. Généralement, un média met les bouchées doubles pour enquêter sur ce type d’informations quand elles se présentent. Pas à l’AFP, où les courriels de journalistes adressés à la rédaction-en-chef France soit sont restés sans réponse, soit ont reçu une réponse peu encourageante. Faute d’avoir pu donner l’affaire Ferrand en premier, ces mêmes journalistes de l’AFP ont eu la possibilité de sortir un nouveau scoop deux jours après l’article du Canard : le témoignage exclusif de l’avocat qui était au coeur de la vente de l’immeuble litigieux des Mutuelles de Bretagne en 2010-11. Mais avant même qu’une dépêche ait été écrite, la rédaction en chef France a refusé le sujet. C’était pourtant la première fois qu’une source impliquée dans le dossier confirmait les informations du Canard et pointait la possibilité d’une infraction pénale de M. Ferrand. L’AFP se contentera, quelques jours plus tard, de mentionner d’une phrase le témoignage de l’avocat interviewé par Le Parisien. Ce même témoignage qui conduira à l’ouverture d’une enquête par le parquet de Brest…. Ce n’est pas tout : avant l’affaire Ferrand, le 17 mai, juste après la nomination du nouveau gouvernement, une dépêche annonce que François Bayrou, nouveau garde des Sceaux, devra lui-même faire face à des juges, dès le 19 mai, après son renvoi en correctionnelle pour diffamation. Mais la dépêche n’a pas été diffusée, la rédaction en chef France trouvant son intérêt « trop limité ». Deux jours plus tard, l’info sera en bonne place dans les médias nationaux. L’AFP décidera alors de la reprendre ! Interrogée jeudi par les syndicats lors de la réunion mensuelle des délégués du personnel, la direction de l’information de l’AFP s’est montrée incapable de justifier de manière argumentée les choix de sa rédaction en chef. Tout cela fait beaucoup d’infos sensibles étouffées en quelques jours. Pour ceux qui ont travaillé sur le dossier, il y a de quoi être écoeuré et découragé. L’Agence France Presse, l’une des trois grandes agences d’informations mondiales, dont le statut rappelle l’indépendance, a-t-elle peur de diffuser des informations sensibles quand celles-ci risquent de nuire au nouveau pouvoir politique élu ? Le SNJ-CGT appelle la direction et la rédaction en chef de l’AFP à s’expliquer sur le traitement incompréhensible de l’affaire Ferrand. SNJ-CGT AFP
Richard Ferrand est à nouveau visé par des révélations du Canard enchaîné. Contrairement à ce qu’il affirmait quand François Fillon était sous le feu des critiques, le député et nouveau patron de la République en marche à l’Assemblée nationale estime qu’il ne doit pas subir le tempo du tribunal médiatique… Il n’envisage donc aucune démission. L’hebdomadaire satirique évoque pourtant cette semaine les faveurs accordées par l’ancien socialiste à sa compagne, Sandrine Doucen. En 2000, elle est embauchée aux Mutuelles de Bretagne, dont il est alors le patron. Elle devient, à 25 ans et encore étudiante en droit, directrice du personnel. Elle complète aussi ses revenus par un “petit job” au château de Trévarez, un domaine qui appartient au département du Finistère. Il est géré par un comité d’animation, lui-même présidé par le conseiller général… Ferrand. En 2004, elle quitte son emploi aux mutuelles de Bretagne, ayant terminé ses études pour devenir avocat. Elle a, pendant ce laps de temps, touché 80 000 euros. “Financée par les mutualistes et les contribuables locaux”… Valeurs actuelles
Je n’ai pas énoncé que la destitution de Bachar al-Assad était un préalable à tout. Car personne ne m’a présenté son successeur légitime ! Mes lignes sont claires. Un : la lutte absolue contre tous les groupes terroristes. Ce sont eux, nos ennemis. […] Nous avons besoin de la coopération de tous pour les éradiquer, en particulier de la Russie. Deux : la stabilité de la Syrie, car je ne veux pas d’un État failli. L’utilisation d’armes chimiques donnera lieu à des répliques, y compris de la France seule. Emmanuel Macron
Un jour, je parlerai, mais c’est trop tôt. J’ai envie de savoir d’où c’est venu et comment ça s’est passé. François Fillon
François Fillon (…) reste taraudé par cette unique question : qui a déclenché, voire orchestré les affaires qui ont ruiné son image, puis ses chances? Pour lui, c’est certain, quelqu’un « a guidé la main » de ses accusateurs… Dans sa tête tournent et retournent trois hypothèses : « Le pouvoir ; quelqu’un de mon camp ; un autre personnage extérieur à la politique [dont il ne veut pas dire le nom]. (…) Tout a commencé par un tête à tête dans un restaurant parisien. François Fillon et Anne Méaux, dirigeante de l’agence de communication Image 7, dînent au calme pour préparer la primaire. Anne Méaux, qui s’apprête à superviser la com de la campagne, dit avoir « posé la question franchement » : « François, est-ce qu’il y a des choses que je dois savoir? » L’interrogation est abrupte, bien dans le style de cette femme d’affaires coriace et avisée, experte en gestion de crise, toujours l’air mal réveillé et le portable jamais très loin de l’oreille, dont la réputation est de parler cash à ses clients, les grands patrons comme les politiques. Ce qu’elle demande ce soir-là, c’est si François Fillon a des casseroles. Comme un dernier check avant le décollage. Elle n’a pas oublié la réponse : « Sans la moindre hésitation, il m’a dit : ‘Non Anne, il n’y a rien.’ » Avec le recul de la défaite et l’avalanche des révélations qui ont piégé son champion, Anne Méaux reste persuadée qu’il était sincère : « Fillon est quelqu’un d’honnête. » (…) « François a voulu gagner du temps, il misait sur le fait que l’affaire n’allait pas prendre », raconte un membre de l’équipe, persuadé qu’il aurait fallu au contraire s’excuser au plus vite, voire promettre de rembourser pour tenter de tuer l’affaire dans l’œuf… Anne Méaux, en déplacement, assure n’avoir appris les accusations contre Penelope Fillon que ce soir-là. De retour le lendemain, elle va s’investir à fond dans la gestion de crise de la campagne. (…) Elle assure avoir été interloquée en entendant le candidat promettre qu’il renoncerait en cas de mise en examen. « C’était une improvisation totale, dit-elle. En sortant, je lui demandé pourquoi il avait dit cela. Il m’a simplement répondu : ‘Mais Anne, parce que je ne serai jamais mis en examen.’ » À sa décharge, la plupart des avocats discrètement consultés pronostiquaient alors que Fillon était à l’abri de toute poursuite… Au QG aussi, dans le bureau du directeur de campagne, le staff est stupéfait. Seul Stefanini, devant sa télé, trouve l’improvisation géniale. « Plus personne n’osera le mettre en examen maintenant! » prédit-il à chaud. Mais le « Penelopegate » est désormais un feuilleton judiciaire. « C’est vite devenu une campagne impossible », se souvient Thierry Solère. Les sondages plongent. À chaque déplacement, le candidat est attendu par des militants de gauche armés de casseroles. « J’ai vu François avoir peur physiquement », raconte un élu. « On a multiplié des visites sécurisées, se rappelle un membre de l’équipe. En février, l’agenda s’est vidé. » Au fil des semaines, les avocats du couple Fillon, Antonin Lévy et Pierre Cornut-Gentille, comprennent que l’affaire ne sera pas classée. Le 17 février dans Le Figaro, le candidat martèle qu’il ira « jusqu’à la victoire » quoi qu’il arrive, signe qu’il n’exclut plus une mise en examen. Plus qu’un revirement, une volte-face. Le bateau tangue. La campagne s’enfonce. « Il fallait déminer un truc par jour, y compris mille choses fausses, peste Anne Méaux. On m’a appelée pour savoir si j’avais prêté 50.000 euros à Fillon! » Le candidat, lui, semble sur un chemin de croix. « François tenait bon, mais il était anéanti par ce qu’il faisait vivre à sa famille, se remémore la conseillère. Je l’ai vu avoir envie de tout arrêter à plusieurs reprises, pour que leur cauchemar à eux s’arrête. Dans ces moments de doute, il disait : si je lâche, je suis lâche. » D’où l’idée de recaler la stratégie de com : « On a insisté sur son courage, cela pouvait devenir une force. » (…) « Tous les éléments de l’affaire judiciaire étaient sur la table, on s’était expliqué sur tout, martèle Anne Méaux. On allait pouvoir reparler du programme, le plus dur était derrière nous. Mais le dimanche suivant, il y a eu les costumes… » Elle refuse d’entrer dans les détails de cette matinée, où elle fut interrogée sur le chèque de 13.000 euros signé le 20 février par un « ami donateur » pour offrir deux costumes sur mesure à François Fillon. A-t-elle cru, sur le moment, à une nouvelle « fake news »? Probable. Elle appelle aussitôt Fillon qui, contre toute attente, confirme l’épisode et lui révèle le nom du donateur : Robert Bourgi, l’intrigant avocat des réseaux franco-africains. (…) avec la révélation sur les costumes, elle s’est mise à douter à son tour de la suite – même si elle dit avoir cru jusqu’au bout à un miracle dans les urnes. « Son score de 20%, c’est quand même mieux que celui de Chirac en 2002, plaide-t-elle à présent. C’était jouable. » « Aujourd’hui encore, je ne sais pas ce qu’il fallait faire », confie François Fillon. Le perdant de mai a regardé les législatives de juin « de l’extérieur, en spectateur ». Il assure avoir « tourné la page ». Il continue de jongler à l’infini avec ses « trois hypothèses » et espère bien connaître un jour le nom de celui qui, en lançant le « Penelopegate », l’a empêché de devenir président. JDD
Ce fut le coup de grâce, comme le pensent les proches du candidat déchu. « Les costumes nous ont tués », dit sa communicante Anne Méaux quelques jours après le premier tour de l’élection présidentielle. Sans eux, la campagne eut sans doute été différente ; Fillon commençait à surmonter le « Penelopegate » quand, le 11 mars, Le Journal du dimanche a révélé l’existence de ces mystérieux cadeaux à plus de 40 000 euros. « Qui a payé les costumes de François Fillon ? » titrait alors le journal sans révéler l’identité du bienfaiteur. Il a fallu quatre jours à peine pour que Robert Bourgi, 72 ans, « Bob » pour les intimes, entre en scène. Son nom est sorti dans la presse, toujours associé aux mêmes termes – « Françafrique », « porteur de valises », « intermédiaire sulfureux » – tel un secret d’initiés, sans que l’on sache qui est réellement cet homme. Personne n’a cherché à comprendre quels liens réels l’unissent à François Fillon. Comment ce sphinx enrichi sous le soleil des Bongo, ce « bourricot », comme il s’appelle lui-même, roi de la diplomatie parallèle adoubé par Sarkozy, a-t-il pu approcher de si près le candidat de la droite ? (…) Fillon prend le large, Bob se sent méprisé. Alors il dégaine. Et il l’avoue aujourd’hui sans gêne, lové dans son cashmere bleu ciel : « J’ai appuyé sur la gâchette. » Samedi 11 mars 2017, Anne Méaux appelle François Fillon sur son portable. « Est-ce qu’il y a quelqu’un qui t’a offert des costumes ? Un mec un peu bizarre, paraît-il… » Le JDD, sous la plume de Laurent Valdiguié, s’apprête à sortir l’affaire le lendemain, sans révéler le nom de l’avocat, à sa demande. « Merde… Bourgi », lâche Fillon. Sa communicante est effondrée, le « Penelopegate » n’était donc qu’un zakouski. (…) deux costumes ont été payés par chèque pour un montant de 13 000 euros. Étrange… D’habitude, il règle en liquide. Le nom de Bourgi circule dans les rédactions – de nombreux journalistes connaissent ses largesses. L’avocat leur susurrait d’ailleurs depuis quelques semaines : « Quand même, ce Fillon, il est gourmand, il a des goûts de luxe… » Un premier Tweet évoque son nom avant que Le Monde confirme. (…) Puis, après avoir annoncé sa décision de rendre les costumes, Fillon le traite sur BFM d’« homme âgé qui n’a plus aucune espèce de responsabilité ». « Tu m’as traité de vieux ? Là, tu as franchi la ligne jaune, gronde Bob au téléphone. Tu n’aurais pas dû, tu as fait pleurer ma petite Clémence. Je ne te le pardonnerai jamais. » Le supplice chinois n’en finit pas, alors que le premier tour de la présidentielle approche. Sur RTL et Mediapart, Bourgi cogne encore, prétendant que Fillon n’a pas rendu les costumes. (…) Quelques jours après la défaite de François Fillon au pre mier tour, Robert Bourgi va déjeuner rue de Miromesnil, dans les bureaux de Nicolas Sarkozy. (…) Bourgi le salue puis tombe dans les bras de Sarkozy. Ils ont mille choses à se dire ; la droite est à terre, la gauche en miettes, un jeune de 39 ans va entrer à l’Élysée, voilà de quoi réfléchir à l’avenir. (…) À la fin, il m’a dit “T’as vu Robert : On l’a bien niqué.” » Bob a ri puis il est reparti, le cœur un peu lourd. Si Fillon l’avait écouté, pense-t-il ; s’il l’avait surtout bien traité, l’histoire aurait peut-être été différente. Sur le chemin, une nouvelle fois, Bourgi a essayé d’appeler l’ami auquel il voulait du bien. Sophie des Déserts
Vous avez dit collusion ?
Alors qu’avec la démission de déjà quatre ministres en trois jours dont celui de la Justice …
Et la reprise, une fois l’élection passée, du feuilleton des affaires concernant une nouvelle ministre …
Que – l’on croit rêver – le porte-parole vient d’enjoindre la presse de ménager …
Pendant que du côté de l’opposition républicaine et entre deux passages au camp de l’adversaire, le dézingage a repris de plus belle contre leur ancien candidat …
Et que l’on apprend, sur fond d’obamisation rampante d’une présidence de plus en plus versaillaise et désormais pro-russe …
Comment l’AFP étouffe les informations gênantes pour le nouveau pouvoir …
Que leurs homologues américains inventent …
Comment ne pas voir…
Avec le peu d’intérêt qu’a soulevé le long portrait, pourtant particulièrement révélateur, que vient de consacrer Vanity Fair à Robert Bourgi …
La confirmation, via l’assassinat politique du seul véritable adversaire de l’actuel président puis le classique barrrage au FN, du hold up électoral que l’on vient de vivre …
Où, dépité du rôle de conseiller Afrique espéré après l’échec à la primaire de son ami Sarkozy puis la soudaine prise de distance de son vainqueur Fillon …
L’ancien et sulfureux avocat de la Françafrique avait …
Avec l’affaire des costumes et la complicité active des médias et des juges comme de ses prétendus amis …
Porté le coup de grâce au candidat de la droite et du centre …
Qui sûr de son bon droit avait certes bien imprudemment lancé les hostilités …
Mais commençait justement à surmonter le « Penelopegate » ?
My tailor is rich
Robert Bourgi a offert au candidat des Républicains les fameux costumes qui ont précipité sa chute. Puis il est retourné en coulisses. Qui est cet étrange bienfaiteur ? À quel jeu joue-t-il ? A-t-il agi dans l’ombre de son vieil ami Nicolas Sarkozy ?
Sophie des Déserts l’a écouté et mené l’enquête pour démêler l’écheveau de sa vérité.
Sophie des Déserts
Vanity Fair
Juillet 2017
L’ami Fillon ne répond plus. Ces premiers jours de mai, il a encore tenté de le joindre mais rien, toujours cette messagerie pénible au bout du fil et le muguet fané dans son bureau parisien de l’avenue Pierre-I er -de-Serbie. « François est aux abonnés absents, se désole Robert Bourgi en cet après-midi pluvieux. Il a disparu, personne ne sait où il est. » La voix se traîne, onctueuse dans un parfum d’encens « rapporté de La Mecque », précise-t-il, soucieux des détails. Café serré, verbe délié, il suggère le tutoiement. L’air est un peu lourd dans cette pièce sans lumière chargée d’un demi-siècle de souvenirs : statues, bibelots, grigris d’Afrique et peintures d’Orient, photos des enfants et des présidents sur la cheminée – Jacques Chirac en bras de chemise vintage avec Bernadette, Nicolas Sarkozy tout sourire. Bourgi s’enfonce dans son fauteuil, poupon repu prêt à faire la sieste. Ses doigts caressent le tissu de sa veste. « C’est du Arnys, note-t-il, lèvres joueuses. Tout… même mes chaussettes. » Bourgi répète à l’envi le nom de l’enseigne luxueuse désormais célèbre jusque dans les campagnes françaises, la griffe des fameux costumes qu’il a offerts à François Fillon.
Ce fut le coup de grâce, comme le pensent les proches du candidat déchu. « Les costumes nous ont tués », dit sa communicante Anne Méaux quelques jours après le premier tour de l’élection présidentielle. Sans eux, la campagne eut sans doute été différente ; Fillon commençait à surmonter le « Penelopegate » quand, le 11 mars, Le Journal du dimanche a révélé l’existence de ces mystérieux cadeaux à plus de 40 000 euros. « Qui a payé les costumes de François Fillon ? » titrait alors le journal sans révéler l’identité du bienfaiteur. Il a fallu quatre jours à peine pour que Robert Bourgi, 72 ans, « Bob » pour les intimes, entre en scène. Son nom est sorti dans la presse, toujours associé aux mêmes termes – « Françafrique », « porteur de valises », « intermédiaire sulfureux » – tel un secret d’initiés, sans que l’on sache qui est réellement cet homme. Personne n’a cherché à comprendre quels liens réels l’unissent à François Fillon. Comment ce sphinx enrichi sous le soleil des Bongo, ce « bourricot », comme il s’appelle lui-même, roi de la diplomatie parallèle adoubé par Sarkozy, a-t-il pu approcher de si près le candidat de la droite ?
« Toi, tu ne connais pas Robert Bourgi », m’a-t-il dit d’un rire gourmand lors de notre première rencontre. Il y en aura cinq autres, dans ce bureau où son épouse avocate, Catherine, passait quelquefois une tête timide avant de se faire rabrouer. Il faut écouter longuement Bourgi pour comprendre, digérer toutes ces anecdotes romanesques qu’il balance sans filet, tenter de les recouper et aussi interroger ceux, nombreux, qui ont croisé sa route sinueuse – diplomates, journalistes, politiques. L’un d’entre eux m’a soufflé un soir : « Méfiez-vous, Robert Bourgi, c’est de la nitroglycérine. »
Il a charmé Fillon au volant d’une Aston Martin. Ce printemps 2008, Bob fait chanter le moteur V12 biturbo de son bolide dans la cour de Matignon. Le premier ministre vient l’accueillir : « Décidément, tu ne te refuses rien… » Berluti aux pieds, Bourgi soulève le capot, s’incline fièrement. Qu’il est heureux de ce déjeuner de retrouvailles. « Sacré François », il n’a pas tellement changé depuis leur rencontre en 1980 : toujours ce petit côté province, un peu envieux, un peu raide. Bourgi retrouve le « beau garçon timide » qu’il était, jeune attaché parlementaire au côté de son député, Joël Le Theule, l’élu de la Sarthe devenu ministre de la défense. À l’époque, Bourgi aussi se tenait bien sage dans l’ombre de Jacques Foccart. « Le Doyen », comme il l’appelait, grand manitou de la Françafrique, l’introduisait alors dans les cercles du pouvoir, par fidélité à son père, Mahmoud Bourgi, un riche commerçant libanais chiite installé au Sénégal qui fut l’un de ses correspondants.
Robert, né Hassan avant d’être francisé par les bonnes sœurs de Dakar comme son frère jumeau, décédé si vite, a fait des études de droit, une thèse remarquée sur « De Gaulle et l’Afrique noire ». En ce début des années 1980, Foccart le présentait alors aux dirigeants français et africains, dont Omar Bongo, le président de ce Gabon rempli de pétrole et d’uranium, si stratégique pour la France et si prodigue pour le RPR (le Rassemblement pour la République, dissous dans l’UMP en 2002, lui-même rebaptisé Les Républicains en 2015). C’était le bon vieux temps. Bourgi se pose depuis toujours en héritier du Doyen. Tant pis si son maître ne lui a donné aucun rôle officiel (hormis un poste de conseiller en 1986 au ministère de la coopération), ni même quelques lignes dans ses Mémoires. Tant pis si Bourgi, devenu avocat en 1992, a finalement surtout servi les potentats africains, Omar Bongo, bien sûr, son généreux « Papa » qui l’a couvert d’or durant trente ans, mais aussi Denis Sassou-Nguesso (président du Congo), Abdoulaye Wade (Sénégal), Blaise Compaoré (Burkina Faso), Laurent Gbagbo (Côte d’Ivoire)… Dieu sait qu’il a fallu œuvrer pour les contenter tous, gérer les commissions, les fonds secrets, les opposants, les journalistes, les maîtresses, les enfants cachés… Mais enfin, de là à prétendre servir la France, en fils autoproclamé de Foccart ! Bourgi ne craint rien puisque le vieux gaulliste n’a pas eu de descendance. Et puis quand Parkinson a rongé le Doyen, quand il n’y avait plus personne, Bob, lui, était là. Il débarquait avec son grand rire et ses boîtes de caviar Beluga. Les dernières confidences, les vrais, jure-t-il, ont été pour lui.
Devant Fillon, en ce printemps 2008, Bourgi se souvient : « Foccart t’aimait beaucoup, il disait que tu irais loin… Il avait donc raison. Moi- même, je suis impressionné par ta vaste connaissance du monde, de l’Orient, de l’Afrique. » Il sait y faire. C’est son métier, depuis trois décennies, en français, en arabe, en wolof, sur les deux rives de la Méditerranée, Bob murmure à l’oreille des puissants.
Sa question revient toujours : « Alors, comment ça va avec Sarko ? » demande Bourgi quand il voit Fillon. Le premier ministre souffre, il l’avoue ; il se plaint du mépris du président de la République, de son ingérence, de Guéant qui occupe l’espace médiatique. Bob compatit, propose de plaider sa cause. Il est proche de « Nicolas ». Fillon le sait sans imaginer à quel point. Bourgi a rallié Sarkozy dès 2005, après avoir tant « aimé », selon ses propres termes, son meilleur ennemi, Dominique de Villepin. À l’époque, cela s’est fait sans bruit. Bourgi racontera plus tard s’être senti méprisé par le premier ministre de Chirac, qui l’écartait à l’ap – proche de la présidentielle. Blessure, coup de poignard, comme un étrange avant-goût de l’histoire Fillon… Difficile de savoir ce qui s’est vraiment passé dans ces années. Avec Bob, la vérité est souvent complexe. « En réalité, Robert Bourgi a changé de cheval quand il a réalisé que Villepin, malmené à Matignon après le CPE [contrat première embauche], était grillé, affirme Michel de Bonnecorse, ancien conseiller Afrique de Chi – rac. Alors, il est parti avec armes et bagages chez Sarkozy. » Sa proximité avec les chefs d’État africains fut alors aussi précieuse que sa connaissance intime de Villepin.
« Sarko a compris qu’il valait mieux avoir Bob avec lui, pas seulement parce qu’il a une bonne capacité de nuisance et quelques facilités à rapporter des valises de billets… » glisse un proche des deux hommes. Deux ans avant la présidentielle de 2007, Bourgi a intégré le premier cercle des donateurs de Nicolas Sarkozy et fêté son investiture par l’UMP au côté de la fille d’Omar Bongo et de son ministre des finances. Il est à l’Élysée, au premier rang, le jour de la passation de pouvoir. Et quelques mois plus tard, « Nicolas » lui remet la légion d’honneur. Gloire à Bourgi, devant un parterre de hauts dignitaires africains, sa femme Catherine, leurs grands enfants et la petite dernière, Clémence, née d’un amour foudroyant dont il parle à tous avec émotion. « Cher Robert, tu sais que la passion tourmente, le taquine Sarkozy en louant son infatigable combat pour les relations franco-africaines. Cette distinction, porte-la. Porte-la pour moi et pour la France. » Bourgi ne s’en prive pas, la médaille marque tous ses costumes. Les hommes du quai d’Orsay et de la DGSE peuvent bien continuer d’écrire sur lui des notes appelant à la prudence, il s’en moque.
« Robert Bourgi s’est véritablement épanoui en Sarkozie, rappelle le journaliste Antoine Glaser, co- auteur de l’excellent Sarko en Afrique (Plon, 2008). Soudain, il ne passait plus par les petites portes, il agissait désormais au grand jour. » Tout lui est permis : garer sa Maserati dans la cour de l’Élysée, couvrir de parfums et de chocolats les secrétaires, narguer la cellule diplomatique, manœuvrer avec Claude Guéant au Bristol, imposer une rencontre avec Gbagbo et même demander la tête du secrétaire d’État à la coopération, Jean-Marie Bockel. Requête d’Omar Bongo, plaide Bourgi en mars 2008. Apparemment, le vieux président gabonais n’en pouvait plus d’entendre un sous-ministre promettre la fin « de la Françafrique moribonde ». Sarkozy renvoie Bockel. Le soir même, dans un palace, Bourgi sable le champagne avec le nouveau secrétaire d’État, Alain Joyandet, qu’il passe à Bongo par téléphone. Cadeau pour « Papa » qui, du temps de sa splendeur, faisait défiler les politiques français dans sa suite du Meurice, avec quelques petites offrandes. Bourgi suggère aussi à Joyandet d’aller s’incliner à Libreville, au bras de Claude Guéant ; lui précède le convoi, comme il le fait toujours, dans un avion privé avec une journaliste de Canal +. Alain Joyandet ne conteste pas cet épisode. Claude Guéant peine à retenir un sourire en se remémorant ce moment. « Bourgi a de la ressource et de l’orgueil aussi, derrière son côté bateleur, analyse-t-il, mine radieuse dans ses bureaux de l’avenue George-V. On ne peut pas toujours se contenter des canaux officiels, vous savez… Il m’a toujours été très utile, par ses analyses, sa connaissance charnelle de l’Afrique. »
L’affaire Bockel a été gérée en dehors de Matignon. Une fois encore, Fillon a regardé passer les trains. Bob s’en désole lors de leurs déjeuners : « Je sais, Nicolas te traite injustement. Il veut toute la lumière. Moi, je sens que tu as endossé le costume du premier ministre, tu prends de l’épaisseur. » À mesure que le quin quennat avance, les mots de Bourgi deviennent plus doux encore. Son influence fléchit avec la mort de Bongo, le départ de Guéant à Beauvau, l’arrivée de Juppé au quai d’Orsay. Bourgi a besoin d’appui pour rester dans le jeu. Fillon le voit de plus en plus souvent. À Matignon, certains conseillers s’en inquiètent. L’un d’eux se souvient lui avoir demandé : « Comment peux-tu être copain avec cette canaille de Bourgi ? » Le premier ministre s’est agacé : « Pourquoi dis-tu ça ? C’est mon ami, il est sympa, c’est un type fiable et une mine de renseignements. »
Une vieille connaissance de Sablé-sur-Sarthe, le journaliste Pierre Péan avec qui Fillon discute régulièrement, l’utilise d’ailleurs comme informateur. Grâce à Bourgi, il a révélé l’affairisme de Kouchner et ses fameux rapports sur le système de santé gabonais grassement payés par Bongo (Le Monde selon K., Fayard 2009). Bob le nourrit pour un autre ouvrage au titre prometteur : La République des mallettes. Blagues coquines au Fouquet’s S eptembre 2011, Bourgi a frappé. Seul, avant même la sortie du livre. Il lâche la bombe dans Le JDD – déjà – avec cette citation en « une » : « J’ai vu Chirac et Villepin compter les billets. » L’interview est signée Laurent Valdiguié, le journaliste qui lancera l’affaire des costumes. Bob se fait plaisir et raconte tout, comme dans un « SAS » : les noms de code utilisés pour communiquer (« Mamadou » pour Villepin, « Chambrier » pour lui) ; les djembés dans lesquels circulaient les billets de Blaise Compaoré avant la campagne de 2002 ; les valises de cash expédiées par Mobutu, Bongo, Wade…
Le système a pris fin avec Sarkozy, insiste l’avocat. Selon lui, une dizaine de millions de dollars auraient ainsi été remis à Villepin, sans compter les cadeaux, masques africains, manuscrits, buste napoléonien… Bourgi n’a pas de preuve, les faits sont prescrits, Mobutu et Bongo, morts. Wade menace de porter plainte. Mais il ne le fait pas, Villepin non plus, étrangement (seul Jean-Marie Le Pen, cité ultérieurement dans la liste des bénéficiaires, a attaqué Bourgi en diffamation et gagné). Pourquoi ? L’ancien premier ministre de Chirac a fini par me répondre, entre deux avions, indigné que ce silence judiciaire puisse être interprété comme un aveu. Il ne veut pas être cité, surtout ne pas rallumer les vieilles histoires, mais il a toujours pensé que « Robert » avait été téléguidé par le camp Sarkozy pour tuer sa candidature à la présidentielle de 2012. On rap – porte cette hypothèse à Bourgi mi-mai, devant quelques chouquettes. « Tout ça n’est pas entièrement faux… » soupire-t-il. Puis, après quelques bouffées de cigare : « À l’époque, j’ai quand même fait la “une” du Monde, souviens-toi du titre : “Les déclarations qui ont fait trembler la République”. »
Après ça, Robert Bourgi a décidé d’écrire ses Mémoires. Il a du temps, la Hollandie l’a écarté du pouvoir ; ses tentatives d’approche du nouveau président par quelques déjeuners – avec le secrétaire d’État chargé de la francophonie, Jean-Marie Le Guen, notamment – sont restées vaines. En 2013, Bourgi réunit alors ses souvenirs et quelques documents soigneusement cachés en Corse, la terre de sa femme, et à Beyrouth. Devant la vierge en bois du XVIII e siècle, cadeau de Foccart, le Coran à portée de main, il se confesse à Laurent Valdiguié. Un contrat d’éditeur est signé chez Robert Laffont, plus de 400 pages alléchantes dans lesquelles il raconte les petits arrangements de la classe politique, en incluant quelques amis sarkozystes. Il dit alors qu’il veut se laver, apaiser sa conscience. Son épouse est heureuse : elle le croit rangé des voitures. Qu’elle est douce, la vie loin du pouvoir.
François Fillon aussi souffle, il répond vite quand Bob l’appelle. Les deux amis vont déjeuner dans leurs luxueuses cantines, au Flandrin, au George-V, au Ritz ou au Fouquet’s, « sur la terrasse, pour regarder passer les filles », précise Bourgi. Fillon n’embraie pas sur ses blagues coquines, Villepin et Sarko étaient plus drôles. Mais au fil du temps, tout de même, le Sarthois se déride. Il aime la bouffe, les bons vins, surtout le Saint-Julien. Il sait apprécier les jolies choses. Les vestes forestières de Robert lui ont tapé dans l’œil. « Tiens, remarque Fillon. Ça vient de chez Arnys », belle maison mais devenue si chère. Depuis le rachat de la marque par Bernard Arnault, le président de LVMH, on ne lui fait plus de prix, il n’a plus les moyens. Son manoir de Beaucé lui coûte en entretien. Heureusement, il a quelques amis généreux qui l’invitent en vacances, Marc Ladreit de Lacharrière dans son chalet au ski, le patron de Ferrari à Capri. Il aura besoin de mécènes : Fillon se prépare pour l’Élysée. Il s’y voit, persuadé que Sarkozy va bientôt sombrer dans les affaires judiciaires. Comme toujours, la conversation glisse sur l’ancien président. « Que dit, que fait Nicolas ? » demande Fillon. Les spéculations durent des heures.
Bob jubile, il est encore au cœur des batailles de la droite, il va pouvoir raconter ça aux chefs d’États africains, redorer son blason, prouver son inoxydable influence et la monnayer. L’avocat souffle à Fillon ce qu’il veut entendre. Vraiment, oui, il a l’étoffe d’un président. Maintenant, il faut aller chercher des voix en Afrique, il l’aidera. Puis il faut se lâcher un peu, accepter les selfies avec les gens. « Vas-y, souris, va serrer des pinces, pousse-t-il Fillon au cours d’un de leurs dé jeuners. Pareil, avec les journalistes, mettre de l’huile. » Bourgi propose de lui en présenter, il les fréquente depuis si longtemps. L’avocat se targue même d’être le témoin du dernier mariage de l’ancien patron du Canard enchaîné, Claude Angeli. « Enfin, tout Paris connaît Bourgi, tonne-t-il. Je suis à ton service. » Les preuves de l’amitié sont là. Bourgi prend son téléphone, appelle quelques journalistes influents : « Fillon gagne à être connu, tu sais… Viens donc déjeuner avec nous au Véfour. » Évidemment, comme toujours, c’est lui qui régale, en cash. Le Libanais a le geste large.
À Noël 2014, un samedi matin, il re – joint « François » au Fouquet’s – le moral est faible, sa mère va mal. Bourgi le prend dans ses bras et file en Maserati chez Arnys. « Une tenue anglaise pour M. Fillon », commande-t-il au vendeur qu’il connaît bien. Allez, 5 180 euros, c’est pour lui peu de chose, il a bien offert quelques cravates Hermès à Guéant et des bottes cavalières de la même marque à une ancienne ministre. C’est ainsi en Afrique, on « cadotte », dans un mélange de calcul et de générosité sincère. L’ami François, touché, le remercie chaleureusement. « Il était si triste ce jour-là, se souvient l’avocat. J’ai voulu lui montrer mon affection. Sarko, il a tout ! Fillon, c’est facile de lui faire plaisir. » Fin août 2015, la Bentley de Bourgi file vers la Sarthe. Son chauffeur l’a déjà conduit plusieurs fois au grand hôtel de Solesmes pour déjeuner avec Fillon. Une bonne bouteille entre hommes et il repartait, sans se montrer. « Secret de deux, secret de Dieu ; Secret de trois, secret de tous », lui a appris Foccart. Une fois, une seule, il est venu accompagné de Macky Sall, le président du Sénégal qui eut droit, après les agapes, à une visite privée de l’abbaye de Solesmes.
Mais ce 26 août 2015, Bourgi apparaît en public au grand meeting de rentrée de Fillon, au milieu des militants. Il prétend que Sarkozy l’a appelé aussitôt, ivre de rage. « Je conserve mon estime et mon affection à Nicolas, indique-t-il alors, docte, au JDD. Mais ses dernières déclarations sur l’islam et l’immigration ne passent pas. »
Supplice chinois et menaces de mort
Quel jeu joue Robert Bourgi ? Ce 23 janvier 2016, il s’envole pour Bordeaux. Alain Juppé, alors favori des sondages, signe son dernier livre à la librairie Mollat. L’avocat en achète une pile pour Clémence, sa fille chérie qui brille dans une hypokhâgne de la ville. Il l’envoie au feu demander des autographes : « Je crois que vous connaissez mon père », ose-t-elle. La scène m’a été confirmée par des proches du maire de Bordeaux. Bourgi attend au fond de la salle. Il le sait : Alain Juppé ne l’apprécie guère ; il lui en veut d’avoir sali son nom, raconté partout qu’il l’avait emmené en tournée au Gabon et au Sénégal après sa condamnation en 2004. Depuis, c’est terminé. Ministre des affaires étrangères, il l’a même écarté d’un voyage officiel, pour la prestation de serment du président ivoirien Alassane Ouattara à Yamoussoukro. Là, tout de même, il le salue. Aussitôt Bourgi manifeste son envie de le revoir. « Écrivez-moi à mon QG », élude poliment Juppé. Bob a pris sa plume, s’excusant des « turpitudes du passé ». C’est sa grande formule, celle qu’il a aussi servie à Chirac et Villepin pour se faire pardonner après les révélations des mallettes. L’ancien professeur de droit écrit dans une belle langue nourrie de références à Saint-Exupéry et Malraux. Mais Juppé ne répond pas. « Pourquoi un tel mépris ? » s’interroge-t-il aujourd’hui encore.
Fillon, lui, tergiverse sur tout et ne décolle pas dans les sondages. Pas terrible pour les affaires, de miser sur le mauvais cheval… Finalement, en avril 2016, sur le site du Figaro, Bourgi « affirme haut et fort que [son] candidat s’appelle Nicolas Sar-kozy ». Un matin, on l’interroge sur ses revirements successifs. Il gémit, l’œil colère derrière les lunettes. « Oh mais elle m’embête, celle-là ! » Puis, soudain les mots jaillissent d’un trait, du fond du coffre. « Au fond, je n’ai jamais cru en Fillon. Tu comprends ma grande ? Tu me suis ? C’est Sarko que j’aime. C’est un bandit mais je l’aime. Il est comme moi : un affectif, un métèque. D’ailleurs, je ne l’ai jamais trahi, je lui racontais tout de mes discussions avec Fillon. » On écarquille les yeux, avant de se remémorer les propos de Claude Guéant entendus quelques jours plus tôt. « Bourgi est un fidèle, disait-il. Le lien avec Nicolas n’a jamais été rompu.»
Au lendemain de sa victoire à la primaire, Fillon reçoit un nouveau coup de fil de la maison Arnys : « Vous avez reçu en cadeau deux costumes. » Un vendeur passe à son appartement parisien lui présenter des liasses de tissus afin qu’il choisisse. Ses mensurations sont déjà enregistrées à la boutique. Le candidat des Républicains découvre alors le petit mot de félicitations de Bourgi. Fillon le remercie, d’un simple smiley. Mais Bob, lui, veut voir Fillon, trinquer autour d’un bon cassoulet, parler enfin sérieusement de son rôle de conseiller, de ce think tank sur l’Afrique qu’ils ont déjà évoqué. Il pense pouvoir revenir dans la course, effacer ces petits mois d’infidélité au nom de tous les bons moments passés ensemble. « Désolé. Suis sous l’eau », textote Fillon. L’Élysée est désormais à sa portée. Il ne peut plus jouer avec le feu, ignorer les mises en garde contre Bourgi, les messages envoyés par des diplomates à son directeur de campagne, Patrick Stefanini. Le député Bernard Debré se souvient d’une discussion particulièrement franche en dé cembre 2016 : « Je l’ai dit à François : “Si tu veux que je m’occupe de l’Afrique, je ne veux pas de Bourgi dans les pattes. Ce type est dangereux.” »
Fillon prend le large, Bob se sent méprisé. Alors il dégaine. Et il l’avoue aujourd’hui sans gêne, lové dans son cashmere bleu ciel : « J’ai appuyé sur la gâchette. » Samedi 11 mars 2017, Anne Méaux appelle François Fillon sur son portable. « Est-ce qu’il y a quelqu’un qui t’a offert des costumes ? Un mec un peu bizarre, paraît-il… » Le JDD, sous la plume de Laurent Valdiguié, s’apprête à sortir l’affaire le lendemain, sans révéler le nom de l’avocat, à sa demande. « Merde… Bourgi », lâche Fillon. Sa communicante est effondrée, le « Penelopegate » n’était donc qu’un zakouski. Fillon tente aussitôt de joindre Bob sur son portable. Attablé en famille au Bristol, il laisse sonner. Puis, après trois appels, finit par décrocher. « Fillon est paniqué, se souvient-il. Il me dit “Robert, ça va sortir demain. Ne dis rien, les journalistes vont te piéger. Laisse moins monter au créneau.” » L’avocat répond qu’il ne pourra ni nier, ni mentir : deux costumes ont été payés par chèque pour un montant de 13 000 euros. Étrange… D’habitude, il règle en liquide. Le nom de Bourgi circule dans les rédactions – de nombreux journalistes connaissent ses largesses. L’avocat leur susurrait d’ailleurs depuis quelques semaines : « Quand même, ce Fillon, il est gourmand, il a des goûts de luxe… » Un premier Tweet évoque son nom avant que Le Monde confirme. Bourgi fuit les caméras et s’envole pour le Liban de ses parents. Devant la télé d’un palace de Beyrouth, il mesure le respect que Fillon lui porte. « Un ami », entend-il dans sa bouche, sur France 2. Coup de fil immédiat de Bourgi le remerciant. Puis, après avoir annoncé sa décision de rendre les costumes, Fillon le traite sur BFM d’« homme âgé qui n’a plus aucune espèce de responsabilité ». « Tu m’as traité de vieux ? Là, tu as franchi la ligne jaune, gronde Bob au téléphone. Tu n’aurais pas dû, tu as fait pleurer ma petite Clémence. Je ne te le pardonnerai jamais. » Le supplice chinois n’en finit pas, alors que le premier tour de la présidentielle approche. Sur RTL et Mediapart, Bourgi cogne encore, prétendant que Fillon n’a pas rendu les costumes. L’avocat triomphe sur les ondes mais dans la rue, un retraité l’accuse de mener la droite au naufrage. Des menaces de mort lui parviennent au bureau. Son épouse le supplie de se calmer. « J’ai bien tenté, murmure-t-elle un matin, entre deux portes. Il était déchaîné. » Quelques jours après la défaite de François Fillon au pre mier tour, Robert Bourgi va déjeuner rue de Miromesnil, dans les bureaux de Nicolas Sarkozy. Comme toujours, il a des bal lotins de La Maison du chocolat dans les mains, et un petit flacon d’Habit rouge de Guerlain au fond de sa poche pour se parfumer en route. Comme toujours, il arrive en avance pour voir qui le précède. Ce jour-là, c’est Tony Estanguet qui porte la candidature de Paris aux prochains Jeux olympiques. Bourgi le salue puis tombe dans les bras de Sarkozy. Ils ont mille choses à se dire ; la droite est à terre, la gauche en miettes, un jeune de 39 ans va entrer à l’Élysée, voilà de quoi réfléchir à l’avenir. Bob annonce qu’il a finalement renoncé à publier ses Mémoires : « Trop dangereux, dit-il. Ce sera pour les Archives nationales après ma mort. » Sarkozy, qui a eu le privi- lège de lire quelques passages, salue la décision de son ami et le félicite pour ses récentes prestations à la radio. Le ton est chaleureux, la table excellente. Bourgi se régale : « Sarko n’a touché ni au vin ni à la tarte au citron, se souvient-il. Mais il était en grande forme. À la fin, il m’a dit “T’as vu Robert : On l’a bien niqué.” » Bob a ri puis il est reparti, le cœur un peu lourd. Si Fillon l’avait écouté, pense-t-il ; s’il l’avait surtout bien traité, l’histoire aurait peut-être été différente. Sur le chemin, une nouvelle fois, Bourgi a essayé d’appeler l’ami auquel il voulait du bien.
Voir aussi:
CONFIDENCES – « J’ai envie de savoir d’où c’est venu », indique François Fillon, qui continue à chercher la main qui aurait guidé ses accusateurs. Dimanche, le JDD raconte, de l’intérieur, toutes les coulisses de la campagne du candidat LR.
Depuis le 23 avril, il se tait. Muré dans son échec. « Un jour, je parlerai, mais c’est trop tôt », glisse François Fillon au JDD, la voix comme encore cassée par sa défaite. Puis il se reprend. « J’ai envie de savoir d’où c’est venu et comment ça s’est passé. » Il reste taraudé par cette unique question : qui a déclenché, voire orchestré les affaires qui ont ruiné son image, puis ses chances? Pour lui, c’est certain, quelqu’un « a guidé la main » de ses accusateurs… Dans sa tête tournent et retournent trois hypothèses : « Le pouvoir ; quelqu’un de mon camp ; un autre personnage extérieur à la politique [dont il ne veut pas dire le nom]. »
La façon dont lui a répondu aux soupçons et conduit sa campagne pendant la tourmente? « Honnêtement, je ne suis pas là-dessus, répond-il. Je suis tourné vers l’avenir. Et puis seul le résultat compte : si j’avais gagné, on aurait dit que j’avais tout bien géré ; comme j’ai perdu, on dit qu’on a tout fait mal. » Si c’était à refaire? « C’est tellement difficile de répondre à cette question », souffle-t-il. Et pourtant…
« François nous a menti, à tous, tout le temps »
Tout a commencé par un tête à tête dans un restaurant parisien. François Fillon et Anne Méaux, dirigeante de l’agence de communication Image 7, dînent au calme pour préparer la primaire. Anne Méaux, qui s’apprête à superviser la com de la campagne, dit avoir « posé la question franchement » : « François, est-ce qu’il y a des choses que je dois savoir? » L’interrogation est abrupte, bien dans le style de cette femme d’affaires coriace et avisée, experte en gestion de crise, toujours l’air mal réveillé et le portable jamais très loin de l’oreille, dont la réputation est de parler cash à ses clients, les grands patrons comme les politiques. Ce qu’elle demande ce soir-là, c’est si François Fillon a des casseroles. Comme un dernier check avant le décollage. Elle n’a pas oublié la réponse : « Sans la moindre hésitation, il m’a dit : ‘Non Anne, il n’y a rien.' »
Avec le recul de la défaite et l’avalanche des révélations qui ont piégé son champion, Anne Méaux reste persuadée qu’il était sincère : « Fillon est quelqu’un d’honnête. » Sincère peut-être, mais surtout secret, insondable. Y compris pour ses proches. « Il nous a menti, à tous, tout le temps », tranche le député Thierry Solère, qui fut le porte-parole du candidat. Une formule sèche qui résume la douloureuse épreuve que fut, pour ceux qui y ont participé, cette campagne au bord de la crise de nerfs.
Le diable a semé son premier détail un mardi. Ce 24 janvier, alors que les rotatives du Canard enchaîné impriment l’épisode 1 de ce qui va devenir le « Penelopegate », au QG de François Fillon, un immeuble froid et vitré de la rue de Vaugirard, on tire les rois. La droite ne le sait pas encore, mais elle vit ses dernières minutes de paix. Dans la galette, la fève est un chat noir. « C’était un très mauvais présage, se souvient Thierry Solère. On a ri un peu jaune, et juste après on a découvert Le Canard. » Dans l’ascenseur qui le conduit ensuite au 5e étage du QG, pour une réunion d’urgence dans le bureau du candidat, son téléphone crépite, mais il laisse sonner.
Le visage de François Fillon est sombre. « Encore un peu plus que d’habitude, se rappelle un participant. Impossible de savoir depuis quand il était au courant. » Sa garde rapprochée ignorait tout de l’affaire. Tout le monde est sonné. « Le Canard m’avait interrogé sur mes revenus et j’avais répondu, mais pas sur ma femme ; moi aussi, j’ai tout découvert ce soir-là », assure Fillon. Rien n’avait donc été anticipé pour préparer une réaction. D’autant que, lorsque ceux qui vont devoir mener la campagne avec lui le questionnent – « Y a-t-il d’autres sujets dont nous devrions parler? » – l’ancien Premier ministre oppose le même laconisme.
Cette réunion de crise est la première d’une longue série. François Fillon déteste ces moments bruyants où chacun s’exprime dans un mélange de fièvre et de confusion. « François a horreur de prendre une décision à chaud et en public », se désole un de ses anciens compagnons. Le candidat doit pourtant trancher : faut-il contre-attaquer, annoncer une plainte contre Le Canard enchaîné? « D’entrée, il a écarté cette idée, en disant qu’il ne voulait pas mêler la justice à la campagne », se souvient Thierry Solère. Dans la pièce, cette décision surprend tout le monde. Le porte-parole rédige un bref communiqué. « François a voulu gagner du temps, il misait sur le fait que l’affaire n’allait pas prendre », raconte un membre de l’équipe, persuadé qu’il aurait fallu au contraire s’excuser au plus vite, voire promettre de rembourser pour tenter de tuer l’affaire dans l’œuf… Anne Méaux, en déplacement, assure n’avoir appris les accusations contre Penelope Fillon que ce soir-là. De retour le lendemain, elle va s’investir à fond dans la gestion de crise de la campagne.
Anne Méaux : « Je ne suis peut-être pas Einstein, mais moi aussi, j’ai vu tout de suite que cet argument était désastreux »
Elle qui s’était juré de ne plus faire de politique (« Je n’aime pas ce milieu », dit-elle) a replongé pendant la primaire parce qu’elle « aimait les idées de Fillon ». Quand le scandale éclate, elle forme avec Patrick Stefanini, le directeur de campagne, un drôle de tandem autour du candidat : elle, ancienne collaboratrice de Giscard, militante d’extrême droite dans sa jeunesse, au parler rude mais qui vouvoie Fillon ; lui, ancien préfet chiraquien austère et discret, qui tutoie le candidat mais ne s’énerve jamais en public. Deux droites, deux mondes, deux styles. Tout les oppose mais ils ont gagné ensemble la primaire. Sur le front judiciaire, ce duo yin et yang va voler en éclats…
Le matin de la parution du Canard, François Fillon est en déplacement à Bordeaux. Pour sa défense, il dénonce la « misogynie » de l’article accusateur. « C’est du Méaux!, croit savoir un proche de Stefanini. Au QG, on est tombé des nues. » La conseillère enrage : « Je n’y suis strictement pour rien. Je ne suis peut-être pas Einstein, mais moi aussi, j’ai vu tout de suite que cet argument était désastreux. » Les premières tensions apparaissent et l’affaire s’emballe.
Deuxième réunion de crise, le jeudi 26 janvier dans le bureau de François Fillon. Ordre du jour : préparer son interview au 20 Heures de TF1, où il doit s’expliquer devant les Français. Thierry Solère, Patrick Stefanini, Sébastien Lecornu, directeur adjoint de la campagne planchent en attendant le candidat. Bruno Retailleau, chef des fillonistes au Sénat, les rejoint. Dans un silence lugubre, il leur annonce qu’outre sa femme, « François a également fait travailler deux de ses enfants ». « La présidence du Sénat a eu l’idée de regarder et on a découvert les deux contrats », explique Retailleau. Tous les présents se dévisagent, bouche bée. Lecornu, jeune président du conseil départemental de l’Eure (il est né en 1986) et proche de Bruno Le Maire, brise la glace : « Si ce soir François ne prend pas les devants et n’évoque pas lui-même le salaire de ses enfants, ce sera un mensonge par omission, puis un parjure, puis un feuilleton, puis la mort. »
L’hypothèse de la défaite, celle du chat noir, fait surface. À cet instant, François Fillon pousse la porte du bureau. « Il faisait la moue, relatera Lecornu. Il nous a écoutés silencieusement, puis il est parti à la télé sans que l’on sache ce qu’il avait décidé. » Anne Méaux est avec le candidat à TF1. « Bien sûr qu’il fallait anticiper, concède-t-elle. Ceux qui me connaissent savent bien que je suis pour la transparence, pour tout dire tout de suite. » À l’antenne, face à Gilles Bouleau, Fillon évoque de lui-même ses enfants. Mais en prétendant qu’il les a fait travailler pour lui au Sénat parce qu’ils étaient avocats – en réalité, ils étaient encore étudiants. Pour Anne Méaux, « François a été excellent ce soir-là… à une phrase près. » Elle assure avoir été interloquée en entendant le candidat promettre qu’il renoncerait en cas de mise en examen. « C’était une improvisation totale, dit-elle. En sortant, je lui demandé pourquoi il avait dit cela. Il m’a simplement répondu : ‘Mais Anne, parce que je ne serai jamais mis en examen.' » À sa décharge, la plupart des avocats discrètement consultés pronostiquaient alors que Fillon était à l’abri de toute poursuite…
« J’ai vu François avoir peur physiquement »
Au QG aussi, dans le bureau du directeur de campagne, le staff est stupéfait. Seul Stefanini, devant sa télé, trouve l’improvisation géniale. « Plus personne n’osera le mettre en examen maintenant! » prédit-il à chaud. Mais le « Penelopegate » est désormais un feuilleton judiciaire. « C’est vite devenu une campagne impossible », se souvient Thierry Solère. Les sondages plongent. À chaque déplacement, le candidat est attendu par des militants de gauche armés de casseroles. « J’ai vu François avoir peur physiquement », raconte un élu. « On a multiplié des visites sécurisées, se rappelle un membre de l’équipe. En février, l’agenda s’est vidé. »
Avec l’affaire, un nouveau personnage a fait son apparition : Penelope Fillon. Anne Méaux est chargée de l’assister, de la soutenir. Elle la décrit comme « une femme admirable, un peu timide, qui déteste les mondanités ». Les Français découvrent cette Galloise effacée aux cheveux courts lors du meeting parisien du 29 janvier, bouquet de fleurs dans les mains mais aux lèvres, un sourire fané. Si l’image est soigneusement calculée, la bande-son reste muette. « Bien sûr, il aurait fallu qu’elle prenne la parole plus tôt, admet Anne Méaux. C’était prévu au lendemain du meeting, cependant quand les avocats ont appris que les Fillon étaient convoqués, ils ont préféré qu’elle réserve ses explications à la police. » Ensuite, le candidat s’est envolé pour faire campagne à La Réunion. « Penelope ne voulait pas s’exprimer en son absence, c’est ce qui fait qu’on a trop traîné », précise Anne Méaux. Début février, France 2 déniche une ancienne interview, où Penelope Fillon expliquait n’avoir jamais travaillé pour son mari. Encore un jour sombre…
Je l’ai vu avoir envie de tout arrêter à plusieurs reprises, pour que leur cauchemar à eux s’arrête
Au fil des semaines, les avocats du couple Fillon, Antonin Lévy et Pierre Cornut-Gentille, comprennent que l’affaire ne sera pas classée. Le 17 février dans Le Figaro, le candidat martèle qu’il ira « jusqu’à la victoire » quoi qu’il arrive, signe qu’il n’exclut plus une mise en examen. Plus qu’un revirement, une volte-face. Le bateau tangue. La campagne s’enfonce. « Il fallait déminer un truc par jour, y compris mille choses fausses, peste Anne Méaux. On m’a appelée pour savoir si j’avais prêté 50.000 euros à Fillon! » Le candidat, lui, semble sur un chemin de croix. « François tenait bon, mais il était anéanti par ce qu’il faisait vivre à sa famille, se remémore la conseillère. Je l’ai vu avoir envie de tout arrêter à plusieurs reprises, pour que leur cauchemar à eux s’arrête. Dans ces moments de doute, il disait : si je lâche, je suis lâche. » D’où l’idée de recaler la stratégie de com : « On a insisté sur son courage, cela pouvait devenir une force. » Sans mesurer que parmi les chefs de la droite, ce courage commence à être perçu comme de l’entêtement.
Mardi 28 février, sur le coup de midi, le juge Serge Tournaire envoie un mail à Antonin Lévy. « À 16 heures dans mon bureau », ordonne le magistrat. L’avocat est à Washington, il prend le premier vol pour Paris. Son confrère Pierre Cornut-Gentille fonce au pôle financier, où il apprend de la bouche du magistrat que l’avis de mise en examen est parti. Nouvelle réunion de crise au QG dans la soirée. Comment rendre la nouvelle publique sans donner l’impression de subir ? Anne Méaux, jusque-là favorable aux conférences de presse (« des face-à-face physiques », dit-elle), prône « une banalisation de l’annonce », le lendemain matin, au Salon de l’agriculture, où le candidat est attendu. Fillon choisit l’option inverse : il annule sa visite et convoque les journalistes le lendemain, après avoir vu les ténors de la droite.
« Tu crois que je devrais renoncer? »
À l’issue de la réunion, Patrick Stefanini quitte un François Fillon « touché ». Pour le directeur de campagne, l’hypothèse du retrait prend du poids. « Je vais réfléchir, en parler avec ma femme », lui dit le candidat en partant. Cette nuit-là, l’ancien Premier ministre est décidé de ne rien lâcher à personne, y compris aux fidèles qui attendront en vain, le lendemain matin, à l’entrée du Salon porte de Versailles. « Il y avait trop de risque de fuites », justifie Anne Méaux, critiquant d’une formule crue bien à elle ces « politiques qui parlent sous eux ».
Le 1er mars à 8h10 tombe le communiqué qui annonce l’annulation de sa visite porte de Versailles, sans autre précision. Au même moment, Fillon appelle Stefanini depuis sa voiture. « Tu crois que je devrais renoncer? » interroge-t-il pour la première fois. « Oui », répond sobrement Stefanini. Le candidat ne dévoile rien de ses intentions. Quelque chose vient de se briser entre eux. « Ce matin-là, Anne Méaux et Bruno Retailleau ont pris le contrôle, décode un proche de Stefanini. Ils se sont installés au secrétariat et ils ont classé dans l’ordre ceux qui pourraient rentrer dans le bureau de Fillon. » Quand Bruno Le Maire arrive au QG, il n’est pas au courant de la mise en examen. « Retailleau refusait qu’on lui dise! Stefanini a pris sur lui de lui annoncer », raconte un témoin de la scène. Xavier Bertrand est introduit dans le bureau du candidat. « En ne demandant pas à Fillon de partir ce matin-là, Bertrand a eu un rôle déterminant », expliquera Stefanini à ses proches. Dans l’équipe, tout le monde se renvoie la faute. Seuls Gérard Larcher et Bernard Accoyer, le président du Sénat en exercice et l’ex-président de l’Assemblée, plaident droit dans les yeux pour l’abandon (même s’ils s’en défendront après-coup). « À partir de là, on a vu défiler les fillonistes de deuxième zone, se souvient un témoin. Ils étaient mobilisés pour regonfler Fillon à bloc. » Solère, partisan du retrait, affirme avoir été empêché de voir celui dont il était censé être le porte-parole.
Ébranlé, le candidat s’accroche encore. « Jusqu’au meeting du Trocadéro [le dimanche suivant], toutes les options sont restées ouvertes », confie Anne Méaux. Solère démissionne. Lecornu s’en va. Les juppéistes jettent l’éponge. Stefanini renonce à son tour. Quand le JDD.fr dévoile sa lettre de démission, le QG est le théâtre d’une scène surréaliste : pendant que Fillon est en ligne avec l’AFP pour affirmer que Stefanini reste à son côté, le même Stefanini indique sur une autre ligne à un autre journaliste de l’agence qu’il s’en va. Une équipe B va entrer en piste. « Dès la fin de matinée, on a vu arriver au QG des gens de Sens commun », se souvient un des démissionnaires.
C’est cette deuxième équipe qui organise le meeting du Trocadéro. Ce dimanche matin, 5 mars, Penelope Fillon parle pour la première fois, dans le JDD. « Oui, j’ai vraiment travaillé pour mon mari », jure l’épouse du candidat. L’entretien, décidé le vendredi soir, n’annonce en rien un retrait. Au contraire, il prouve que le clan a formé le carré, quand les juppéistes et les sarkozystes n’en finissent pas de se diviser. Plus la droite est fracturée, plus Fillon croit en ses chances. « Tous les éléments de l’affaire judiciaire étaient sur la table, on s’était expliqué sur tout, martèle Anne Méaux. On allait pouvoir reparler du programme, le plus dur était derrière nous. Mais le dimanche suivant, il y a eu les costumes… » Elle refuse d’entrer dans les détails de cette matinée, où elle fut interrogée sur le chèque de 13.000 euros signé le 20 février par un « ami donateur » pour offrir deux costumes sur mesure à François Fillon. A-t-elle cru, sur le moment, à une nouvelle « fake news »? Probable. Elle appelle aussitôt Fillon qui, contre toute attente, confirme l’épisode et lui révèle le nom du donateur : Robert Bourgi, l’intrigant avocat des réseaux franco-africains. « Dans cette histoire, j’aurai tout appris au fur et à mesure », analyse Anne Méaux, spectatrice aux premières loges du mystère Fillon – une énigme personnelle et psychologique bien plus que judiciaire.
« Avec les costumes de Bourgi, Anne a été vraiment soufflée, certifie un ami de la communicante. Fillon l’a bien senti, à tel point qu’il lui a demandé si elle aussi, elle allait le lâcher. » Anne Méaux ne confirme pas ce propos. « Ce n’est pas mon genre de lâcher les gens », avance-t-elle pour toute réponse. Cependant, avec la révélation sur les costumes, elle s’est mise à douter à son tour de la suite – même si elle dit avoir cru jusqu’au bout à un miracle dans les urnes. « Son score de 20%, c’est quand même mieux que celui de Chirac en 2002, plaide-t-elle à présent. C’était jouable. » Nombreux sont ceux, dans l’entourage du candidat, qui pensent au contraire que cette obstination était une folie.
« Aujourd’hui encore, je ne sais pas ce qu’il fallait faire », confie François Fillon. Le perdant de mai a regardé les législatives de juin « de l’extérieur, en spectateur ». Il assure avoir « tourné la page ». Il continue de jongler à l’infini avec ses « trois hypothèses » et espère bien connaître un jour le nom de celui qui, en lançant le « Penelopegate », l’a empêché de devenir président. Comme si d’autres responsabilités primaient sur la sienne dans son échec. Comme si ce n’était pas lui, tout simplement, le chat noir de la droite.
Voir également:
Richard Ferrand à nouveau épinglé par «le Canard enchaîné»
POLEMIQUE « En dépit d’une présentation arrangée et orientée à dessein, il n’est fait état de strictement aucune forme d’illégalité dans cet article », a réagi l’entourage du député…
27/06/17
Les ennuis continuent pour Richard Ferrand. Le Canard enchaîné a de nouveau épinglé, dans son édition à paraître mercredi, le député de La République en marche (LREM) qu’il présente comme un « militant du mutualisme familial » en énumérant plusieurs faveurs que l’élu aurait accordées à sa compagne.
Sandrine Doucen a été dès 2000, embauchée aux Mutuelles de Bretagne, dirigées à l’époque par celui qui est devenu samedi le patron des députés de La République en marche, affirme l’hebdomadaire.
De nombreuses « faveurs » accordées à sa compagne
Alors âgée de 25 ans et étudiante en droit, Sandrine Doucen aurait été embauchée en tant que directrice du personnel. La même année, elle a complété ses revenus par un « petit job » au château de Trévarez, un domaine appartenant au département du Finistère et géré par un comité d’animation présidé par le conseiller général Ferrand, poursuit l’hebdomadaire.
Sandrine Doucen continuera d’être salariée par les Mutuelles de Bretagne jusqu’à sa prestation de serment d’avocat en septembre 2004, soutient Le Canard enchaîné, pour qui la « bienheureuse étudiante aura bénéficié d’une sorte de bourse de 80.000 euros, financée par les mutualistes et les contribuables locaux ».
« Il n’y a rien à commenter », défend l’entourage de Ferrand
« En dépit d’une présentation arrangée et orientée à dessein, il n’est fait état de strictement aucune forme d’illégalité dans cet article », a-t-on réagi mardi dans l’entourage de Richard Ferrand. « Par conséquent, il n’y a rien à commenter. Seule la loi doit primer, l’État de droit, rien que l’État de droit, pas un pseudo ordre moral », a ajouté l’entourage de ce proche d’Emmanuel Macron. Sollicité par l’AFP, Richard Ferrand n’était pas joignable dans l’immédiat.
Fin mai, Le Canard enchaîné avait déjà révélé qu’en 2011, les Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était le directeur général, avaient choisi de louer un local à une société immobilière appartenant à sa compagne. Cette opération lui aurait permis de se doter « sans bourse délier, d’un patrimoine immobilier d’une valeur actuelle nette de 500.000 euros », selon l’hebdomadaire. Visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest dans le cadre de cette affaire, Richard Ferrand n’est resté qu’un mois à la tête de son ministère de la Cohésion des territoires. Samedi, il a été élu président du groupe des députés LREM à l’Assemblée nationale.
Voir de même:
Muriel Pénicaud joue gros ce mercredi. Dans la matinée, la ministre du Travail présente en Conseil des ministres son projet de loi d’habilitation pour réformer le code du travail par ordonnances. Et livre, l’après-midi, le résultat des premières concertations avec les partenaires sociaux, des discussions qui avaient été émaillées par plusieurs fuites de documents dans la presse révélant les pistes de l’exécutif.
Quasiment inconnue du grand public avant d’être nommée, Muriel Pénicaud a dirigé pendant trois ans Business France, un établissement public chargé de la promotion des entreprises françaises à l’international. La ministre du Travail a déjà passé un premier remaniement gouvernemental sans encombre alors que quatre de ses collègues ont été contraints de céder leur place, pour cause de possibles démêlés avec la justice. Elle pourrait pourtant rapidement être rattrapée par l’enquête préliminaire ouverte en mars par le parquet de Paris qui vise Business France pour délit de favoritisme, complicité et recel.
L’organisme est suspecté de s’être affranchi de la procédure d’appel d’offres en confiant à l’agence de communication Havas, sans aucun cadre juridique, une grande partie des prestations relatives à l’organisation d’une soirée à la gloire des start-up françaises (et du ministre de l’Economie, Emmanuel Macron), à Las Vegas en janvier 2016. Le tout pour 382 000 euros (avant renégociation). Or plusieurs documents exclusifs que s’est procurés Libération mettent à mal la communication de l’exécutif concernant la gestion de l’affaire par Muriel Pénicaud et l’implication du cabinet du ministre Macron dans l’organisation de l’événement.
Grand-messe
Las Vegas, 6 janvier 2016. Dans la salle de réception du luxueux hôtel The Linq, Muriel Pénicaud, alors directrice générale de Business France, applaudit Emmanuel Macron. Au premier rang, à ses côtés, le patron du Medef, Pierre Gattaz, est tout sourire. Cette soirée baptisée French Tech Night se tient dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES), un salon américain consacré à l’innovation technologique.
Plusieurs centaines d’entrepreneurs et de journalistes sont venus écouter le ministre de l’Economie avant d’échanger autour d’un fastueux banquet. Dix collaborateurs d’Havas, chargés par Business France de la quasi-totalité des prestations, sont présents pour assurer le bon déroulement du show. A trois mois du lancement de son parti et à dix mois de sa candidature à l’élection présidentielle, Emmanuel Macron fait vibrer la salle. Barbe de trois jours, chemise ouverte, et pin’s à la veste, le ministre est ovationné par un parterre ravi. Les comptes rendus des journalistes sont dithyrambiques et les premiers sous-entendus d’une possible ambition présidentielle sont distillés.
L’opération de communication est une parfaite réussite. Et pourtant, tout s’est préparé dans une urgence exceptionnelle pour l’organisation de ce genre de grand-messe, qui a obligé Business France à une sortie de route. Consulté par Libération, un rapport confidentiel rendu six mois après la soirée par le cabinet d’audit d’EY (ex-Ernst & Young) conclut que si Business France s’était plié à une procédure d’appel d’offres (obligatoire à partir de 207 000 euros), «il n’aurait pas été possible d’organiser la soirée dans le délai imparti. La procédure formalisée nécessite un délai de 52 à 77 jours. […] La sélection des prestataires n’aurait été effective que début janvier». Soit exactement au moment où la soirée devait se tenir. Bien trop tard. Le rapport d’EY permet d’établir une première chronologie des événements. En septembre 2015, une note rédigée à l’issue d’une réunion organisée par Business France évoque le CES. A cette époque, les responsabilités de chacun des acteurs ne sont pas encore établies. C’est seulement en novembre que Business France prend directement en charge l’organisation de cet événement, qui avait été organisé l’année précédente par le Medef.
Comment et pourquoi Havas a-t-il récupéré le contrat de la French Tech Night ? Les rapports consultés par Libération ne le disent pas. Les échanges de mails de Fabienne Bothy-Chesneau, qui pilote l’organisation en tant que directrice exécutive en charge de la communication et de la promotion à Business France, permettent simplement de trouver la trace d’une première réunion avec Havas le 3 décembre. Puis d’une seconde le 16 décembre, destinée à «présenter le dispositif qui sera mis en place par Havas». Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), demandé fin 2016 par Michel Sapin sur l’organisation de la French Tech Night et dont plusieurs passages ont déjà été révélés par le Canard enchaîné, relève que «les prestations ont été effectuées sans bon de commande, ni devis validé, ni contrat signé, ni constatation du service fait». Les fonctionnaires insistent : «Les différentes étapes de la commande publique ont été largement ignorées ou contournées.» Dans l’urgence, le rôle d’Havas, au départ limité aux relations presse et à la communication, va rapidement s’étendre à la partie événementielle.
Hôtel «trop kitsch»
Quel rôle a joué le cabinet d’Emmanuel Macron dans cette succession de dysfonctionnements ? Dans le protocole transactionnel entre l’agence de communication et Business France, postérieur à l’événement, l’implication de l’entourage du ministre est subtilement reconnue. Ce document justifie le choix de confier des prestations à Havas «en considération de l’ampleur donnée à l’événement notamment par le cabinet du ministre des Finances (environ 500 personnes conviées) et de la date qui approchait». Des échanges de mails retranscrits dans l’audit d’EY ne laissent par ailleurs aucun doute sur l’implication du cabinet du ministre de l’Economie. Une attitude qui agace d’ailleurs Fabienne Bothy-Chesneau qui tente, d’après l’audit d’EY, «d’éviter que les autres parties prenantes dictent au prestataire Havas des choix non arbitrés» par son service. Dans un mail du 16 décembre, la directrice de la communication de Business France essaie de recadrer Christophe Pelletier, qui dirige l’équipe d’Havas missionnée pour organiser l’événement : «C’est Business France qui décide et nous sommes aimables et associons la mission French Tech [rattachée au ministère de l’Economie, ndlr] ainsi que le cab. Pas l’inverse.»
Le cabinet d’Emmanuel Macron s’immisce jusque dans le choix de l’hôtel : dans un mail du 3 décembre, le conseiller économique de l’ambassade de France aux Etats-Unis informe Bothy-Chesneau que le cabinet d’Emmanuel Macron préfère l’établissement The Linq, finalement retenu, au détriment d’un autre qu’il juge «trop kitsch». «Nous comprenons que la définition exacte des besoins a pu être en partie déterminée par des personnes extérieures à Business France, en particulier le cabinet du ministre de l’Economie», tranche même l’audit d’EY. Pourtant lorsque l’affaire est rendue publique en mars, en pleine campagne présidentielle, Muriel Pénicaud dégaine un communiqué pour couvrir Macron : «Le ministre et son cabinet n’interviennent pas dans les procédures d’appel d’offres, et donc dans la relation contractuelle entre Business France et Havas.»
Perquisitions
Côté judiciaire, l’enquête débute tout juste et les éventuelles implications pénales ne sont pas encore établies, selon une source proche du dossier. L’audit d’EY commandé par Muriel Pénicaud retient principalement la responsabilité de Fabienne Bothy-Chesneau, en première ligne à Business France pour l’organisation de l’événement et qui a quitté l’organisme en février 2016. Contactée par Libération, elle n’a pas souhaité livrer sa version des faits. Concernant le prestataire, l’IGF relève «qu’Havas n’a jamais manifesté d’inquiétude ou de réticence liées au non-respect de ces règles au long du processus de commande». «L’agence était déjà engagée avec Business France dans le cadre d’un autre appel d’offres, c’est pour ça que l’on a répondu à cette demande sans s’interroger sur le cadre légal», répond-on chez Havas. Le 20 juin, les policiers de l’office anticorruption (Oclciff) ont mené des perquisitions au siège du groupe Havas et dans les locaux de Business France dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte en mars.
Muriel Pénicaud pourrait-elle être poursuivie en tant que directrice générale de Business France ? Plusieurs cadres de l’établissement public interrogés par Libération estiment que l’actuelle ministre du Travail a difficilement pu passer à côté du pilotage d’un événement aussi important. D’ailleurs, à la lumière des documents consultés par Libération, son implication est manifeste à plusieurs titres. D’abord, elle a validé un premier versement de Business France, pourtant réalisé de façon irrégulière, en décembre 2015. A peine un mois avant la soirée, l’agence doit régler à toute vitesse un acompte de 30 000 euros à l’hôtel où se tient la réception. Mais l’établissement n’accepte pas de virement et les cartes de Business France ne peuvent pas dépasser un plafond de paiement de 7 000 euros. La carte bleue personnelle du directeur financier de Business France est alors utilisée pour régler l’acompte. Pénicaud valide ce contournement des règles. Le service achat de l’agence découvrira le contrat avec l’hôtel seulement une semaine après. Un deuxième versement d’un montant équivalent est également approuvé en janvier par la directrice générale, peu de temps après la réception.
«Pas d’autre choix»
Mais le plus compromettant sur le plan politique pour l’actuelle ministre est ailleurs. La semaine dernière, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, usait de beaucoup d’énergie pour la couvrir en affirmant ne pas être «inquiet» des conséquences de cette affaire : «Muriel Pénicaud a provoqué immédiatement un audit, puis une inspection générale.» Les documents consultés par Libération permettent de remettre en cause cette version de l’histoire vendue par l’exécutif. Muriel Pénicaud, qui refusé de répondre à nos questions en invoquant un agenda trop chargé, a, en réalité, donné l’impression de vouloir enterrer l’affaire.
Début février 2016, la responsable du service des achats reçoit une demande de refacturation d’Havas de 248 925 dollars (environ 220 000 euros) et alerte la directrice générale. «A ce moment-là, Pénicaud n’avait pas vraiment d’autre choix que de déclencher un audit», commente un haut fonctionnaire de Bercy. Par la suite, la désormais ministre du Travail n’informera pas avant la fin de l’année 2016 les instances internes de contrôle et les ministères de tutelle : Bercy et le Quai d’Orsay. Pourtant en juin, le comité d’audit de l’organisme s’était réuni. «La direction de Business France a fait le choix de ne pas l’informer lors de cette réunion de l’audit externe qui avait été demandé à EY, qui à cette date était presque finalisé», note l’IGF.
Daté du 28 juillet, le rapport alarmiste d’EY va dormir dans le placard de Muriel Pénicaud pendant encore quelques mois. Et le 5 décembre 2016, la directrice soumet à un nouveau comité d’audit, qui a la charge de préparer le conseil d’administration qui doit se tenir dix jours plus tard, un simple résumé du rapport d’EY ainsi qu’un protocole transactionnel déjà signé par Havas. Ce qui est contraire aux règles habituelles. Le contrôleur économique et financier de Business France, qui siège au comité d’audit, découvre à cette occasion la situation et refuse alors de signer la transaction, puis alerte les ministères de tutelle. C’est Michel Sapin, succédant au ministère de l’Economie à Emmanuel Macron après sa démission, qui saisit alors l’IGF pour établir un rapport. Et regrette dans sa lettre de mission cette absence d’information de la future ministre.
L’affaire en dates
Novembre 2015. Business France prend en charge l’organisation de la soirée French Tech Night prévue à Las Vegas en janvier
Décembre 2015. La quasi-totalité des prestations est confiée à Havas, sans procédure d’appel d’offres. Le cabinet de Macron participe activement à l’organisation. Un premier paiement irrégulier est validé dans l’urgence par Muriel Pénicaud.
6 janvier 2016. Malgré ces conditions d’organisation, la soirée a lieu.
Février 2016. Après une alerte interne, Pénicaud commande un audit.
Juillet 2016. L’audit alarmiste est remis à Pénicaud mais elle ne prévient ni les organes internes de contrôle ni ses ministères de tutelle.
5 décembre 2016. Pénicaud tente de faire passer le protocole transactionnel avec Havas lors d’un comité, fournissant une simple synthèse de la situation. Le contrôleur économique et financier avertit alors les ministères de tutelle.
21 décembre 2016. Michel Sapin, nouveau ministre de l’Economie, saisit l’IGF.
28 février 2017. Le rapport de l’IGF reprend largement les observations de l’audit et son auteur fait un signalement au parquet pour une suspicion de délit de favoritisme.
8 mars 2017. Le Canard enchaîné publie des extraits du rapport de l’IGF.
13 mars 2017. Ouverture d’une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel.
20 juin 2017. Perquisition au siège d’Havas et de Business France.
Voir encore:
Quand l’AFP étouffe des informations gênantes pour le nouveau pouvoir
COMMUNIQUÉ DU SNJ-CGT DE L’AFP
L’affaire Richard Ferrand, sortie par Le Canard Enchaîné dans son édition du 24 mai, aurait pu être révélée par l’AFP. Des journalistes de l’Agence étaient en effet en possession des informations, mais la rédaction en chef France n’a pas jugé le sujet digne d’intérêt.
Qu’un possible scoop sur une affaire politico-financière impliquant le numéro deux du nouveau parti au pouvoir ne soit pas jugé intéressant, voilà qui est troublant. Surtout après les affaires Fillon et Le Roux qui ont émaillé la campagne présidentielle, et alors que le nouveau président Emmanuel Macron affirme vouloir moraliser la vie politique.
Généralement, un média met les bouchées doubles pour enquêter sur ce type d’informations quand elles se présentent. Pas à l’AFP, où les courriels de journalistes adressés à la rédaction-en-chef France soit sont restés sans réponse, soit ont reçu une réponse peu encourageante.
Faute d’avoir pu donner l’affaire Ferrand en premier, ces mêmes journalistes de l’AFP ont eu la possibilité de sortir un nouveau scoop deux jours après l’article du Canard : le témoignage exclusif de l’avocat qui était au coeur de la vente de l’immeuble litigieux des Mutuelles de Bretagne en 2010-11. Mais avant même qu’une dépêche ait été écrite, la rédaction en chef France a refusé le sujet. C’était pourtant la première fois qu’une source impliquée dans le dossier confirmait les informations du Canard et pointait la possibilité d’une infraction pénale de M. Ferrand.
L’AFP se contentera, quelques jours plus tard, de mentionner d’une phrase le témoignage de l’avocat interviewé par Le Parisien. Ce même témoignage qui conduira à l’ouverture d’une enquête par le parquet de Brest….
INTÉRÊT « TROP LIMITÉ »
Ce n’est pas tout : avant l’affaire Ferrand, le 17 mai, juste après la nomination du nouveau gouvernement, une dépêche annonce que François Bayrou, nouveau garde des Sceaux, devra lui-même faire face à des juges, dès le 19 mai, après son renvoi en correctionnelle pour diffamation. Mais la dépêche n’a pas été diffusée, la rédaction en chef France trouvant son intérêt « trop limité ». Deux jours plus tard, l’info sera en bonne place dans les médias nationaux. L’AFP décidera alors de la reprendre !
Interrogée jeudi par les syndicats lors de la réunion mensuelle des délégués du personnel, la direction de l’information de l’AFP s’est montrée incapable de justifier de manière argumentée les choix de sa rédaction en chef.
Tout cela fait beaucoup d’infos sensibles étouffées en quelques jours. Pour ceux qui ont travaillé sur le dossier, il y a de quoi être écoeuré et découragé. L’Agence France Presse, l’une des trois grandes agences d’informations mondiales, dont le statut rappelle l’indépendance, a-t-elle peur de diffuser des informations sensibles quand celles-ci risquent de nuire au nouveau pouvoir politique élu ?
Le SNJ-CGT appelle la direction et la rédaction en chef de l’AFP à s’expliquer sur le traitement incompréhensible de l’affaire Ferrand.
Le SNJ-CGT rappelle que l’AFP est et doit rester indépendante, que ses journalistes doivent pouvoir enquêter librement et publier toute information même si elle est gênante pour tout type de pouvoir, en particulier le pouvoir politique.
Le SNJ-CGT, Paris le 20 juin 2017
Voir de plus:
Ce n’est plus de la tartufferie, mais de la guignolade. Il est hilarant d’observer les donneurs de leçons de morale, François Bayrou en tête, recevoir en boomerang les conseils qu’ils entendaient prescrire aux autres. La démission, ce mercredi, du ministre de la Justice, porteur de la loi rebaptisée entre temps « rétablissement de la confiance dans l’action publique », vient après celle de Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, et de Sylvie Goulard, ministre des Armées, qui avait pris courageusement les devants dès mardi. Ces trois ministres issus du MoDem ont à répondre de soupçons sur le financement d’assistants parlementaires européens. Jusqu’alors, seul le FN était accusé de telles pratiques. Dès 2014, Corinne Lepage avait pourtant dévoilé les arrangements douteux tolérés par le parti présidé par Bayrou. Pour sa part, Richard Ferrand, qui s’était illustré dans ses attaques féroces contre la moralité du candidat François Fillon, a été exfiltré par le chef de l’Etat lui-même pour être placé à la tête des députés de La République en marche. Sarnez devrait semblablement prendre la tête du groupe MoDem (42 élus) à l’Assemblée. Cet épisode croquignolesque, qui entache le sérieux du macronisme, a une allure de fable sur la sagesse. Le moralisme pour les Nuls est le degré zéro de la politique quand celle-ci n’a rien d’autre à dire.
Le camp du Bien, qui avait repris des joues ces derniers temps au contact de la Macronie, mérite toutes les moqueries de l’arroseur arrosé. Les Intouchables, qui s’auto-promeuvent exemplaires depuis des décennies, font partie des impostures qui fleurissent dans cette république des faux gentils. J’en avais dénoncé les tares en 2004 dans un essai, qui mériterait depuis le rajout de nombreux autres chapitres. Mardi, dans Le Figaro, l’universitaire Anne-Marie Le Pourhiet s’étonnait à son tour que ce projet de loi prétendument audacieux de Bayrou n’avait pas jugé utile, par exemple, « d’imposer la publication des noms, des fonctions, et des montants des donateurs français et étrangers aux partis comme aux candidats, afin que les citoyens sachent envers qui nos gouvernants sont redevables ». J’avais moi-même déploré en mai, ici, que Macron ne dise rien de son réseau d’amis banquiers, responsables du Cac 40, créateurs de start-up, hommes d’influence qui ont financé sa campagne jusqu’à 15 millions d’euros. En fait, comme le démontre Le Pourhiet, la moralisation de la vie politique n’est qu’un vulgaire « plan « com » populiste ». Une bulle, parmi d’autres bulles qui forment la constellation cheap de la Macronie. Celle-ci vient d’éclater. A qui le tour ?
Voir enfin:
Désintox
Les porte-parole de La France insoumise occupent-ils indûment un HLM ?
Valentin Graff
Libération
19 mai 2017
Régulièrement accusés d’occuper un logement social sans y être éligibles, Alexis Corbière et Raquel Garrido se sont défendus… quitte à déformer la vérité. Désintox fait le point, une bonne fois pour toutes.
Les porte-parole de La France insoumise occupent-ils indûment un HLM ?
INTOX. Avec la campagne des législatives, les vieux dossiers sont de sortie. Le couple de porte-parole de La France insoumise, Alexis Corbière (candidat à Montreuil) et Raquel Garrido, se voit de nouveau reprocher d’occuper un logement social de Paris. Une affaire qui traîne depuis des années.
«On fait croire qu’on défend les pauvres mais on a pris leur logement social. On gagne plus de 4 000 euros par mois mais on vous emmerde : c’est légal. Votez pour Corbière et Garrido, des Insoumis sans moralité !» dénonce un tweet largement partagé et illustré d’une photographie de Paris Match montrant le couple dans son appartement. Une coalition hétéroclite, composée d’internautes proches de l’extrême droite et du mouvement En marche, accompagnés d’un sénateur UDI, relaie la réquisition à l’aide du mot-clé #rendsl’appart. Certains évoquent, en guise de circonstance aggravante, un «HLM de luxe».
Confrontée à ces accusations, Raquel Garrido a pris la peine de répondre à ses détracteurs, niant que le couple gagne 4 000 euros mensuels et habite un HLM.
L’accusation est ancienne. Son origine remonte à un article du Monde publié en juin 2011 : on y apprenait qu’Alexis Corbière, alors premier adjoint de la maire PS du XIIe arrondissement de Paris, louait un logement de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), l’un des quatre bailleurs sociaux de la capitale. En novembre de la même année, le site d’extrême droite Riposte laïque s’émeut de la nouvelle.
Fin 2012, lors d’une prestation remarquée de Corbière face à un militant du Bloc identitaire sur la chaîne Numéro 23, la fachosphère fait son œuvre et déniche l’information : Pierre Sautarel, l’animateur du site réactionnaire Fdesouche, moque «Alexis Corbière, l’ami du peuple qui vit dans un HLM alors qu’il est au-dessus du seuil». Il est imité par Damien Rieu, alors militant de Génération identitaire, qui prendra la tête de la communication de la ville de Beaucaire conquise par le FN en 2014.
Fin 2013, Mediapart révèle que cinq adjoints à la mairie de Paris sont dans la même situation. Anne Hidalgo, alors candidate à la succession de Bertrand Delanoë, annonce qu’elle demandera aux conseillers de Paris de renoncer à leurs logements sociaux. Cela vaut à Alexis Corbière d’être à nouveau cité dans un article du Monde, avec à la clé de nouveaux tweets indignés.
En 2014, suite à une altercation, le député PS Alexis Bachelay demande à Raquel Garrido, compagne d’Alexis Corbière, de «laisser [son] logement social à quelqu’un qui en a vraiment besoin». L’avocate rétorque simplement : «Que savez-vous de mes revenus ?», laissant penser que ceux-ci pourraient lui permettre de prétendre légitimement à un logement social.
DÉSINTOX. Alors, Garrido et Corbière vivent-ils indûment dans un HLM ? Les accusations portées à l’encontre du couple sont inexactes mais la défense de Raquel Garrido l’est également. Car de fait, ils vivent bien dans un HLM, depuis peu, même si ce n’était pas le cas au départ. Explications.
Raquel Garrido, contactée par Désintox, explique la chronologie des faits : en 2000, Alexis Corbière et elle entrent dans le parc locatif de la RIVP. En 2003, après une deuxième naissance dans la famille, ils échangent leur appartement au sein de la RIVP et emménagent dans leur logement actuel, dans le XIIe arrondissement de Paris, où Alexis Corbière est à l’époque adjoint à la mairie. C’est la ville de Paris qui attribue ces logements, étant l’unique réservataire des logements à «loyer libre», contrairement aux HLM répartis à parts égales entre la commune, la préfecture et le 1% logement.
Le nouvel appartement, dans l’extrême est parisien, est un F4 d’un peu plus de 80 mètres carrés dans lequel le couple vit désormais avec trois enfants. Lors de l’emménagement en 2003, l’appartement est un logement «à loyer libre». Au début des années 2000, le parc immobilier des bailleurs sociaux parisiens compte environ 50 000 de ces logements particuliers. Pour y entrer, aucun plafond de ressource, ni de plafonnement des loyers similaire aux seuils en vigueur pour les HLM. Du coup, ces appartements sont en dessous des prix du marché, mais au-dessus des loyers HLM. Actuellement, le couple paye 1 230 euros (955 hors charges) pour 84 mètres carrés.
En décembre 2007, Jean-Paul Bolufer, le directeur de cabinet de Christine Boutin (alors ministre du Logement), est épinglé pour son appartement, dans le Ve arrondissement de Paris, de 190 mètres carrés pour 1 200 euros par mois, soit à peine 6,30 euros du mètre carré. Il s’agit évidemment… d’un logement à loyer libre, loué par la même RIVP. Plusieurs élus sont dans la même situation. La municipalité socialiste de Paris demande alors aux ministres et parlementaires concernés de rendre leurs logements sociaux et annonce sa volonté de «reconventionner» ces logements, c’est-à-dire de les reverser au parc HLM. L’objectif : «créer» du logement social à moindres frais et «moraliser» le parc social.
Ce que Raquel Garrido ne précise pas, c’est que l’immeuble où se situe l’appartement du couple fait partie de ceux qui ont été reconventionnés, nous indique une source de la RIVP. Plus précisément, le logement est depuis 2016 un prêt locatif à usage social (PLUS), le plus commun des HLM. Il s’agit de la catégorie intermédiaire, entre les PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), correspondant aux logements dits «très sociaux», et les PLS (prêt locatif social), sorte de HLM «de luxe». Ce logement n’est donc pas «de luxe», contrairement à ce que dénonçaient plusieurs internautes.
Raquel Garrido et Alexis Corbière vivent bien dans un HLM depuis un an
Ce qui signifie que si le couple de porte-parole n’a pas intégré de logement social en 2003, il vit bien dans un HLM depuis environ un an, contrairement à ce qu’a affirmé Raquel Garrido.
Corbière et Garrido occupent-ils leur HLM indûment ? En aucun cas, d’un point de vue légal. Les deux porte-parole ont investi l’appartement à un moment où il n’y avait pas de conditions de ressources. Auraient-ils dû le quitter en 2016 lors du «reconventionnement» ? En aucun cas non plus.
Reste une question : le couple, en vivant dans un HLM, prend-il la place de personnes en ayant plus besoin ? Rien n’indique que leurs revenus excèdent le plafond de ressources correspondant au nouveau statut de leur logement, fixé à 64 417 euros annuels pour un foyer de 5 personnes en 2017. Raquel Garrido affirme que ce n’est pas le cas. Alexis Corbière n’est plus élu depuis 2014 et a repris un poste à plein temps dans un lycée professionnel, tandis que Raquel Garrido est avocate depuis 2011 avec «des bonnes et des mauvaises années». Elle assure n’avoir jamais été rémunérée pour ses activités politiques.
Quoi qu’il en soit, les occupants, quels que soient leurs revenus, ne pourront être délogés. Deux cas de figure se posent en cas de reconventionnement : si les occupants du logement ont des revenus inférieurs au plafond de ressources correspondant au nouveau régime HLM de l’immeuble, leur loyer peut être revu à la baisse. Dans le cas contraire, avec des revenus supérieurs au plafond, ils peuvent demeurer sur place avec loyer inchangé.
En théorie, et à condition que leurs revenus soient inférieurs au plafond, le couple pourrait donc même bénéficier… d’une révision à la baisse de son loyer. Pour cela, Garrido et Corbière devraient d’abord changer de bail, une formalité administrative qu’il leur revient d’effectuer ou non. Ils restent en attendant liés par le bail d’origine, une situation qui peut être prolongée indéfiniment. A ce jour, Raquel Garrido explique n’avoir encore effectué aucune démarche de changement de bail.
Seule certitude : le couple jouit aujourd’hui d’un loyer très en deçà des prix du marché, sans pour autant que leur situation n’apparaisse choquante à la RIVP. Celle-ci a en effet la possibilité de faire jouer l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 pour augmenter un loyer, si celui-ci est manifestement sous-estimé au regard des prix du marché. C’est l’extrêmité à laquelle la régie est arrivée concernant Jean-Pierre Chevènement : alors sénateur, il occupait un de leurs logements sociaux, un «bel appartement de 120 mètres carrés dans le quartier du Panthéon, pour 1 519 euros mensuels, un loyer qui s’élèverait dans le privé à 3 500 euros», comme nous l’écrivions en 2011. Compte tenu de son patrimoine immobilier par ailleurs important, la RIVP avait fait jouer l’article 17-2 et révisé son loyer à la hausse. Le fait que Garrido et Corbière ne soient pas visés par une telle démarche de la RIVP montre donc que leur situation, pour être avantageuse, n’est en rien comparable à celle de l’ancien maire de Belfort




 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 








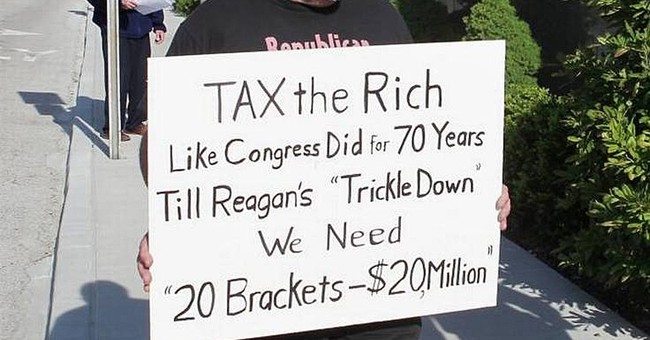



 L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer, au hasard, tant qu’on peut dans la foule.
L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers au poing, à descendre dans la rue et à tirer, au hasard, tant qu’on peut dans la foule. 



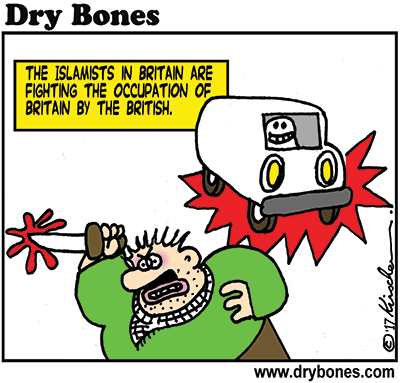 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié.
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. 
 Nul n’est prophète en son pays.
Nul n’est prophète en son pays. 








Les voleurs nous protègent contre la police. Otages du Crédit Suédois de Stockholm (le 23 août 1973)
Adam D. (…) qui a foncé avec une Mégane Renault sur un fourgon de gendarmes posté près du rond-point des Champs-Élysées, à Paris (…) était fiché « S » pour radicalisme par la Direction générale de la sécurité intérieure. Selon nos informations, il s’est vu délivrer un port d’arme en février 2017 par la préfecture de l’Essonne. (…) Dans sa voiture ont été retrouvés deux glocks, deux kalachnikovs et deux bonbonnes de gaz. Les gendarmes qu’il a attaqués l’ont extrait de son véhicule alors qu’une grosse fumée orange se répandait sur l’avenue des Champs-Élysées, près du square Marigny. Mais Adam D. n’aurait pas résisté à l’explosion et la fumée qui avait envahi la voiture qu’il conduisait. Le Point
La ministre des Armées Sylvie Goulard fait savoir ce mardi 20 juin qu’elle renonce à figurer dans le nouveau gouvernement qu’Emmanuel Macron a chargé Edouard Philippe de former. Elle est citée dans l’affaire des soupçons d’emplois fictifs au MoDem, tout comme ses collègues François Bayrou et Marielle de Sarnez. (…) Cette annonce intervient au lendemain du départ d’un autre ministre, Richard Ferrand. Lui aussi a des démêlés avec la justice : une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Brest sur l’opération immobilière qui a profité à sa compagne lorsqu’il était patron des Mutuelles de Bretagne. Le désormais ex-ministre de la Cohésion des territoires va briguer la présidence du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale. (…) Le président de la République a-t-il entrepris, dans le cadre de ce remaniement, de vider son gouvernement de tous les ministres touchés par des affaires ? L’annonce publique de Sylvie Goulard, inhabituelle dans son genre puisqu’elle avait été démissionnée lundi avec tout le gouvernement, met en tout cas ses collègues François Bayrou et Marielle de Sarnez dans une situation délicate : comment les maintenir à leurs postes de ministres alors qu’ils sont dans la même situation qu’elle ? Marianne
Une ministre qui démissionne, une alliée entendue par la justice, des perquisitions en cours : le climat des affaires vient assombrir l’après législatives des vainqueurs de dimanche. (…) Exfiltré lundi du gouvernement, Richard Ferrand va briguer la présidence du groupe LREM à l’Assemblée nationale. Une façon pour Emmanuel Macron d’éloigner du gouvernement son ministre de la Cohésion des territoires alors qu’il est visé par une enquête préliminaire pour une opération immobilière. (…) Le parti de François Bayrou est soupçonné d’avoir utilisé pour ses propres activités en France plusieurs assistants de députés européens, payés par Bruxelles. (…) la ministre des Armées Sylvie Goulard a annoncé dans la matinée qu’elle quittait le navire. (…) Ex-députée européenne Modem, son nom est cité dans l’enquête sur les assistants parlementaires européens. (…) Au même moment, Corinne Lepage, ancienne eurodéputée du Modem, était entendue comme témoin pour la même affaire. En 2014, dans son livre les Mains propres, l’ex-ministre écrivait : «Lorsque j’ai été élue au Parlement européen en 2009, le Modem avait exigé de moi qu’un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J’ai refusé en indiquant que cela me paraissait d’une part contraire aux règles européennes et d’autre part illégal. Le Modem n’a pas osé insister mais mes collègues ont été contraints de satisfaire cette exigence. Ainsi, durant cinq ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée… par l’enveloppe d’assistance parlementaire de Marielle de Sarnez, sur fonds européen». Passé plutôt inaperçu à la sortie du livre, l’extrait a largement circulé sur les réseaux sociaux pendant la campagne présidentielle. C’est pour une autre enquête que des perquisitions ont été menées, également ce mardi matin, au siège du groupe publicitaire Havas et de l’agence nationale Business France. Les enquêteurs se penchent ici sur l’organisation d’un déplacement en janvier 2016 à Las Vegas d’Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie. Il y a rencontré des patrons français. Une opération «montée dans l’urgence, à la demande expresse du cabinet du ministre, […] confiée au géant Havas par Business France sans qu’aucun appel d’offres ait été lancé», avait avancé le Canard enchaîné en mars cette année. Une enquête préliminaire pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme a été ouverte par le parquet de Paris. Signalons en passant que Business France était, à l’époque, dirigé par l’actuelle ministre du Travail Muriel Pénicaud. Libération
En réalité, la bulle macroniste des origines n’est jamais très loin. Cette fois, elle fait enfler une majorité absolue de députés La République en marche (359 sièges avec le Modem) qui ne repose que sur un socle électoral restreint. Ne pas se fier à l’effet d’optique : la France reste fracturée comme jamais. Et bien des nerfs sont à vif chez ceux qui refusent d’avaler l’élixir euphorisant du Docteur Macron, aux effets secondaires addictifs. En fait, une crise de l’intelligence politique se dissimule derrière la crise de la démocratie. Si une majorité d’électeurs ne votent plus, en dépit de la pléthore de candidats à ces législatives, c’est que ceux-ci n’ont rien à dire d’intéressant. J’ai entendu distraitement François Baroin (LR), hier soir, réciter d’un ton morne et las un vague programme dont la fiscalité semblait être le seul point de discorde avec la majorité. Alors que la crise identitaire est largement plus préoccupante que le PIB, le sirop du Docteur Macron a réussi à faire croire, y compris à la droite somnolente et au FN, que l’économique était au coeur de tout. Manuel Valls, seul socialiste à avoir mis les problèmes identitaires (communautarisme, islam radical, etc.) au centre de ses préoccupations, est à cause de cela la cible de violences verbales de la part de l’islamo-gauchisme. Hier soir, sa courte victoire dans l’Essonne (139 voix) a été contestée par Farida Amrani, candidate de la France insoumise. Julien Dray (PS) a dénoncé hier « une violente campagne communautariste aux relents antisémites menée contre Valls ». Alors qu’une nouvelle vague d’immigration se presse aux portes de l’Europe et que l’islam politique ne cesse d’attiser la guerre civile (ce lundi matin, la mosquée londonienne de Finsbury Park a été la cible d’un attentat contre des musulmans), la classe politique française discute du sexe des anges, comme à Byzance la veille de sa chute. Macron a-t-il quelque chose à dire sur ces sujets ? Ivan Rioufol