

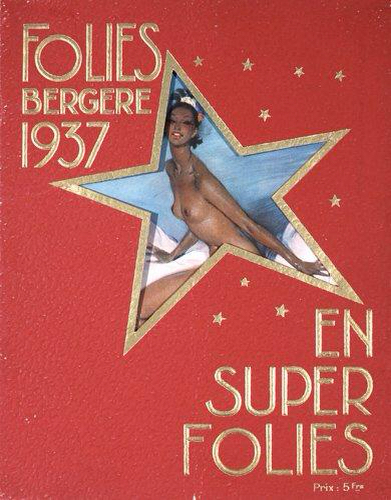



Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Jésus (Matthieu 23: 29-31)
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Jésus (Matthieu 10 : 34-36)
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ. Paul (Galates 3: 28)
Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, à déchirer par tourments et par géhennes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu’il est trépassé. Il ne faut pas juger à l’aune de nos critères. (…) Je trouve… qu’il n’y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu’on m’en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage. (…) Leur guerre est toute noble et généreuse, et a autant d’excuse et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir ; elle n’a d’autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu… Ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et reconnaissance d’être vaincus ; mais il ne s’en trouve pas un, en tout un siècle, qui n’aime mieux la mort que de relâcher, ni par contenance, ni de parole, un seul point d’une grandeur de courage invincible ; il ne s’en voit aucun qui n’aime mieux être tué et mangé, que de requérir seulement de ne l’être pas. Ils les traitent en toute liberté, afin que la vie leur soit d’autant plus chère ; et les entretiennent communément des menaces de leur mort future, des tourments qu’ils y auront à souffrir, des apprêts qu’on dresse pour cet effet, du détranchement de leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela se fait pour cette seule fin d’arracher de leur bouche parole molle ou rabaissée, ou de leur donner envie de s’enfuir, pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés, et d’avoir fait force à leur constance. Car aussi, à le bien prendre, c’est en ce seul point que consiste la vraie victoire. Montaigne
Etrange destinée, étrange préférence que celle de l’ethnographe, sinon de l’anthropologue, qui s’intéresse aux hommes des antipodes plutôt qu’à ses compatriotes, aux superstitions et aux mœurs les plus déconcertantes plutôt qu’aux siennes, comme si je ne sais quelle pudeur ou prudence l’en dissuadait au départ. Si je n’étais pas convaincu que les lumières de la psychanalyse sont fort douteuses, je me demanderais quel ressentiment se trouve sublimé dans cette fascination du lointain, étant bien entendu que refoulement et sublimation, loin d’entraîner de ma part quelque condamnation ou condescendance, me paraissent dans la plupart des cas authentiquement créateurs. (…) Peut-être cette sympathie fondamentale, indispensable pour le sérieux même du travail de l’ethnographe, celui-ci n’a-t-il aucun mal à l’acquérir. Il souffre plutôt d’un défaut symétrique de l’hostilité vulgaire que je relevais il y a un instant. Dès le début, Hérodote n’est pas avare d’éloges pour les Scythes, ni Tacite pour les Germains, dont il oppose complaisamment les vertus à la corruption impériale. Quoique évoque du Chiapas, Las Casas me semble plus occupé à défendre les Indiens qu’à les convertir. Il compare leur civilisation avec celle de l’antiquité gréco-latine et lui donne l’avantage. Les idoles, selon lui, résultent de l’obligation de recourir à des symboles communs à tous les fidèles. Quant aux sacrifices humains, explique-t-il, il ne convient pas de s’y opposer par la force, car ils témoignent de la grande et sincère piété des Mexicains qui, dans l’ignorance où ils se trouvent de la crucifixion du Sauveur, sont bien obligés de lui inventer un équivalent qui n’en soit pas indigne. Je ne pense pas que l’esprit missionnaire explique entièrement un parti-pris de compréhension, que rien ne rebute. La croyance au bon sauvage est peut-être congénitale de l’ethnologie. (…) Nous avons eu les oreilles rebattues de la sagesse des Chinois, inventant la poudre sans s’en servir que pour les feux d’artifice. Certes. Mais, d’une part l’Occident a connu lui aussi la poudre sans longtemps l’employer pour la guerre. Au IXe siècle, le Livre des Feux, de Marcus Graecus en contient déjà la formule ; il faudra attendre plusieurs centaines d’années pour son utilisation militaire, très exactement jusqu’à l’invention de la bombarde, qui permet d’en exploiter la puissance de déflagration. Quant aux Chinois, dès qu’ils ont connu les canons, ils en ont été acheteurs très empressés, avant qu’ils n’en fabriquent eux-mêmes, d’abord avec l’aide d’ingénieurs européens. Dans l’Afrique contemporaine, seule la pauvreté ralentit le remplacement du pilon par les appareils ménagers fabriqués à Saint-Étienne ou à Milan. Mais la misère n’interdit pas l’invasion des récipients en plastique au détriment des poteries et des vanneries traditionnelles. Les plus élégantes des coquettes Foulbé se vêtent de cotonnades imprimées venues des Pays-Bas ou du Japon. Le même phénomène se produit d’ailleurs de façon encore plus accélérée dans la civilisation scientifique et industrielle, béate d’admiration devant toute mécanique nouvelle et ordinateur à clignotants. (…) Je déplore autant qu’un autre la disparition progressive d’un tel capital d’art, de finesse, d’harmonie. Mais je suis tout aussi impuissant contre les avantages du béton et de l’électricité. Je ne me sens d’ailleurs pas le courage d’expliquer leur privilège à ceux qui en manquent. (…) Les indigènes ne se résignent pas à demeurer objets d’études et de musées, parfois habitants de réserves où l’on s’ingénie à les protéger du progrès. Étudiants, boursiers, ouvriers transplantés, ils n’ajoutent guère foi à l’éloquence des tentateurs, car ils en savent peu qui abandonnent leur civilisation pour cet état sauvage qu’ils louent avec effusion. Ils n’ignorent pas que ces savants sont venus les étudier avec sympathie, compréhension, admiration, qu’ils ont partagé leur vie. Mais la rancune leur suggère que leurs hôtes passagers étaient là d’abord pour écrire une thèse, pour conquérir un diplôme, puisqu’ils sont retournés enseigner à leurs élèves les coutumes étranges, « primitives », qu’ils avaient observées, et qu’ils ont retrouvé là-bas du même coup auto, téléphone, chauffage central, réfrigérateur, les mille commodités que la technique traîne après soi. Dès lors, comment ne pas être exaspéré d’entendre ces bons apôtres vanter les conditions de félicité rustique, d’équilibre et de sagesse simple que garantit l’analphabétisme ? Éveillées à des ambitions neuves, les générations qui étudient et qui naguère étaient étudiées, n’écoutent pas sans sarcasme ces discours flatteurs où ils croient reconnaître l’accent attendri des riches, quand ils expliquent aux pauvres que l’argent ne fait pas le bonheur, – encore moins, sans doute, ne le font les ressources de la civilisation industrielle. À d’autres. Roger Caillois (1974)
Le monde moderne n’est pas mauvais : à certains égards, il est bien trop bon. Il est rempli de vertus féroces et gâchées. Lorsqu’un dispositif religieux est brisé (comme le fut le christianisme pendant la Réforme), ce ne sont pas seulement les vices qui sont libérés. Les vices sont en effet libérés, et ils errent de par le monde en faisant des ravages ; mais les vertus le sont aussi, et elles errent plus férocement encore en faisant des ravages plus terribles. Le monde moderne est saturé des vieilles vertus chrétiennes virant à la folie. G.K. Chesterton
L’inauguration majestueuse de l’ère « post-chrétienne » est une plaisanterie. Nous sommes dans un ultra-christianisme caricatural qui essaie d’échapper à l’orbite judéo-chrétienne en « radicalisant » le souci des victimes dans un sens antichrétien. René Girard
Nous sommes encore proches de cette période des grandes expositions internationales qui regardait de façon utopique la mondialisation comme l’Exposition de Londres – la « Fameuse » dont parle Dostoievski, les expositions de Paris… Plus on s’approche de la vraie mondialisation plus on s’aperçoit que la non-différence ce n’est pas du tout la paix parmi les hommes mais ce peut être la rivalité mimétique la plus extravagante. On était encore dans cette idée selon laquelle on vivait dans le même monde: on n’est plus séparé par rien de ce qui séparait les hommes auparavant donc c’est forcément le paradis. Ce que voulait la Révolution française. Après la nuit du 4 août, plus de problème ! René Girard
Nous sommes entrés dans un mouvement qui est de l’ordre du religieux. Entrés dans la mécanique du sacrilège : la victime, dans nos sociétés, est entourée de l’aura du sacré. Du coup, l’écriture de l’histoire, la recherche universitaire, se retrouvent soumises à l’appréciation du législateur et du juge comme, autrefois, à celle de la Sorbonne ecclésiastique. Françoise Chandernagor
Malgré le titre général, en effet, dès l’article 1, seules la traite transatlantique et la traite qui, dans l’océan Indien, amena des Africains à l’île Maurice et à la Réunion sont considérées comme « crime contre l’humanité ». Ni la traite et l’esclavage arabes, ni la traite interafricaine, pourtant très importants et plus étalés dans le temps puisque certains ont duré jusque dans les années 1980 (au Mali et en Mauritanie par exemple), ne sont concernés. Le crime contre l’humanité qu’est l’esclavage est réduit, par la loi Taubira, à l’esclavage imposé par les Européens et à la traite transatlantique. (…) Faute d’avoir le droit de voter, comme les Parlements étrangers, des « résolutions », des voeux, bref des bonnes paroles, le Parlement français, lorsqu’il veut consoler ou faire plaisir, ne peut le faire que par la loi. (…) On a l’impression que la France se pose en gardienne de la mémoire universelle et qu’elle se repent, même à la place d’autrui, de tous les péchés du passé. Je ne sais si c’est la marque d’un orgueil excessif ou d’une excessive humilité mais, en tout cas, c’est excessif ! […] Ces lois, déjà votées ou proposées au Parlement, sont dangereuses parce qu’elles violent le droit et, parfois, l’histoire. La plupart d’entre elles, déjà, violent délibérément la Constitution, en particulier ses articles 34 et 37. (…) les parlementaires savent qu’ils violent la Constitution mais ils n’en ont cure. Pourquoi ? Parce que l’organe chargé de veiller au respect de la Constitution par le Parlement, c’est le Conseil constitutionnel. Or, qui peut le saisir ? Ni vous, ni moi : aucun citoyen, ni groupe de citoyens, aucun juge même, ne peut saisir le Conseil constitutionnel, et lui-même ne peut pas s’autosaisir. Il ne peut être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, les présidents des Assemblées ou 60 députés. (…) La liberté d’expression, c’est fragile, récent, et ce n’est pas total : il est nécessaire de pouvoir punir, le cas échéant, la diffamation et les injures raciales, les incitations à la haine, l’atteinte à la mémoire des morts, etc. Tout cela, dans la loi sur la presse de 1881 modifiée, était poursuivi et puni bien avant les lois mémorielles. Françoise Chandernagor
La tendance à légiférer sur le passé (…) est née des procédures lancées, dans les années 1970, contre d’anciens nazis et collaborateurs ayant participé à l’extermination des juifs. Celles-ci utilisaient pour la première fois l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, votée en 1964. Elles devaient aboutir aux procès Barbie, Touvier et Papon. (…) L’innovation juridique des « procès pour la mémoire » se justifiait, certes, par l’importance et la singularité du génocide des juifs, dont la signification n’est apparue que deux générations plus tard. Elle exprimait cependant un changement radical dans la place que nos sociétés assignent à l’histoire, dont on n’a pas fini de prendre la mesure. Ces procès ont soulevé la question de savoir si, un demi-siècle après, les juges étaient toujours « contemporains » des faits incriminés. Ils ont montré à quel point la culture de la mémoire avait pris le pas, non seulement sur les politiques de l’oubli qui émergent après une guerre ou une guerre civile, afin de permettre une reconstruction, mais aussi sur la connaissance historique elle-même. L’illusion est ici de croire que la « mémoire » fabrique de l’identité sociale, qu’elle donne accès à la connaissance. Comment peut-on se souvenir de ce que l’on ignore, les historiens ayant précisément pour fonction, non de « remémorer » des faits, des acteurs, des processus du passé, mais bien de les établir ? Dans le cas du génocide des juifs, dans celui des Arméniens ou dans le cas de la guerre d’Algérie, encore pouvons-nous avoir le sentiment que ces faits appartiennent toujours au temps présent — que l’on soit ou non favorable aux « repentances ». L’identification reste possible de victimes précises, directes ou indirectes, et de bourreaux singuliers, individus ou Etats, à qui l’on peut demander réparation. Mais comment peut-on prétendre agir de la même manière sur des faits vieux de plusieurs siècles ? Comment penser sérieusement que l’on peut « réparer » les dommages causés par la traite négrière « à partir du XVe siècle » de la même manière que les crimes nazis, dont certains bourreaux habitent encore au coin de la rue ? (…) Pourquoi (…) promulguer une loi à seule fin rétroactive s’il n’y a aucune possibilité d’identifier des bourreaux, encore moins de les traîner devant un tribunal ? Pourquoi devons-nous être à ce point tributaires d’un passé qui nous est aussi étranger ? Pourquoi cette volonté d’abolir la distance temporelle et de proclamer que les crimes d’il y a quatre siècles ont des effets encore opérants ? Pourquoi cette réduction de l’histoire à la seule dimension criminelle et mortifère ? Et comment croire que les valeurs de notre temps sont à ce point estimables qu’elles puissent ainsi s’appliquer à tout ce qui nous a précédés ? En réalité, la plupart de ces initiatives relèvent de la surenchère politique. Elles sont la conséquence de la place que la plupart des pays démocratiques ont accordée au souvenir de la Shoah, érigé en symbole universel de la lutte contre toutes les formes de racisme. A l’évidence, le caractère universel de la démarche échappe à beaucoup. La mémoire de la Shoah est ainsi devenue un modèle jalousé, donc, à la fois, récusé et imitable : d’où l’urgence de recourir à la notion anachronique de crime contre l’humanité pour des faits vieux de trois ou quatre cents ans. Le passé n’est ici qu’un substitut, une construction artificielle — et dangereuse —, puisque le groupe n’est plus défini par une filiation passée ou une condition sociale présente, mais par un lien « historique » élaboré après coup, pour isoler une nouvelle catégorie à offrir à la compassion publique. Enfin, cette faiblesse s’exprime, une fois de plus, par un recours paradoxal à l’Etat, voie habituelle, en France, pour donner consistance à une « communauté » au sein de la nation. Sommé d’assumer tous les méfaits du passé, l’Etat se retrouve en même temps source du crime et source de rédemption. Outre la contradiction, cette « continuité » semble dire que l’histoire ne serait qu’un bloc, la diversité et l’évolution des hommes et des idées, une simple vue de l’esprit, et l’Etat, le seul garant d’une nouvelle histoire officielle « vertueuse ». C’est là une conception pour le moins réactionnaire de la liberté et du progrès. Henry Rousso
La loi (…) portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés » risque, surtout en ses articles 1 et 4, de relancer une polémique dans laquelle les historiens ne se reconnaîtront guère. En officialisant le point de vue de groupes de mémoire liés à la colonisation, elle risque de générer en retour des simplismes symétriques, émanant de groupes de mémoire antagonistes, dont l' »histoire officielle » , telle que l’envisage cette loi, fait des exclus de l’histoire. Car, si les injonctions « colonialophiles » de la loi ne sont pas recevables, le discours victimisant ordinaire ne l’est pas davantage, ne serait-ce que parce qu’il permet commodément de mettre le mouchoir sur tant d’autres ignominies, actuelles ou anciennes, et qui ne sont pas forcément du ressort originel de l’impérialisme ou de ses formes historiques passées comme le(s) colonialisme(s). L’étude scientifique du passé ne peut se faire sous la coupe d’une victimisation et d’un culpabilisme corollaire. De ce point de vue, les débordements émotionnels portés par les »indigènes de la République » ne sont pas de mise. Des êtres humains ne sont pas responsables des ignominies commises par leurs ancêtres – ou alors il faudrait que les Allemands continuent éternellement à payer leur épisode nazi. C’est une chose d’analyser, par exemple, les « zoos humains » de la colonisation. C’en est une autre que de confondre dans la commisération culpabilisante le « divers historique », lequel ne se réduit pas à des clichés médiatiquement martelés. Si la colonisation fut ressentie par les colonisés dans le rejet et la douleur, elle fut aussi vécue par certains dans l’ouverture, pour le modèle de société qu’elle offrait pour sortir de l’étouffoir communautaire. (…)Les historiens doivent travailler à reconstruire les faits et à les porter à la connaissance du public. Or ces faits établissent que la traite des esclaves, dans laquelle des Européens ont été impliqués (et encore, pas eux seuls), a porté sur environ 11 millions de personnes (27,5 % des 40 millions d’esclaves déportés), et que les trafiquants arabes s’y sont taillé la part du lion : la »traite orientale » fut responsable de la déportation de 17 millions de personnes (42,5 % d’entre eux) et la traite « interne » effectuée à l’intérieur de l’Afrique, porta, elle, sur 12 millions (30 %). Cela, ni Dieudonné ni les « Indigènes » , dans leur texte victimisant à sens unique, ne le disent – même si, à l’évidence, la traite européenne fut plus concentrée dans le temps et plus rentable en termes de nombre de déportés par an. (…) L’historien ne se reconnaît pas dans l’affrontement des mémoires. Pour lui, elles ne sont que des documents historiques, à traiter comme tels. Il ne se reconnaît pas dans l’anachronisme, qui veut tout arrimer au passé ; il ne se reconnaît pas dans le manichéisme, qu’il provienne de la »nostalgérie » électoraliste vulgaire qui a présidé à la loi du 23 février 2005, ou qu’il provienne des simplismes symétriques qui surfent sur les duretés du présent pour emboucher les trompettes agressives d’un ressentiment déconnecté de son objet réel. Gilbert Meynier
L’énigmatique Martin Couney a présenté des bébés prématurés dans des couveuses aux foules du début du XXe siècle sur les trottoirs de Coney Island et d’Atlantic City, ainsi que lors d’expositions organisées dans tous les États-Unis. Immigrant d’origine prussienne établi sur la côte Est, Couney n’avait pas de diplôme de médecine mais se disait médecin. Ses expositions de couveuses aux aboiements de carnaval ont en fait sauvé la vie d’environ 7 000 bébés prématurés. Ces minuscules nourrissons seraient morts sans l’intervention théâtrale de Couney, mais ils sont devenus adultes, ont eu des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et ont vécu jusqu’à 70, 80 et 90 ans. Cette histoire extraordinaire en dit long sur la néonatologie et sur la vie. (…) S’appuyant sur d’extraordinaires recherches dans les archives ainsi que sur des entretiens, le récit [de Raffel] est enrichi par ses propres réflexions, alors qu’elle se demandait comment Couney avait pu sauver ces prématurés tout en réussissant à gagner sa vie en les exhibant comme de petits monstres devant les foules qui venaient les voir. Le travail de Couney avec les prématurés a commencé en Europe, en tant qu’aboyeur de carnaval lors d’une exposition de couveuses. C’est là qu’il est tombé amoureux des prématurés et qu’il a rencontré son infirmière en chef, Louise Recht. Pourtant, même en tenant compte de son affection évidente, faire de l’incubation des prématurés un spectacle public semble relever de l’exploitation. Mais était-ce le cas ? Au XXIe siècle, les couveuses et les unités de soins intensifs néonatals sont considérées comme allant de soi, mais il y a plus de cent ans, les couveuses étaient rarement utilisées dans les hôpitaux, et elles faisaient parfois plus de mal que de bien. Les prématurés devenaient souvent aveugles à cause de la trop grande quantité d’oxygène pompée dans les couveuses (Raffel note que Stevie Wonder, lui-même prématuré, a perdu la vue de cette manière). Pourtant, les prématurés dont s’occupaient Couney et ses infirmières – sa femme Maye, sa fille Hildegard et l’infirmière en chef Louise, connue dans l’émission sous le nom de « Madame Recht » – conservaient leur vision. La raison ? Couney était suffisamment préoccupé par ce problème pour utiliser des couveuses mises au point par M. Alexandre Lion en France, qui régulaient le flux d’oxygène. Aujourd’hui, il est largement admis que tout bébé – prématuré ou né à terme – doit être sauvé. Ce n’était pas le cas à l’époque de Couney. Les prématurés étaient qualifiés de « faibles » et certains médecins pensaient même que leur vie ne valait pas la peine d’être sauvée. Si le récit de Mme Raffel est une source d’inspiration, il est également horrible. Elle n’hésite pas à parler de personnes comme le docteur Harry Haiselden qui, contrairement à Couney, était un véritable médecin, mais qui « refusait de sauver la vie de nourrissons qu’il jugeait « défectueux », les regardant délibérément mourir alors qu’ils auraient pu vivre ». (…) Il est vrai qu’il était un homme de spectacle et que, pendant la majeure partie de sa carrière, il a bien gagné sa vie grâce à son spectacle de bébés en couveuse, mais Couney, un homme élégant qui parlait couramment l’allemand, le français et l’anglais, n’exploitait pas ses prématurés (Hildegard était elle aussi une prématurée). Il leur donnait une chance de vivre une vie qu’ils n’auraient peut-être pas eu le droit de vivre. Couney s’est servi de son sens du spectacle pour soutenir toutes ces actions de sauvetage. Il organisait des spectacles pour les foules de la promenade, mais aussi, bien qu’il n’ait pas de diplôme de médecine, il entretenait ses couveuses selon des normes médicales rigoureuses. À bien des égards, les pratiques de Couney étaient incroyablement avancées. Les bébés étaient nourris exclusivement au lait maternel, les infirmières leur prodiguaient fréquemment des soins affectueux, et les bébés étaient tenus, changés et baignés. (…) Pourtant, les efforts des infirmières du Dr Couney ont été largement ignorés par le corps médical et n’ont été mentionnés qu’une seule fois dans une revue médicale. Comme l’écrit Raffel dans la dernière page de son livre, « rien sur sa tombe n’indique que [Martin Couney] ait fait quoi que ce soit d’important ». Il en va de même pour Maye, Louise et Hildegard. Le nom de Louise a été mal orthographié sur sa pierre tombale commune (les restes de Louise sont enterrés dans la crypte d’une autre famille), et Hildegard, dont les restes sont enterrés avec ceux de Louise, n’a même pas eu son propre nom gravé sur la pierre tombale commune. À l’exception du Dr Julius Hess de Chicago, considéré comme le père de la néonatologie, la majorité de l’establishment médical a traité Couney avec condescendance et l’a exclu. Dans la préface de son livre Premature and Congenitally Diseased Infants, Hess remercie Couney « pour ses nombreuses suggestions utiles dans la préparation du matériel de ce livre ». Mais Couney se souciait davantage des bébés que du respect professionnel. Il a fait preuve d’une détermination sans faille : même lorsque cela l’a financièrement déstabilisé, il a persisté, afin que ses bébés prématurés puissent vivre. National Book Review
Carl Hagenbeck a eu l’idée d’ouvrir des zoos remplis non seulement d’animaux, mais aussi d’êtres humains. Les gens étaient ravis de découvrir des êtres humains venus d’ailleurs : Avant l’arrivée de la télévision et de la photographie en couleur, c’était leur seul moyen de les voir. Anne Dreesbach
La principale caractéristique de ces variétés multiformes de spectacles publics, qui se sont répandues à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, est la présence en direct d’individus considérés comme « primitifs ». Si ces peuples indigènes font parfois des démonstrations de leur savoir-faire ou fabriquent des objets pour le public, leur rôle est le plus souvent de montrer leur corps et leurs gestes, leur condition différente et singulière. Cet article présente les trois principales formes de spectacle ethnique moderne (commercial, colonial et missionnaire) et met en garde contre l’inadéquation de la classification de tous ces spectacles sous l’étiquette de « zoos humains », terme qui s’est répandu ces dernières années dans les milieux académiques et médiatiques. Luis A. Sánchez-Gómez
Entre le 29 novembre 2011 et le 3 juin 2012, le musée du quai de Branly à Paris a présenté une exposition extraordinaire, au titre accrocheur : Exhibitions. L’invention du sauvage, qui a eu un impact social et médiatique considérable. Ses « commissaires scientifiques » étaient l’historien Pascal Blanchard et la conservatrice du musée Nanette Jacomijn Snoep, l’ancien footballeur Lilian Thuram, né en Guadeloupe, faisant office de « commissaire général ». Sportif populaire, Lilian Thuram est également connu en France pour son engagement social et politique. L’exposition était l’aboutissement (mais probablement pas le point final) d’un projet réussi qui avait commencé à Marseille en 2001 avec la conférence intitulée Mémoire coloniale : zoos humains ? Corps exotiques, corps enfermés, corps mesurés. Au fil du temps, les publications successives des communications présentées lors de cette première rencontre ont donné lieu à une véritable saga éditoriale, comprenant à ce jour trois éditions en français, une en italien, une en anglais et une en allemand. Ce remarquable répertoire est complété par l’impressionnant catalogue de l’exposition. Tous les titres des ouvrages (à l’exception du catalogue) font référence aux « zoos humains » comme objet d’étude, mais dans aucun d’entre eux les mots ne sont suivis d’un point d’interrogation, comme c’était le cas lors de la conférence de Marseille. Cela semble définir les « zoos humains » comme un phénomène bien documenté, dont l’essence est bien établie. Plus important encore, malgré la réitération du concept, ni le catalogue de l’exposition, ni les textes rédigés par les autorités éditoriales de l’exposition ne donnent une définition précise de ce que l’on entend par « zoo humain ». Néanmoins, les rédacteurs semblent accepter le concept comme applicable à toutes les formes de spectacles publics présentés dans l’exposition, qui semblent tous avoir été conçus avec un mépris commun et une exclusion de l' »autre ». L’appellation « zoo humain » s’applique donc implicitement à une variété de spectacles dont l’objectif commun était la présentation publique d’êtres humains, dans le seul but de montrer leur condition morphologique ou ethnique particulière. La typologie des événements et l’état des individus présentés varient considérablement : cela va de la présentation (généralement individuelle) de personnes atteintes de pathologies invalidantes (monstres exotiques ou plus souvent domestiques) à des conditions physiques singulières (géants, nains ou individus extrêmement obèses) ou à la présentation d’individus, de familles ou de groupes de peuples exotiques ou de sauvages, arrivés ou plus souvent ramenés de colonies lointaines. L’objectif de la conférence de 2001 était de présenter les informations disponibles sur ces spectacles, d’encourager leur étude dans une perspective académique et, surtout, de dénoncer publiquement ces contextes matériels et symboliques de domination et de stigmatisation, qui auraient joué un rôle prépondérant dans les mécanismes complexes et denses d’animalisation des peuples colonisés par l' »Occident civilisé ». Un projet scientifique et éditorial guidé par de telles intentions ne pouvait manquer d’être largement soutenu par les milieux académiques, sociaux et journalistiques. Les critiques du texte original de 2002 et des éditions successives ont été, pour la plupart, très positives, et les éloges de ce qui fut certainement une exposition extraordinaire (celle de 2012) ont été encore plus unanimes. Cependant, la plupart des commentateurs se sont contentés de louer l’important contenu antiraciste et les critiques de l’héritage colonial, qui sont communs aux deux entreprises. Seuls quelques auteurs ont attiré l’attention sur certains problèmes conceptuels et interprétatifs de l’objet d’étude présumé, les « zoos humains », problèmes qui mineraient la solidité du projet. (…) Bien que l’exposition publique d’êtres humains remonte loin dans l’histoire, dans des contextes très divers (guerres, funérailles et contextes sacrés, prisons, foires, etc.), la configuration et l’expansion des différentes variétés de spectacles ethniques sont étroitement et directement liées à deux phénomènes historiques qui sont à la base même de la modernité : l’exposition et le colonialisme. Les premières sont apparues à l’occasion de concours et de compétitions nationales (industrielles et agricoles). Elles sont organisées dans certains pays européens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais ce n’est qu’au siècle suivant qu’elles acquièrent des dimensions matérielles et symboliques nouvelles et choquantes, sous la forme de l’exposition internationale ou universelle. La date clé est 1851, lorsque se tient à Londres la Grande Exposition des travaux de l’industrie de toutes les nations. Le triomphe de l’événement londonien, son succès rapide et continu en France et la participation croissante (qui sera soulignée) des peuples indigènes des colonies, ouvrent la voie à partir des années 1880 à un nouveau modèle d’exposition : l’exposition coloniale (officielle ou privée, nationale ou internationale) qui met presque toujours en scène la présence d’êtres humains indigènes. Cependant, des expositions moins spectaculaires avaient déjà été organisées à plus petite échelle depuis de nombreuses années, depuis le milieu du XIXe siècle environ. Certaines de ces manifestations étaient vraiment impressionnantes et, dans certains cas, mettaient également en scène des peuples indigènes. Il s’agit des premières expositions missionnaires (ou ethnologiques-missionnaires), qui étaient à l’origine principalement britanniques et protestantes, mais aussi catholiques par la suite. Enfin, les expositions ethnologiques peu sophistiquées, typiques de l’Angleterre (en particulier de Londres) au début du XIXe siècle, ont subi une transformation progressive à partir du milieu du siècle et sont devenues la forme la plus populaire d’exposition ethnologique commerciale. Ces changements ont d’abord été influencés par les expositions humaines du célèbre impresario de cirque américain P.T. Barnum. Plus tard, à partir de 1874, les expositions de Barnum ont été réinterprétées avec succès (par l’incorporation d’animaux sauvages et de groupes d’individus exotiques) par Carl Hagenbeck. Le deuxième facteur qui a joué un rôle décisif dans la formation de l’exposition ethnique moderne a été le colonialisme impérial, qui a pris de l’ampleur à partir des années 1870. L’effet propagandiste de l’impérialisme a été facilité par deux disciplines scientifiques émergentes, l’anthropologie physique et l’ethnologie, qui ont propagé les images et les mystifications coloniales au sein de la population métropolitaine. Ce phénomène, associé aux nouveaux niveaux de consommation de la bourgeoisie et des couches supérieures des classes ouvrières, a eu un impact plus important sur notre sujet que les conséquences économiques et géostratégiques de l’impérialisme à l’étranger. En effet, le nouveau contexte d’expansion géopolitique, scientifique et économique a transformé les anciens « mystérieux sauvages » en un objet d’étude relativement accessible pour certains secteurs de la société. Quelle que soit la quantité d’écrits sur leurs modes de vie exotiques ou leurs étranges croyances religieuses, le public en voulait toujours plus : il cherchait à participer à des rencontres plus « intenses » et plus « vraies » et à sentir qu’il faisait partie de ce réseau de forces (politiques, économiques, militaires, académiques et religieuses) qui gouvernait même les coins les plus reculés du monde et ses habitants les plus primitifs. C’est précisément la convergence de ce réseau d’intérêts et d’opportunités au sein du nouvel univers d’exposition qui s’était déjà consolidé à la fin des années 1870 et qui allait devenir le facteur déterminant de la transition. Du modèle plus ancien et populaire d’expositions humaines qui avait dominé jusqu’alors, on assiste à une réduction du nombre d’expositions d’individus isolés qualifiés d’étranges, de monstrueux ou simplement d’exotiques, au profit d’expositions adéquatement mises en scène de familles et de groupes de peuples considérés comme sauvages ou primitifs, authentiques exemples vivants de l’humanité d’une époque révolue. Bien entendu, ce nouvel intérêt, ce nouveau désir de voir et de sentir « l’autre » a été encouragé non seulement par les impresarios des expositions, mais aussi par les industriels et les marchands qui faisaient du commerce avec les colonies, par les administrateurs coloniaux et les sociétés missionnaires. Le processus est à son tour stimulé par la réaction très positive du public, qui en redemande : plus d’exotisme, plus de produits coloniaux, plus de missions civilisatrices, plus de conversions, plus de populations indigènes soumises au pouvoir de l’homme blanc ; en fin de compte, plus de spectacle. Malgré les différences que l’on peut observer dans le catalogue des expositions, leur succès repose en grande partie sur un seul facteur : la représentation ou l’exposition d’êtres humains qualifiés d’exotiques ou de sauvages, ce qui, aujourd’hui, nous dérange et nous répugne. Il n’est donc pas surprenant que la plupart, sinon la totalité, des visiteurs de l’exposition du musée du quai de Branly en 2012 aient réagi aux spectacles ethniques par une question fondamentale : comment est-il possible que des spectacles aussi répugnants aient été organisés ? Si beaucoup répondront simplement par deux mots, domination et racisme, la question est certainement plus complexe. Pour y répondre, nous étudierons le contenu et les significations des trois principaux modèles ou variétés de spectacles ethniques modernes – les expositions ethnologiques commerciales, les expositions coloniales et les expositions missionnaires. (…) L’opposition que les sociétés missionnaires ont rencontrée dans les expositions internationales du XIXe siècle les a incitées à organiser leurs propres manifestations. Les premières manifestations missionnaires autonomes étaient protestantes et ont probablement eu lieu avant 1851. En tout cas, il est confirmé que c’est l’année où la Methodist Wesleyan Missionary Society a organisé une exposition missionnaire (qui s’est tenue en même temps que l’Exposition internationale). De petite taille et de structure très simple, elle n’a duré que deux jours au cours du mois de juin, mais elle a offert l’occasion extraordinaire de voir et d’acquérir des coquillages, des coraux et du matériel ethnographique varié (y compris des idoles) en provenance des Tonga et des Fidji. Qu’elles aient été ou non directement influencées par l’événement international de 1851, les modestes expositions missionnaires britanniques du milieu du XIXe siècle ont commencé à évoluer rapidement à partir des années 1870, pour atteindre des proportions véritablement spectaculaires dans le premier tiers du XXe siècle. Cet énorme succès est dû à un ensemble de circonstances particulières qui ne s’appliquent pas à la sphère catholique. D’une part, les expositions constituent une formidable source de propagande et, d’autre part, elles génèrent des rentrées d’argent directes et immédiates. Ceci est significatif si l’on considère que les sociétés et comités ecclésiastiques protestants ne dépendaient pas de l’administration civile, ni n’y étaient liés (du moins pas directement ou officiellement), et que la quasi-totalité des recettes provenait des contributions personnelles des fidèles. D’autre part, comme les protestants organisaient leurs propres manifestations, ils n’avaient aucune raison de participer aux expositions coloniales officielles, auxquelles les missions catholiques étaient régulièrement associées une fois que les anciens préjugés du gouvernement étaient tombés dans les dernières années du dix-neuvième siècle. De cette manière, les communautés évangéliques ont pu maintenir leur indépendance par rapport à l’entreprise impériale, sans pour autant s’interdire de collaborer avec elle lorsque c’était dans leur intérêt. Cependant, qu’elles soient catholiques ou protestantes, les expositions missionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle se caractérisent principalement par leur intention ethnologique. Les objets ethnographiques des peuples convertis (et de ceux qui ne l’étaient pas encore) étaient remarquables par leur exotisme et leur rareté, et constituaient un véritable pôle d’attraction pour le public. Ils étaient également censés constituer une preuve irréfutable de la nature « arriérée », voire « dépravée » de ces peuples, qui devaient être libérés par les missions rédemptrices que tous les chrétiens étaient censés soutenir spirituellement et financièrement. Mais comme les goûts changent et que le public commence à se désintéresser, les expositions commencent à prendre de l’ampleur et à se complexifier, et à présenter de plus en plus de nouvelles attractions, telles que des dioramas et des sculptures de groupes indigènes. Enfin, les plus sophistiquées d’entre elles commencèrent à inclure les indigènes eux-mêmes dans le spectacle. Il faut dire qu’à de rares exceptions près, il ne s’agissait pas d’expositions dans le style des célèbres Völkerschauen allemands ou des expositions ethnologiques britanniques, mais de simples représentations ; en effet, les « invités » étaient déjà baptisés, chrétiens, et prétendument prêts à collaborer avec leurs bienfaiteurs. Alors que les églises protestantes (britanniques et nord-américaines) ont produit des représentations de peuples indigènes avec la plus grande fréquence et intensité, c’est (pour autant que nous le sachions) l’église catholique (italienne) qui a eu l’honneur douteux d’être la première à montrer des indigènes dans une exposition missionnaire, et ce d’une manière clairement sauvage et rudimentaire, que l’on pourrait même qualifier de brutale. Cela s’est produit dans la section religieuse de l’exposition italo-américaine de Gênes en 1892. En complément des collections ethnographiques et missionnaires habituelles, sept indigènes sont exposés devant le public : quatre Fuégiens et trois Mapuches des deux sexes (enfants, jeunes et adultes) ramenés d’Amérique par les missionnaires. Les Fuégiens, vêtus uniquement de peaux et armés d’arcs et de flèches, passaient leur temps à l’intérieur d’une hutte faite de branches qui avait été construite dans le jardin du pavillon abritant l’exposition missionnaire. Les Mapuches étaient deux jeunes filles et un homme ; ils vivaient tous les trois à l’intérieur d’une autre hutte, où ils fabriquaient des objets artisanaux sous l’œil attentif de leurs gardiens. L’exposition semble avoir connu un grand succès, mais il devait être évident que le modèle était trop simple dans son concept, et inhumain dans son approche des peuples indigènes présents. En effet, si les expositions suivantes ont également présenté une présence indigène (toujours christianisée) à l’invitation du clergé, l’Église catholique n’est plus jamais tombée dans une présentation et une représentation aussi grossières du mode de vie obsolète et sauvage de ses convertis. Pour illustrer cette époque, aujourd’hui heureusement dépassée par l’entreprise missionnaire, les congrégations catholiques avaient recours à des dioramas et à des sculptures, dont certaines étaient d’une superbe qualité technique et artistique. Bien que l’Église catholique ait peut-être organisé la première exposition missionnaire vivante, il ne faut pas oublier qu’elle a rejoint la sphère des expositions bien plus tard que les Églises évangéliques. En outre, un nombre considérable de leurs expositions étaient associées à des événements coloniaux, ce que les églises protestantes évitaient. (…) Si ce sont les églises réformées qui intègrent le plus facilement la participation des autochtones, elles semblent le faire d’une manière plus sensible et moins brutale que l’exposition catholique génoise de 1892. (…) Le modèle d’exposition de ces événements protestants du début du vingtième siècle était très similaire au modèle colonial. Des villages indigènes étaient reconstitués et des collections ethnographiques étaient présentées, ainsi que des exemples de la flore et de la faune locales et, bien sûr, une abondance d’informations sur le travail missionnaire, dont les aspects évangélisateurs, éducatifs, médicaux et sociaux étaient présentés. Certaines de ces expositions étaient tout aussi attrayantes pour le public (indépendamment de ses croyances religieuses) que les expositions coloniales ou commerciales contemporaines. Toutefois, il convient de noter que la participation des indigènes christianisés avait une forme radicalement différente de celle du monde colonial et commercial. Les plus aptes et ceux qui maîtrisaient l’anglais servaient de guides dans les sections correspondant à leur lieu d’origine, tâche qu’ils accomplissaient généralement en vêtements traditionnels. Plus fréquemment, ces nouveaux chrétiens assument des rôles moins importants, comme la fabrication d’objets artisanaux, la vente d’objets exotiques ou la reconstitution de certains aspects de leur mode de vie antérieur. Les organisateurs justifiaient leur présence en affirmant qu’ils n’étaient que des acteurs, représentant leur mode de vie sauvage aujourd’hui oublié. Cela a pu être le cas. Dans les expositions protestantes des années 1920 et 1930, la présence des indigènes s’est progressivement raréfiée jusqu’à disparaître. Malgré cela, les organisateurs ont bénéficié d’une ressource vivante qui complétait les présentations de matériel ethnographique tout en étant plus attrayante pour le public que les dioramas habituels. Il s’agissait d’une représentation théâtrale du mode de vie des autochtones (combinée à des scènes d’interaction avec les missionnaires) par des volontaires blancs (hommes et femmes) qui étaient dûment maquillés et qui, dans certains cas, apparaissaient aux côtés de véritables autochtones. Certaines de ces représentations étaient courtes, d’autres comportaient plusieurs actes et mettaient en scène des dizaines de personnages. Depuis les années 1960, l’exposition missionnaire chrétienne (protestante et catholique) se déroule selon des modalités très différentes de celles qui ont été évoquées ici. Elle renonce définitivement à toute association directe ou indirecte avec le colonialisme, rompt avec les interprétations raciales ou ethnologiques des peuples convertis, et défend fermement sa prétendue autonomie par rapport à tout groupe ou intérêt politique, sans oublier que l’essence de l’évangélisation est de maximiser la visibilité de son action éducative et caritative auprès des plus défavorisés. (…) Les trois catégories les plus importantes de spectacles ethniques modernes – les expositions ethnologiques commerciales, les expositions coloniales et les expositions missionnaires – ont été examinées. Toutes trois ont eu recours, à des degrés divers, à l’exhibition d’êtres humains exotiques afin de capter l’attention de leur public et, en fin de compte, d’atteindre certains objectifs : succès commercial et enrichissement personnel, soutien social, politique ou financier de l’entreprise coloniale, ou soutien de l’œuvre missionnaire. Bien qu’ils aient parfois coïncidé au même moment et dans le même contexte de représentation, le caractère unique de chaque forme d’exposition a été souligné. Cependant, cela ne signifie pas qu’il s’agit de phénomènes complètement distincts, ou que leur représentation de l' »altérité » exotique est homogène. Les expositions missionnaires présentent peut-être les traits les plus singuliers en raison de leur vision spirituelle. Cependant, il est clair que beaucoup s’efforcent de produire des spectacles directs, visuels et émotionnels et que certains, ce faisant, ont recours à des représentations d’indigènes très similaires à celles des expositions coloniales. Peut-on alors parler d’une convergence de conceptions et d’intérêts ? Franchement, je ne le pense pas. Dans de nombreuses expositions coloniales, les organisateurs manifestent clairement leur intention de présenter les indigènes comme des individus redoutables et sauvages (parfois même décrits comme des cannibales) qu’il fallait en quelque sorte soumettre. Des peuples plus ou moins civilisés sont également présentés (comme lors des expositions de l’entre-deux-guerres). Cependant, il s’agit souvent de faire connaître le succès de l’entreprise coloniale dans sa campagne de « domestication du sauvage », plutôt que de présenter un message d’humanisme ou de fraternité universelle. Les expositions missionnaires fournissaient des informations et des exemples matériels de l’ancien mode de vie des convertis, dans lesquels les indigènes montraient qu’ils avaient abandonné leur condition de sauvages et participaient à l’exposition pour la plus grande gloire de la mission d’évangélisation. En outre, ils devenaient la preuve vivante que quelque chose de bien plus transcendant que n’importe quel processus de civilisation était en train de se produire : qu’une fois baptisé, n’importe qui, aussi sauvage qu’il ait été, pouvait faire partie de la même famille chrétienne universelle. Il est certainement vrai que les spectacles auxquels le public assistait dans toutes ces expositions (qu’elles soient missionnaires, coloniales ou même commerciales) étaient très similaires. Cependant, dans le cas des premières, l’acte d’exposition s’inscrit dans un contexte nettement plus humanitaire que dans les autres. Et s’il est évident que les cultures et les peuples indigènes sont manipulés dans leur représentation lors des expositions missionnaires, cela ne signifie pas que l’indigène exposé n’est qu’un élément passif du jeu. Et ce n’est pas tout. Les qualités dominantes et spectaculaires présentes dans presque toutes les expositions missionnaires ne doivent pas nous faire oublier un dernier facteur qui a été essentiel à leur conception, à leur développement et même à leur longévité : la foi chrétienne. Sans la foi chrétienne, il n’y aurait pas eu d’expositions missionnaires, et si quelque chose de semblable avait été organisé, cela n’aurait pas eu la même signification. Il était essentiel qu’une foi chrétienne authentique existe au sein de la hiérarchie ecclésiastique et des responsables des congrégations, des sociétés missionnaires et des comités. Mais la foi qui a vraiment rendu les expositions possibles, c’est la foi des missionnaires, des autres personnes impliquées dans leur mise en œuvre et, bien sûr, de ceux qui les ont visitées. Bien qu’elle n’ait jamais été reconnue comme telle, il s’agissait peut-être d’une foi non critique, complaisante dans son acceptation des modes de représentation de la diversité humaine et avec des valeurs éthiques qui s’approchaient parfois des limites de la morale chrétienne. Mais il s’agissait néanmoins d’une foi, une foi qui s’intensifiait et grandissait à chaque exposition, qui alimentait certainement à la fois la religiosité chrétienne (catholique et protestante) et au moins plusieurs années d’entreprises missionnaires, des années cruciales pour l’expansionnisme impérialiste de l’Occident. C’est un fait objectif que la présentation d’êtres humains dans les expositions commerciales et coloniales a toujours été beaucoup plus explicite et dégradante que dans n’importe quelle exposition missionnaire. Pour dire plus clairement ce qui vient d’être proposé : les expositions missionnaires n’étaient pas des « zoos humains ». Le principal obstacle analytique à l’utilisation de l’expression « zoo humain » est qu’elle associe immédiatement et directement tous ces actes et contextes à l’idée d’un zoo du XIXe siècle. Les images d’animaux en cage, grognant et hurlant, peuvent susciter l’admiration, mais aussi le dégoût ; elles peuvent parfois inspirer de la tendresse, mais sont surtout à éviter et à craindre en raison de leur condition sauvage et bestiale. C’était bien le cas pour les organisateurs du projet scientifique et éditorial cité au début de cet article, et il n’est donc pas étonnant que les expositions conjointes d’animaux et de peuples exotiques de Carl Hagenbeck aient été choisies comme cadre de référence pour les zoos humains. Si les auteurs affirment dans la première édition que « le zoo humain n’est pas l’exhibition de la sauvagerie, mais la construction de celle-ci », le problème, comme le souligne Blanckaert (2002), est que cette prétendue construction ou structure d’exposition n’était pas présente dans la plupart des expositions étudiées, ni (et c’est un ajout de ma part) dans celles qui ont été montrées aux Expositions. En effet, l’expression « zoo humain » établit un modèle qui ne cadre pas avec le maigre nombre d’expositions d’individus exotiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, ni avec celle de Saartjie Baartmann (la Vénus hottentote) du début du XIXe siècle, et encore moins avec les « freak shows » du XXe siècle. En outre, ce modèle ne peut être comparé ni à la plupart des expositions ethnologiques humaines britanniques du XIXe siècle, ni à la plupart des villages indigènes des expositions coloniales, ni au Wild West show de Buffalo Bill, et encore moins aux villages ruralistes-traditionalistes qui ont été installés dans de nombreuses expositions nationales et internationales jusqu’à la période de l’entre-deux-guerres. Enfin, leur lien avec de nombreux « villages noirs » ou « villages indigènes » itinérants exposés par des imprésarios à la fin du XIXe siècle pourrait également être contesté. En outre, de nombreuses expositions organisées par Hagenbeck comptent parmi les plus professionnelles de l’univers de l’exposition. Le fait qu’ils aient eu lieu dans des zoos ne devrait pas automatiquement impliquer que les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés étaient plus brutales ou exploitantes que celles de n’importe lequel des autres spectacles ethniques. Il est évident, d’après tous les spectacles qui ont été examinés, que la condition raciale différentielle des personnes exposées a non seulement constitué la base de leur exposition, mais a également pu favoriser et même fonder les réactions et les attitudes racistes du public. Cependant, de nombreux autres facteurs (politiques, économiques et même esthétiques) entrent en jeu et ont à peine été pris en compte, qui pourraient être considérés comme encourageant l’admiration des expositions de corps, de gestes, de compétences, de créations et de connaissances qui étaient perçus comme exotiques et séduisants. En fait, l’utilisation indiscriminée du concept très réussi de « zoo humain » génère deux problèmes fondamentaux. D’une part, il entrave la connaissance « réelle » de l’objet d’étude lui-même, c’est-à-dire des spectacles ethniques très variés qu’il entend répertorier, étant donné la grande diversité de contextes, de formats, de responsables, d’objectifs et de matérialisations qu’offrent de telles entreprises. Deuxièmement, l’image du zoo recrée inévitablement l’idée d’une exposition purement animale, où le seul rapport est celui qui existe entre l’exposant et l’exposé : la domination complète des seconds (des bêtes irrationnelles) par les premiers (des êtres rationnels). Si l’on admet que les exhibés sont traités simplement comme des animaux plus ou moins dignes d’intérêt, les conséquences sont doubles : un rejet logique de ces spectacles passés, présents et futurs, et la visualisation des exhibés comme des victimes passives du racisme et du capitalisme en Occident. Il n’est donc pas surprenant que la recherche ne tienne guère compte du rôle que ces personnes ont pu jouer, de la mesure dans laquelle leur participation au spectacle était volontaire et des intérêts qui ont pu pousser certaines d’entre elles à prendre part à ces spectacles. Enfin, aucune évaluation n’a été faite de la manière dont ces expositions ont pu constituer des « contextes d’opportunité » pour les personnes exposées, qu’il s’agisse d’expositions commerciales, coloniales ou missionnaires. S’il est vrai que la voix des personnes exposées est la plus difficile à enregistrer dans l’une ou l’autre de ces expositions, des efforts plus importants auraient pu être faits pour l’identifier et la cartographier, car lorsque cela se produit, les résultats obtenus sont vraiment intéressants. Avant de conclure, il convient de préciser que l’analyse proposée n’a pas pour but d’adoucir ou de justifier le phénomène du spectacle ethnique. Même dans les cas les moins dramatiques et exploités, il est évident que l’essence de ces spectacles est une inégalité marquée, dans laquelle chaque supposé « contexte d’interaction » établit une relation dichotomique entre Noirs et Blancs, Nord et Sud, colonisateurs et colonisés et, en fin de compte, entre dominateurs et dominés. Mon intention a été de proposer une approche plus ou moins classificatrice et clarificatrice de ce monde varié des expositions humaines, de faire un inventaire de base de leurs formes de représentation et de déterminer quels sont les traits essentiels qui les définissent, sans perdre de vue les facteurs contingents sur lesquels elles s’appuient. Luis A. Sánchez-Gómez
Une théorie du complot (on parle aussi de conspirationnisme ou de complotisme) est un récit pseudo-scientifique, interprétant des faits réels comme étant le résultat de l’action d’un groupe caché, qui agirait secrètement et illégalement pour modifier le cours des événements en sa faveur, et au détriment de l’intérêt public. Incapable de faire la démonstration rigoureuse de ce qu’elle avance, la théorie du complot accuse ceux qui la remettent en cause d’être les complices de ce groupe caché. Elle contribue à semer la confusion, la désinformation, et la haine contre les individus ou groupes d’individus qu’elle stigmatise. (…) Derrière chaque actualité ayant des causes accidentelles ou naturelles (mort ou suicide d’une personnalité, crash d’avion, catastrophe naturelle, crise économique…), la théorie du complot cherche un ou des organisateurs secrets (gouvernement, communauté juive, francs-maçons…) qui auraient manipulé les événements dans l’ombre pour servir leurs intérêts : l’explication rationnelle ne suffit jamais. Et même si les événements ont une cause intentionnelle et des acteurs évidents (attentat, assassinat, révolution, guerre, coup d’État…), la théorie du complot va chercher à démontrer que cela a en réalité profité à un AUTRE groupe caché. C’est la méthode du bouc émissaire. (…) La théorie du complot voit les indices de celui-ci partout où vous ne les voyez pas, comme si les comploteurs laissaient volontairement des traces, visibles des seuls « initiés ». Messages cachés sur des paquets de cigarettes, visage du diable aperçu dans la fumée du World Trade Center, parcours de la manifestation Charlie Hebdo qui dessinerait la carte d’Israël… Tout devient prétexte à interprétation, sans preuve autre que l’imagination de celui qui croit découvrir ces symboles cachés. Comme le disait une série célèbre : « I want to believe ! » (…) La théorie du complot a le doute sélectif : elle critique systématiquement l’information émanant des autorités publiques ou scientifiques, tout en s’appuyant sur des certitudes ou des paroles « d’experts » qu’elle refuse de questionner. De même, pour expliquer un événement, elle monte en épingle des éléments secondaires en leur conférant une importance qu’ils n’ont pas, tout en écartant les éléments susceptibles de contrarier la thèse du complot. Son doute est à géométrie variable. (…) La théorie du complot tend à mélanger des faits et des spéculations sans distinguer entre les deux. Dans les « explications » qu’elle apporte aux événements, des éléments parfaitement avérés sont noués avec des éléments inexacts ou non vérifiés, invérifiables, voire carrément mensongers. Mais le fait qu’une argumentation ait des parties exactes n’a jamais suffi à la rendre dans son ensemble exacte ! (…) C’est une technique rhétorique qui vise à intimider celui qui y est confronté : il s’agit de le submerger par une série d’arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance, pour remplacer la qualité de l’argumentation par la quantité des (fausses) preuves. Histoire, géopolitique, physique, biologie… toutes les sciences sont convoquées – bien entendu, jamais de façon rigoureuse. Il s’agit de créer l’impression que, parmi tous les arguments avancés, « tout ne peut pas être faux », qu’ »il n’y a pas de fumée sans feu » (…) Incapables (et pour cause !) d’apporter la preuve définitive de ce qu’elle avance, la théorie du complot renverse la situation, en exigeant de ceux qui ne la partagent pas de prouver qu’ils ont raison. Mais comment démontrer que quelque chose qui n’existe pas… n’existe pas ? Un peu comme si on vous demandait de prouver que le Père Noël n’est pas réel. (…) A force de multiplier les procédés expliqués ci-dessus, les théories du complot peuvent être totalement incohérentes, recourant à des arguments qui ne peuvent tenir ensemble dans un même cadre logique, qui s’excluent mutuellement. Au fond, une seule chose importe : répéter, faute de pouvoir le démontrer, qu’on nous ment, qu’on nous cache quelque chose. #OnTeManipule !
Hoax[es], rumeurs, photos ou vidéos truquées… les fausses informations abondent sur internet. Parfois la désinformation va plus loin, et prend la forme de pseudo-théories à l’apparence scientifique qui vous mettent en garde : « On te manipule ! » A en croire ces « théoriciens » du complot, États, institutions et médias déploieraient des efforts systématiques pour tromper et manipuler les citoyens. Il faudrait ne croire personne… sauf ceux qui portent ces thèses complotistes ! Étrange, non ? Et si ceux qui dénoncent la manipulation étaient eux-mêmes en train de nous manipuler ? Oui, #OnTeManipule quand on invente des complots, quand on désigne des boucs émissaires, et quand on demande d’y croire, sans aucune preuve. Découvrez les bons réflexes à avoir pour garder son sens critique et prendre du recul par rapport aux informations qui circulent. On te manipule
Au jardin d’Acclimatation (…) le jour où nous étions allés voir les Cinghalais… Marcel Proust
En tant que Sud-Africains noirs, on nous a toujours dit que notre culture n’était pas civilisée, qu’elle était rétrograde. Les plateformes de médias sociaux renforcent ces stéréotypes, ce qui rend les choses plus difficiles. En tant que jeune, pourquoi voudriez-vous célébrer quelque chose qui est constamment tourné en dérision sur les plateformes de médias sociaux ? En tant que Sud-Africaine, je veux célébrer ma culture. Le fait que mes photos soient qualifiées d’inappropriées ou de pornographiques est pour moi une attaque directe contre mon héritage culturel. Je le prends comme un signe d’ignorance. Si je pose de manière sexuellement suggestive, c’est une chose, mais si je poste des photos de moi debout dans ma tenue traditionnelle, c’est un contexte complètement différent. C’est tellement frustrant, tellement exaspérant d’en parler. Vous pouvez agiter vos seins dans un clip vidéo et c’est bien, parce que c’est normalisé. Mais quand on voit une femme debout, les seins à l’air, on se dit que c’est offensant. Nobukhosi Mtshali
Ils ont commencé à retirer la publicité de nos vidéos, puis les vues ont commencé à chuter, les revenus ont commencé à chuter. Nous ne nous soucions pas des revenus, nous nous soucions de l’insulte faite à notre culture. Vous parlez de normes communautaires, mais vous ne parlez que de la communauté occidentale, pas de la communauté africaine. Mais ils n’ont pas abordé cette question. Ils ont simplement dit qu’il s’agissait de nos conditions standard, et que si vous ne les aimiez pas, vous n’étiez pas obligés d’utiliser la plateforme. (…) Vous êtes une organisation qui perpétue le racisme et l’oppression des Noirs, de leurs croyances, de leur culture et de leurs valeurs. Lazi Dlamini (TV Yabantu)
Lorsque les Mijikenda ont commencé à porter des vêtements, le tourisme s’est effondré, sans parler de l’impact de l’insécurité. Sénatrice Emma Mbura (Mombasa, Kenya, 2015)
Notre culture et nos vêtements traditionnels attirent les touristes sur notre côte. Il est arrivé que l’on entre dans un hôtel et que l’on voie nos filles danser les danses traditionnelles Mijikenda. Elles dansaient torse nu, avec leurs seins fermes à la vue de tous. Comment allons-nous attirer à nouveau les touristes si toutes nos femmes portent des vêtements modernes comme des jeans et des minijupes ? Lorsque les touristes viennent à Mombasa, ils veulent visiter la vieille ville et manger des plats traditionnels swahilis et arabes. Et s’ils se rendent dans les villes et villages Mijikenda, ils veulent voir les vêtements traditionnels des Mahando. Je veux seulement que le secteur du tourisme soit réorganisé. La côte dépend du tourisme. La situation a été difficile pour de nombreux habitants depuis que les touristes ont cessé de venir. J’ai travaillé dans un hôtel et j’ai perdu mon emploi lorsque les touristes ont cessé de venir. Sen. Emma Mbura
Je n’ai dit à personne de se mettre nu. Mais nous devons savoir d’où nous venons. Emma Mbura
Il s’agit d’une culture du passé ; la dignité des femmes doit être préservée. Cheikh Abdullah al-Mandhry
Les Kényans sont drôles. Vous avez crié sur tous les toits « ma robe, mon choix » et maintenant vous condamnez Emma Mbura. Qu’est-ce qui a changé ? Sir Chege wa Kimani
Les femmes Mijikenda, comme beaucoup d’autres tribus africaines au Kenya, portaient les seins nus avant l’arrivée des Arabes et des colonisateurs britanniques et la propagation de l’islam et du christianisme qui s’en est suivie. (…) Les récentes attaques – imputées au groupe militant somalien Al-Shabaab et à la montée du militantisme chez les jeunes – ont conduit plusieurs pays occidentaux à déconseiller à leurs ressortissants de se rendre dans la région. Après l’agriculture, le tourisme représente la deuxième source de devises étrangères du Kenya. (…) La suggestion de M. Mbura a suscité la réprobation de nombreux Kényans… Primanews
Aujourd’hui, l’équation difficile est de trouver une jeune fille vierge. Et de trouver même des jeunes filles qui acceptent de se mettent à nu. Kaldaoussa
Dans le village traditionnel, il y aura des artisans et des danseurs. Non, la publicité n’était pas exagérée: dans la danse des jeunes filles, les seins sont nus. J’ai moi-même choisi tout le monde dans les villages de brousse. Ils sont tous volontaires et sont hébergés dans nos bâtiments. Ils vivent ici comme en Afrique: pour eux, il n’y a que le sol qui change… Dany Laurent
Le temps des expositions coloniales serait-il revenu? L’affaire que vient de révéler le Syndicat des musiciens CGT de Loire-Atlantique rappelle, en tout cas, beaucoup cette période peu glorieuse de la République. Elle fait grand bruit dans le département. Au ‘Safari Parc’ de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique, vingt-cinq hommes, femmes et enfants venus tout droit de Côte-d’Ivoire, vont devoir, pendant sept mois, travailler, s’exposer et danser en tenue traditionnelle devant le public fréquentant le zoo. Il y a quelques jours, ‘Ouest France’ publiait en une une photo racoleuse ne correspondant guère à l’éthique déclarée de ce quotidien: une Africaine aux seins nus faisait de la publicité pour le ‘village africain’ de Port-Saint-Père. Ce beau parc animalier, créé il y a un an et qui bénéficie du soutien du conseil général, a déjà accueilli 450.000 visiteurs au milieu de ses 100 hectares, d’animaux et de constructions reconstituant l’univers africain. (…) Le directeur espère 600.000 visiteurs cette année et un grand succès touristique pour la Côte-d’Ivoire. Car, il le précise bien, « je ne suis pas l’employeur. J’ai signé une convention spéciale avec le ministère du Tourisme ivoirien, dont ces vingt-cinq personnes dépendent ». Résultat, les Africains n’ont pas de visa de travail, pas de salaire (une indemnité a été versée au village dont ils dépendent, et seul l’ancien de la troupe reçoit une somme d’argent, qu’il est chargé de distribuer à son gré. Pas de Sécurité sociale non plus. « En cas de maladie, ils seront rapatriés dans leur pays », annonce sans état d’âme le directeur. Interrogé sur la scolarisation des enfants, il explique qu’ils n’iront pas à l’école du village, mais seront pris en charge par l’ancien « comme dans une école de cirque », a-t-il déclaré à « Ouest France’. A l’aube de l’an 2000, on reste stupéfait devant une telle exhibition, digne des expositions coloniales d’antan. La vie des peuples africains aujourd’hui a-t-elle un quelconque rapport avec cette présentation en parallèle d’animaux vivant en semi-liberté et d’hommes et de femmes auquel on demande de mimer leur propre existence devant des touristes – sous un autre climat, dans une société qui leur est complètement étrangère et derrière les grilles d’un parc? Ce voyeurisme choque, alors même qu’à 30 kilomètres de là, à Nantes, ancien port négrier, une exposition sur la traite des Noirs, «Les anneaux de la mémoire» touche à sa fin… (…) « Ce sont les lois sociales françaises et le statut des artistes en représentation qui s’appliquent, cela d’autant plus que la troupe est là pour sept mois… » Une exception, dira-t-on? Tolérer ce genre d’accord, n’est-ce pas demain ouvrir la porte ici à une réserve d’Indiens, là un village d’Esquimaux, un bantoustan africain, tous sous-payés et échappant aux lois sociales. L’Humanité (13.04.1994)
Comment ne pas penser à ces enclos quand on voit les murs qui se construisent autour de l’Europe ou aux Etats-Unis ? Lilian Thuram
Peintures, sculptures, affiches, cartes postales, films, photographies, moulages, dioramas, maquettes et costumes donnent un aperçu de l’étendue de ce phénomène et du succès de cette industrie du spectacle exotique qui a fasciné plus d’un milliard de visiteurs de 1800 à 1958 et a concerné près de 35 000 figurants dans le monde. À travers un vaste panorama composé de près de 600 oeuvres et de nombreuses projections de films d’archives, l’exposition montre comment ces spectacles, à la fois outil de propagande, objet scientifique et source de divertissement, ont formé le regard de l’Occident et profondément influencé la manière dont est appréhendé l’Autre depuis près de cinq siècles. L’exposition explore les frontières parfois ténues entre exotiques et monstres, science et voyeurisme, exhibition et spectacle, et questionne le visiteur sur ses propres préjugés dans le monde d’aujourd’hui. Si ces exhibitions disparaissent progressivement dans les années 30, elles auront alors accompli leur oeuvre : créer une frontière entre les exhibés et les visiteurs. Une frontière dont on peut se demander si elle existe toujours ? Musée du quai Branly
Pendant plus d’un siècle, les grandes puissances colonisatrices ont exhibé comme des bêtes sauvages des êtres humains arrachés à leur terre natale. Retracée dans ce passionnant documentaire, cette « pratique » a servi bien des intérêts. Ils se nomment Petite Capeline, Tambo, Moliko, Ota Benga, Marius Kaloïe et Jean Thiam. Fuégienne de Patagonie, Aborigène d’Australie, Kali’na de Guyane, Pygmée du Congo, Kanak de Nouvelle-Calédonie, ces six-là, comme 35 000 autres entre 1810 et 1940, ont été arrachés à leur terre lointaine pour répondre à la curiosité d’un public en mal d’exotisme, dans les grandes métropoles occidentales. Présentés comme des monstres de foire, voire comme des cannibales, exhibés dans de véritables zoos humains, ils ont été source de distraction pour plus d’un milliard et demi d’Européens et d’Américains, venus les découvrir en famille au cirque ou dans des villages indigènes reconstitués, lors des grandes expositions universelles et coloniales. S’appuyant sur de riches archives (photos, films, journaux…) ainsi que sur le témoignage inédit des descendants de plusieurs de ces exhibés involontaires, Pascal Blanchard et Bruno Victor-Pujebet restituent le phénomène des exhibitions ethnographiques dans leur contexte historique, de l’émergence à l’essor des grands empires coloniaux. Ponctué d’éclairages de spécialistes et d’universitaires, parmi lesquels l’anthropologue Gilles Boëtsch (CNRS, Dakar) et les historiens Benjamin Stora, Sandrine Lemaire et Fanny Robles, leur passionnant récit permet d’appréhender la façon dont nos sociétés se sont construites en fabriquant, lors de grandes fêtes populaires, une représentation stéréotypée du « sauvage ». Et comment, succédant au racisme scientifique des débuts, a pu s’instituer un racisme populaire légitimant la domination des grandes puissances sur les autres peuples du monde. Arte
On assiste au passage progressif d’un racisme scientifique à un racisme populaire, un passage qui n’est ni lié à la littérature ni au cinéma, puisque celui-ci n’existe pas encore, mais à la culture populaire, avec des spectateurs qu vont au zoo pour se divertir, sans le sentiment d’être idéologisés, manipulés. Pascal Blanchard
On payait pour voir des êtres hors norme, le frisson de la dangerosité faisait partie du spectacle. (… ) Imaginez ici des pirogues, un décorum de village lacustre wolof. Tout était fait pour donner au public l’illusion de voir le sauvage dans son biotope. C’est d’ailleurs dans ce décor factice que les frères Lumière tourneront leur douzième film, Baignade de nègres, comme s’ils étaient en Afrique… Pour le visiteur, cette représentation caricaturale du monde et de l’autre était perçue comme la réalité. (…) Ces articles et ces photos contribuent alors à la propagation de clichés et d’idées reçues sur le “sauvage”. Autant de représentations qui légitiment l’ordre colonial, popularisent la théorie et la hiérarchie des races, le concept de peuples “inférieurs” qu’il convient de faire entrer dans la lumière de la civilisation. (…) Ici, vous aviez la grande esplanade des exhibitions humaines. Celle-là même où avaient été placés les Fuégiens de Patagonie en 1881. Sur les photos que nous avons pu retrouver, on voit qu’ils sont installés sur une planche, en hauteur, sans doute à cause du froid et de l’humidité. Ils étaient arrivés en plein mois d’octobre et n’étaient quasiment pas vêtus. Beaucoup avaient attrapé des maladies pulmonaires. (…) Ils étaient enterrés sur place, dans le cimetière du zoo, au même rang que les animaux. Dans certains cas, les corps étaient envoyés à l’Institut médico-légal ou à la Société d’anthropologie de Paris, où le public payait pour assister à leur dissection. (…) Même pour les spécialistes, ce pan de l’histoire coloniale était considéré comme un élément secondaire. (…) Il a fallu six mois pour obtenir l’autorisation de réaliser quelques séquences à l’intérieur du jardin, et nous ne l’avons eue que parce que nous avons menacé de filmer à travers les grilles… Pascal Blanchard
Grâce à l’historien Pascal Blanchard, que j’ai rencontré lors d’un colloque, à l’époque où je jouais à Barcelone. Après notre rencontre, il m’a envoyé un livre sur le sujet, et c’est comme ça que j’ai appris à connaître un peu mieux cette histoire des « zoos humains ». Une histoire extrêmement violente, dont les enjeux m’intéressent car elle permet de comprendre d’où vient le racisme, de saisir qu’il est lié à un conditionnement historique. (…) Les zoos humains sont le reflet d’un rapport de domination, celui de l’Occident sur le reste du monde. La domination de celui qui détient le pouvoir économique et militaire, et qui l’utilise pour que d’autres personnes, dominées, venues d’Asie, d’Océanie, d’Afrique, soient montrées comme des animaux dans des espaces clos, au nom notamment de la couleur de leur peau. (…) Ces exhibitions ont attiré des millions de spectateurs et ont ancré dans leur tête l’idée d’une hiérarchie entre les personnes, entre les prétendues « races » – la race blanche étant considérée comme supérieure. Les mécanismes de domination qui existent dans nos sociétés se sont construits petit à petit. La plupart des gens sont devenus racistes sans le savoir, ils ont été éduqués dans ce sens-là. Après avoir visité ces zoos humains, les populations occidentales étaient confortées dans l’idée qu’elles étaient supérieures, qu’elles incarnaient la « civilisation » face à des « sauvages ». Lorsque je préparais l’exposition au Quai Branly, en 2011, je me suis rendu à Hambourg. Là-bas, sur le portail d’entrée du zoo, une sculpture représente des animaux et des hommes, mis au même niveau. C’est d’une violence totale. Mais cela permet aussi de comprendre pourquoi certains sont aujourd’hui encore dans le rejet de l’autre. Il reste des séquelles de ce passé, les barrières existent toujours dans nos sociétés. Comment ne pas penser à ces enclos quand on voit les murs qui se construisent autour de l’Europe ou aux Etats-Unis ? Les zoos humains permettent de nous éclairer sur ce que nous vivons aujourd’hui. (…) Mais ce n’est pas seulement l’évocation des zoos humains qui pose problème, c’est le passé en général. Ce passé lié à de la violence, au fait de s’accaparer des biens d’autrui. Mais, ce passé-là, nous devons nous l’approprier car il raconte l’histoire du monde actuel. Le regarder en face doit nous permettre de nous éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre, pour essayer de choisir un futur différent. Dans nos sociétés, la chose la plus importante est-elle le profit, le fait de s’octroyer le bien des autres pour s’enrichir ? C’est important de se poser ces questions-là aujourd’hui. (…) Ces manifestations racistes dont vous parlez viennent directement des zoos humains. De cette histoire. Les gens ont été éduqués ainsi. Les cultures dans lesquelles il y a eu des zoos humains gardent ce complexe de supériorité, conscient ou inconscient, sur les autres cultures. Pour progresser, il faut savoir faire preuve d’autocritique. Dans le sport de haut niveau, c’est essentiel. Cela vaut aussi pour la société. Mais nos sociétés, françaises, européennes, portent très peu de critiques sur elles-mêmes. Très souvent, les gens ne veulent pas critiquer leur propre culture. Il n’y a pas si longtemps encore, l’Europe était persuadée d’être le phare de l’univers. Les zoos humains sont liés à l’histoire coloniale. Les gens ont souvent tendance à croire qu’après la colonisation il y a eu l’égalité. Mais non, il y a une culture de la domination qui perdure. Notre système économique ne fait-il pas en sorte qu’une minorité, qui vit bien, exploite une majorité, qui vit mal ? (…) Avant toute chose, je pense qu’il faut connaître notre passé pour mieux comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. Pourquoi certaines personnes ne veulent-elles pas connaître cette histoire, de quoi ont-elles peur ? Le plus beau cadeau que l’on puisse faire à une société, c’est de lui apprendre à connaître son histoire. Il n’y a que sur des bases solides que l’on peut construire un présent et un futur solides. Lilian Thuram
Entre 1877 et 1937, des millions de Parisiens se bousculèrent ici, à la lisière du bois de Boulogne, pour assister au spectacle exotique de Nubiens, Sénégalais, Kali’nas, Fuégiens, Lapons exposés devant le public parés de leurs attributs « authentiques » (lances, peaux de bêtes, pirogues, masques, bijoux…). On se pressait pour voir les « sauvages », des hommes, des femmes et des enfants souvent parqués derrière des grillages ou des barreaux, comme les animaux qui faisaient jusqu’alors la réputation du Jardin zoologique d’acclimatation. D’étranges étrangers, supposés non civilisés et potentiellement menaçants, à l’image de ces Kanaks présentés comme des cannibales et exhibés… dans la fosse aux ours. (…) Lorsque le directeur du Jardin d’acclimatation, le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, organise les tout premiers « spectacles ethnologiques » en 1877 avec des Nubiens et des Esquimaux, il est en quête de nouvelles attractions pour remettre à flot son établissement. Quelques mois plus tôt, à Hambourg, un certain Carl Hagenbeck, marchand d’animaux sauvages, a connu un succès phénoménal en présentant une troupe de Lapons. Au bois de Boulogne, le premier ethnic show fait courir les foules. La fréquentation du jardin double, pour atteindre un million de visiteurs en un an. Certains dimanches, plus de soixante-dix mille personnes se pressent dans les allées. C’est le début d’une mode qui va gagner le monde entier, d’expositions coloniales en expositions universelles. Trente-cinq mille individus seront ainsi exhibés, attirant près d’un milliard et demi de curieux de l’Allemagne aux Etats-Unis, de la Grande-Bretagne au Japon. Pour le promeneur de 2018, impossible de deviner ce passé sinistre derrière les contours ripolinés du parc d’attractions. Les bâtiments de l’époque ont été démolis. Quant aux villages exotiques qui servaient de cadre aux « indigènes », ils étaient éphémères, un ailleurs succédant à un autre. Mais Pascal Blanchard, qui a compulsé des kilos d’images d’archives, n’a aucun mal à en faire ressurgir le souvenir face à ce paisible plan d’eau où patientent des barques (…) Une réalité dont on pouvait conserver le souvenir en s’offrant, après le show, ses produits dérivés, cartes postales, gravures ou coquillages samoans signés de la main des indigènes. Les exhibitions coloniales font le bonheur des anthropologues, qui se bousculent chaque matin avant l’arrivée du public et payent pour pouvoir observer et examiner les « spécimens », publiant ensuite des articles dans les revues les plus sérieuses. S’inspirant des clichés anthropométriques de la police, le photographe Roland Bonaparte constitue, lui, un catalogue de plusieurs milliers d’images « ethnographiques », dans lequel puiseront des générations de scientifiques. (…) Nombre d’exhibés sont ainsi morts dans les zoos humains. On estime entre trente-deux et trente-quatre le nombre de ceux qui auraient péri au Jardin d’acclimatation. » L’acte de décès était déposé à la mairie de Neuilly, mais les morts n’avaient le plus souvent pas de nom. C’est à la lettre « F » comme Fuégienne que les chercheurs ont retrouvé, sur les registres, la trace d’une fillette de 2 ans morte peu après son arrivée à Paris. Une des pièces du puzzle qu’il a fallu patiemment assembler pour reconstituer la mémoire des zoos humains, longtemps ignorée de tous. (…) Aujourd’hui encore, le sujet reste sensible, y compris pour la direction du Jardin d’acclimatation (géré par le groupe LVMH), comme l’a constaté Pascal Blanchard lors du tournage de son documentaire (…) En 2013, au terme d’un combat de cinq ans, les historiens, soutenus par Didier Daeninckx, Lilian Thuram et des élus du Conseil de Paris, ont obtenu que soit posée au Jardin d’acclimatation une plaque commémorative faisant état de ce qu’avaient été les « zoos humains », « symboles d’une autre époque où l’autre avait été regardé comme un “animal” en Occident ». Mais le visiteur doit avoir l’œil bien ouvert pour remarquer la discrète inscription un peu cachée dans les herbes, à l’extérieur de l’enceinte du jardin… Comme le signe d’un passé refoulé qui peine encore à atteindre la lumière. Télérama
« Grandes puissances colonisatrices », « exhibés comme des bêtes sauvages », « êtres humains arrachés à leur terre natale », « servi bien des intérêts », « curiosité d’un public en mal d’exotisme », « présentés comme des monstres de foire, voire comme des cannibales, « véritables zoos humains », « théâtre de cruauté », « exhibés involontaires », « représentation stéréotypée du ‘sauvage' », « racisme scientifique », « racisme populaire légitimant la domination des grandes puissances sur les autres peuples du monde », « voyages dans wagons à bestiaux », « histoire inventée de toutes pièces » et « mise en scène pour promouvoir la hiérarchisation des races et justifier la colonisation du monde », « page sombre de notre histoire », « séquelles toujours vivaces » …
Au lendemain, après l’exposition du Quai Branly de 2011, de la diffusion d’un nouveau documentaire sur les « zoos humains » …
Où, à grands coups d’anachronismes et de raccourcis entre le narrateur de couleur de rigueur (le joueur de football guadeloupéen Lilian Thuram sautant allégrement des « zoos humains » aux cris de singe des hooligans des stades de football ou aux actuelles barrières de sécurité contre l’immigration llégale « Comment ne pas penser à ces enclos quand on voit les murs qui se construisent autour de l’Europe ou aux Etats-Unis ? »), la musique angoissante et les appels incessants à l’indignation, l’on nous déploie tout l’arsenal juridico-victimaire de l’histoire à la sauce tribunal de l’histoire …
Où faisant fi de toutes causes accidentelles ou naturelles (maladies, mort ou suicide), plus aucun fait ne peut être que le « résultat de l’action d’un groupe caché » au détriment de l’intérêt de populations qui ne peuvent autres que victimes …
Où la mise en épingle de certains éléments (colonisation, suprémacisme blanc) éclipse systématiquement tout élément susceptible de contrarier la thèse présentée (comme, au-delà par exemple de l’incohérence d’hommes âpres au gain censés mettre inconsidérément en danger à l’instar des esclavagistes dont l’on tient tant à les rapprocher la vie d’exhibés ramenés à grand frais d’Afrique ou de Nouvelle-Calédonie, les « exhibitions » non commerciales à fins humanitaires comme par exemple celles des sociétés missionnaires chrétiennes, l’implication ou la volonté, sans compter ceux qui décidèrent de rester en Europe et y compris à s’y marier avec des Européennes, de membres du groupe « victime » eux-mêmes comme le riche recruteur sénégalais Jean Thiam ou la danseuse nue au tutu de bananes du Bal nègre et future tenancière du « zoo humain » de Milandes présentant à la planète entière sa tribu arc en ciel recomposée d’enfants de toutes les races et ethnies du monde devient comme par enchantement « déconstructrice » de la facticité du mythe du sauvage) …
Où écartant alors comme aujourd’hui, et ici comme là-bas …
Toute possibilité de véritable curiosité autre que morbide ou raciste (quel racisme attribuer à l’exhibition préalable et même parallèle des « monstres » blancs des « freak shows », dont le cas certes singulier du Dr. autoproclamé Couney sauvant ainsi des milliers de bébés incubés ? ou qui des actuels parcs ethnographiques ou de tourisme industriel où des artisans blancs dument costumés rejouent pour les visiteurs les gestes de leurs aïeux supposés ?), l’on impute invariablement les pires motivations aux méchants colons ou public voués de ce fait à l’exécration publique …
Comment ne pas reconnaitre, dans cette énième tentative d’absolution du péché originel de collusion de l’ethnologie avec l’ordre colonial, nombre des ingrédients des théories du complot que dénonce le site gouvernemental « #On te manipule » …
A l’heure où, face certes à la contamination de l’Internet par la pornographie, nos réseaux sociaux en sont à jouer les ligues de vertus universelles …
Sauf que bien sûr on n’est plus cette fois dans la vulgaire théorie du complot ….
Mais – c’est pour une bonne cause (« Plus jamais ça ! ») – la théorie du complot vertueuse ?
Dans ce jardin, il y avait un “zoo humain”
Virginie Félix
Télérama
29/09/2018
Au Jardin d’acclimatation, de 1877 à 1937, on a parqué et exhibé des êtres humains venus d’ailleurs. L’historien Pascal Blanchard cosigne pour Arte un documentaire remarquable sur ces “zoos humains”, théâtres de cruauté. Et revient sur les lieux où le racisme s’exprimait sans vergogne. A voir samedi 29 septembre, 20h50.
Neuilly ronronne sous le soleil de septembre. En ce mardi de fin d’été, on pénètre dans les allées du Jardin d’acclimatation comme dans une parenthèse enchantée. Des haut-parleurs crachotent une mélodie guillerette, les brumisateurs nimbent l’air d’un brouillard vaporeux et quelques bambins tournicotent devant les manèges. Mais, au milieu des voix d’enfants, celle de l’historien Pascal Blanchard vient jeter une ombre sur ce décor insouciant. Pour le chercheur, qui nous guide ce matin-là parmi les carrousels et les autos tamponneuses, la féerie du parc d’attractions cache une autre histoire, plus ancienne, aussi sombre que méconnue. Celle des zoos humains, ces « exhibitions ethnographiques » qui attirèrent les foules sur les pelouses du Jardin d’acclimatation à l’orée du XXe siècle, et auxquels il vient de consacrer, avec Bruno Victor-Pujebet, un magistral documentaire pour Arte.
On se pressait pour voir les “sauvages”
Entre 1877 et 1937, des millions de Parisiens se bousculèrent ici, à la lisière du bois de Boulogne, pour assister au spectacle exotique de Nubiens, Sénégalais, Kali’nas, Fuégiens, Lapons exposés devant le public parés de leurs attributs « authentiques » (lances, peaux de bêtes, pirogues, masques, bijoux…). On se pressait pour voir les « sauvages », des hommes, des femmes et des enfants souvent parqués derrière des grillages ou des barreaux, comme les animaux qui faisaient jusqu’alors la réputation du Jardin zoologique d’acclimatation. D’étranges étrangers, supposés non civilisés et potentiellement menaçants, à l’image de ces Kanaks présentés comme des cannibales et exhibés… dans la fosse aux ours. « On payait pour voir des êtres hors norme, le frisson de la dangerosité faisait partie du spectacle », explique l’historien.
Une mode qui va gagner le monde entier
Lorsque le directeur du Jardin d’acclimatation, le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire, organise les tout premiers « spectacles ethnologiques » en 1877 avec des Nubiens et des Esquimaux, il est en quête de nouvelles attractions pour remettre à flot son établissement. Quelques mois plus tôt, à Hambourg, un certain Carl Hagenbeck, marchand d’animaux sauvages, a connu un succès phénoménal en présentant une troupe de Lapons. Au bois de Boulogne, le premier ethnic show fait courir les foules. La fréquentation du jardin double, pour atteindre un million de visiteurs en un an. Certains dimanches, plus de soixante-dix mille personnes se pressent dans les allées. C’est le début d’une mode qui va gagner le monde entier, d’expositions coloniales en expositions universelles. Trente-cinq mille individus seront ainsi exhibés, attirant près d’un milliard et demi de curieux de l’Allemagne aux Etats-Unis, de la Grande-Bretagne au Japon.
L’illusion de voir l’“indigène” dans son biotope
Pour le promeneur de 2018, impossible de deviner ce passé sinistre derrière les contours ripolinés du parc d’attractions. Les bâtiments de l’époque ont été démolis. Quant aux villages exotiques qui servaient de cadre aux « indigènes », ils étaient éphémères, un ailleurs succédant à un autre. Mais Pascal Blanchard, qui a compulsé des kilos d’images d’archives, n’a aucun mal à en faire ressurgir le souvenir face à ce paisible plan d’eau où patientent des barques : « Imaginez ici des pirogues, un décorum de village lacustre wolof. Tout était fait pour donner au public l’illusion de voir le sauvage dans son biotope. C’est d’ailleurs dans ce décor factice que les frères Lumière tourneront leur douzième film, Baignade de nègres, comme s’ils étaient en Afrique… Pour le visiteur, cette représentation caricaturale du monde et de l’autre était perçue comme la réalité. » Une réalité dont on pouvait conserver le souvenir en s’offrant, après le show, ses produits dérivés, cartes postales, gravures ou coquillages samoans signés de la main des indigènes.
La légitimation de l’ordre colonial
Les exhibitions coloniales font le bonheur des anthropologues, qui se bousculent chaque matin avant l’arrivée du public et payent pour pouvoir observer et examiner les « spécimens », publiant ensuite des articles dans les revues les plus sérieuses. S’inspirant des clichés anthropométriques de la police, le photographe Roland Bonaparte constitue, lui, un catalogue de plusieurs milliers d’images « ethnographiques », dans lequel puiseront des générations de scientifiques. « Ces articles et ces photos contribuent alors à la propagation de clichés et d’idées reçues sur le “sauvage”. Autant de représentations qui légitiment l’ordre colonial, popularisent la théorie et la hiérarchie des races, le concept de peuples “inférieurs” qu’il convient de faire entrer dans la lumière de la civilisation. »
Au pied de la Fondation Vuitton, Pascal Blanchard désigne une large pelouse. « Ici, vous aviez la grande esplanade des exhibitions humaines. Celle-là même où avaient été placés les Fuégiens de Patagonie en 1881. Sur les photos que nous avons pu retrouver, on voit qu’ils sont installés sur une planche, en hauteur, sans doute à cause du froid et de l’humidité. Ils étaient arrivés en plein mois d’octobre et n’étaient quasiment pas vêtus. Beaucoup avaient attrapé des maladies pulmonaires. »
Les morts, enterrés sur place, n’avaient le plus souvent pas de nom
Nombre d’exhibés sont ainsi morts dans les zoos humains. On estime entre trente-deux et trente-quatre le nombre de ceux qui auraient péri au Jardin d’acclimatation. « Ils étaient enterrés sur place, dans le cimetière du zoo, au même rang que les animaux. Dans certains cas, les corps étaient envoyés à l’Institut médico-légal ou à la Société d’anthropologie de Paris, où le public payait pour assister à leur dissection. » L’acte de décès était déposé à la mairie de Neuilly, mais les morts n’avaient le plus souvent pas de nom. C’est à la lettre « F » comme Fuégienne que les chercheurs ont retrouvé, sur les registres, la trace d’une fillette de 2 ans morte peu après son arrivée à Paris. Une des pièces du puzzle qu’il a fallu patiemment assembler pour reconstituer la mémoire des zoos humains, longtemps ignorée de tous. « Même pour les spécialistes, ce pan de l’histoire coloniale était considéré comme un élément secondaire. » Aujourd’hui encore, le sujet reste sensible, y compris pour la direction du Jardin d’acclimatation (géré par le groupe LVMH), comme l’a constaté Pascal Blanchard lors du tournage de son documentaire : « Il a fallu six mois pour obtenir l’autorisation de réaliser quelques séquences à l’intérieur du jardin, et nous ne l’avons eue que parce que nous avons menacé de filmer à travers les grilles… »
En 2013, au terme d’un combat de cinq ans, les historiens, soutenus par Didier Daeninckx, Lilian Thuram et des élus du Conseil de Paris, ont obtenu que soit posée au Jardin d’acclimatation une plaque commémorative faisant état de ce qu’avaient été les « zoos humains », « symboles d’une autre époque où l’autre avait été regardé comme un “animal” en Occident ». Mais le visiteur doit avoir l’œil bien ouvert pour remarquer la discrète inscription un peu cachée dans les herbes, à l’extérieur de l’enceinte du jardin… Comme le signe d’un passé refoulé qui peine encore à atteindre la lumière.
![]() Sauvages, au coeur des zoos humains, samedi 29 septembre, 20h50, Arte.
Sauvages, au coeur des zoos humains, samedi 29 septembre, 20h50, Arte.
Voir aussi:
Lilian Thuram : “Les zoos humains permettent de comprendre d’où vient le racisme »
Virginie Félix
Télérama
29/09/2018
Engagé dans la lutte contre le racisme, l’ancien footballeur a été le commissaire d’une exposition consacrée aux zoos humains au musée du Quai Branly. Il évoque cette page sombre de notre histoire, et ses séquelles toujours vivaces, à l’occasion d’un documentaire coup de poing diffusé sur Arte.
Depuis qu’il a raccroché les crampons, l’ex-défenseur de l’équipe de France Lilian Thuram joue les attaquants sur le terrain de la lutte contre le racisme. En 2011, il fut le commissaire d’une exposition consacrée aux « zoos humains » organisée au musée du Quai Branly, mettant en lumière la violence de ces exhibitions de « sauvages » qui firent courir les foules dans le monde entier à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Alors qu’Arte consacre cette semaine un documentaire coup de poing à cette page d’histoire méconnue (Sauvages, au cœur des zoos humains), le footballeur devenu « passeur » explique pourquoi il est essentiel de mettre en lumière un passé qui dérange pour mieux en tirer les leçons.
Comment avez-vous découvert l’histoire des « zoos humains » ?
Grâce à l’historien Pascal Blanchard, que j’ai rencontré lors d’un colloque, à l’époque où je jouais à Barcelone. Après notre rencontre, il m’a envoyé un livre sur le sujet, et c’est comme ça que j’ai appris à connaître un peu mieux cette histoire des « zoos humains ». Une histoire extrêmement violente, dont les enjeux m’intéressent car elle permet de comprendre d’où vient le racisme, de saisir qu’il est lié à un conditionnement historique.
Qu’est-ce qui peut expliquer que certaines personnes se retrouvent ainsi exhibées dans des zoos, et que d’autres soient des visiteurs, de l’autre côté des barrières ?
Les zoos humains sont le reflet d’un rapport de domination, celui de l’Occident sur le reste du monde. La domination de celui qui détient le pouvoir économique et militaire, et qui l’utilise pour que d’autres personnes, dominées, venues d’Asie, d’Océanie, d’Afrique, soient montrées comme des animaux dans des espaces clos, au nom notamment de la couleur de leur peau.
Comment les zoos humains ont-ils participé à la fabrication d’un racisme populaire ?
Ces exhibitions ont attiré des millions de spectateurs et ont ancré dans leur tête l’idée d’une hiérarchie entre les personnes, entre les prétendues « races » – la race blanche étant considérée comme supérieure. Les mécanismes de domination qui existent dans nos sociétés se sont construits petit à petit. La plupart des gens sont devenus racistes sans le savoir, ils ont été éduqués dans ce sens-là. Après avoir visité ces zoos humains, les populations occidentales étaient confortées dans l’idée qu’elles étaient supérieures, qu’elles incarnaient la « civilisation » face à des « sauvages ».
Lorsque je préparais l’exposition au Quai Branly, en 2011, je me suis rendu à Hambourg. Là-bas, sur le portail d’entrée du zoo, une sculpture représente des animaux et des hommes, mis au même niveau. C’est d’une violence totale. Mais cela permet aussi de comprendre pourquoi certains sont aujourd’hui encore dans le rejet de l’autre. Il reste des séquelles de ce passé, les barrières existent toujours dans nos sociétés. Comment ne pas penser à ces enclos quand on voit les murs qui se construisent autour de l’Europe ou aux Etats-Unis ? Les zoos humains permettent de nous éclairer sur ce que nous vivons aujourd’hui.
Avez-vous le sentiment que c’est aujourd’hui un sujet tabou, difficile à aborder ?Effectivement. Mais ce n’est pas seulement l’évocation des zoos humains qui pose problème, c’est le passé en général. Ce passé lié à de la violence, au fait de s’accaparer des biens d’autrui. Mais, ce passé-là, nous devons nous l’approprier car il raconte l’histoire du monde actuel. Le regarder en face doit nous permettre de nous éclairer sur ce que nous sommes en train de vivre, pour essayer de choisir un futur différent. Dans nos sociétés, la chose la plus importante est-elle le profit, le fait de s’octroyer le bien des autres pour s’enrichir ? C’est important de se poser ces questions-là aujourd’hui.
Ce racisme populaire, en tant que footballeur, vous avez pu le voir s’exprimer dans les stades, par exemple à travers ces cris de singe des hooligans ?
Ces manifestations racistes dont vous parlez viennent directement des zoos humains. De cette histoire. Les gens ont été éduqués ainsi. Les cultures dans lesquelles il y a eu des zoos humains gardent ce complexe de supériorité, conscient ou inconscient, sur les autres cultures.
Pour progresser, il faut savoir faire preuve d’autocritique. Dans le sport de haut niveau, c’est essentiel. Cela vaut aussi pour la société. Mais nos sociétés, françaises, européennes, portent très peu de critiques sur elles-mêmes. Très souvent, les gens ne veulent pas critiquer leur propre culture. Il n’y a pas si longtemps encore, l’Europe était persuadée d’être le phare de l’univers. Les zoos humains sont liés à l’histoire coloniale.
Les gens ont souvent tendance à croire qu’après la colonisation il y a eu l’égalité. Mais non, il y a une culture de la domination qui perdure. Notre système économique ne fait-il pas en sorte qu’une minorité, qui vit bien, exploite une majorité, qui vit mal ?
Le message que vous voulez faire passer est un message de réconciliation plutôt que de culpabilisation ?
Avant toute chose, je pense qu’il faut connaître notre passé pour mieux comprendre ce que nous vivons aujourd’hui. Pourquoi certaines personnes ne veulent-elles pas connaître cette histoire, de quoi ont-elles peur ? Le plus beau cadeau que l’on puisse faire à une société, c’est de lui apprendre à connaître son histoire. Il n’y a que sur des bases solides que l’on peut construire un présent et un futur solides.
![]() Sauvages, au cœur des zoos humains, samedi 29 septembre, à 20h50, sur Arte.
Sauvages, au cœur des zoos humains, samedi 29 septembre, à 20h50, sur Arte.
Voir de plus:
Exemple à suivre La fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme
Lilian Thuram
D’origine guadeloupéenne, Lilian Thuram a mené une carrière prestigieuse de footballeur de haut niveau (Champion du monde 1998, Champion d’Europe 2000), il détient le record de sélections en équipe de France masculine. Il est membre du Haut conseil à l’intégration et du collectif antiraciste « Devoirs de mémoires ».
Si la Fondation Lilian Thuram-Education contre le racisme [1][1] Cf. site internet de la Fondation : www.thuram.org existe, c’est avant tout le fruit d’une rencontre à Barcelone, lorsque j’étais footballeur professionnel. Invité chez le Consul de France, je rencontrai un publicitaire espagnol qui me demanda ce que j’aimerais faire après le football. Je lui répondis : « changer le monde ». Il sourit et me dit : « vous le pensez parce que vous êtes jeune, c’est une tâche difficile, impossible ». Un débat s’ensuivit.
Il m’interroge sur ma vision des choses. Je lui explique que, pour moi, le racisme perdure parce qu’on n’a jamais pris le temps de déconstruire son mécanisme, que c’est avant tout une invention de l’homme. Toute forme de racisme est une construction sociale. Nous portons toutes et tous des lunettes culturelles : nous ne regardons jamais l’autre de façon innocente. Nous sommes marqués par l’éducation reçue, par nos religions, l’histoire racontée dans notre propre pays. Quelques jours après, cet homme me téléphone pour me dire que je l’ai convaincu, qu’il souhaite me rencontrer pour me faire part de son expérience professionnelle et m’aider dans cette tâche. Il me convainc de créer une fondation, ce que je fais en mars 2008, en Espagne, où je réside alors.
Vous et moi, nous sommes conditionnés ; aujourd’hui, notre propre imaginaire est avant tout le fruit de notre éducation – parentale, scolaire, environnementale – et, pour toute analyse, nous faisons appel à notre connaissance et à nos croyances. Pour essayer de vous expliquer l’impact des croyances collectives, je vais vous raconter deux histoires. Un jour, parlant de « Mes étoiles noires » [2][2] Lilian Thuram, « Mes étoiles noires, de Lucy à Barack… à une pharmacienne, elle me dit que ses parents normands avaient vu pour la première fois un homme noir en 1944, durant le débarquement. Elle me dit aussi que pendant toute son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte, elle avait été conditionnée à détester les « boches », et ce n’est que par la réflexion et la compréhension de cette histoire, qu’elle avait pu comprendre que tous les Allemands n’étaient pas méchants et, surtout, que les Allemands nés après cette guerre n’étaient pas responsables de ce qui s’était passé avant eux. Une autre histoire, celle de « Papy Dédé » : il a vingt ans quand on l’envoie faire la guerre en Algérie. Il explique qu’on l’a conditionné à détester l’« arabe ». Aujourd’hui il ne se dit pas Français, il se dit Homme du monde, car, selon lui, la France lui a menti.
« Les noirs sont forts en sport »
Le conditionnement se fait par la répétition. Répétée mille fois, une bêtise, quelle qu’elle soit, devient une vérité. Les scientifiques du XIXe siècle, les politiques, les intellectuels, les sociétés du spectacle, ont prétendu qu’il y avait plusieurs races ; aujourd’hui, tous les scientifiques sont d’accord pour affirmer qu’il n’y a qu’une espèce, l’Homo sapiens. Pourtant en 2010, les enfants, conditionnés par l’imaginaire collectif, disent qu’il existe une race noire, une jaune, une blanche, une rouge. A la question : « puisque vous pensez qu’il existe plusieurs races, quelles sont les qualités de chacune ? », ils répondent que « les Noirs sont plus forts en sport ». Est-ce anodin ? Sachant que dans notre imaginaire collectif, le corps est dissocié de l’esprit, si les noirs sont plus forts en sport, ils sont aussi moins intelligents. Mais n’est-ce pas compréhensible quand vous savez que c’est à l’école, par le biais de l’esclavage, de l’apartheid et de la colonisation que 80 % de la population française a entendu parler pour la première fois des Noirs ? Ne sommes-nous pas conditionnés de façon inconsciente à voir les personnes de couleur noire comme inférieures ?
L’antisémitisme, par exemple, est d’abord une construction intellectuelle ; on a diabolisé les personnes de religion juive, on leur a attribué des caractéristiques précises à certaines époques de l’Histoire. Un autre exemple concerne les Amérindiens : les Espagnols débarquant aux Amériques avaient en tête tous les préjugés des Européens sur les autres peuples, ils les voyaient comme inférieurs, et c’est pour cela que toutes les entreprises de colonisation et d’esclavagisme ont été présentées comme autant d’œuvres civilisatrices. On prétend civiliser des personnes qui ne le sont pas ; dès lors, dans cette non-civilisation, se retrouve la construction d’une non-humanité de l’autre.
La Fondation veut expliquer avec insistance que le racisme n’est pas un phénomène naturel, c’est un phénomène intellectuel et culturel qui peut être éradiqué en profondeur. Mais cette éradication demande une vigilance car, dans toute société, il y a des tensions identitaires. Pourtant une idée simple pourrait nous aider dans cette éducation contre le racisme : « connais-toi toi-même », selon l’injonction de Socrate. Ce qui singularise notre espèce, c’est cette capacité exceptionnelle d’apprentissage : nous sommes programmés pour apprendre, ce qui explique l’origine de la diversité culturelle et pourquoi chaque être humain peut acquérir n’importe quelle culture. Cette idée doit être absolument développée dans tout discours sur la diversité humaine.
Ils sont ce qu’on leur a appris à être
La couleur de la peau d’une personne, son apparence physique n’ont rien à voir avec la langue qu’elle parle, la religion qu’elle pratique, les valeurs et les systèmes politiques qu’elle défend, ce qu’elle aime ou déteste.
C’est cette idée, pourtant simple, qu’un certain nombre de personnes ne comprend pas ou dont elles n’ont tout simplement pas conscience. Elles sont souvent essentialistes : elles croient, plus ou moins confusément, qu’une « nature physique » est reliée substantiellement à une « nature culturelle ». Elles naturalisent la culture. Un exemple de la version la plus radicale de cette croyance a été produit par l’idéologie nazie. Les racistes naturalisent la culture, comme le misogyne naturalise la femme (sa nature fait que sa place est déterminée), comme les homophobes naturalisent l’homosexualité (on naît homosexuel). C’est donc cette connexion « culture/nature » qu’il faut déconstruire.
Ce qu’il faut expliquer aux enfants, c’est qu’ils sont des constructions sociales et culturelles, qu’ils intègrent des modes de pensée, de façon consciente comme inconsciente, qu’ils sont bourrés de traits culturels qui n’ont rien à voir avec leurs patrimoines génétiques ni avec leur apparence physique. Ils sont ce qu’on leur a appris à être. Le problème fondamental du racisme est qu’il y a trop de personnes qui n’acceptent pas cette idée… Ils n’acceptent pas ou ne comprennent pas que les humains sont construits par d’autres humains.
Nous devons apprendre vraiment à nous connaître nous-mêmes en tant qu’espèce, car nous sommes capables d’apprendre n’importe quoi, le pire comme le meilleur. Nous sommes très sensibles au conditionnement et avons, par nature, du mal à admettre que nous en sommes victimes et à accepter d’en changer. Nous sommes tous persuadés que nous détenons la Vérité. C’est ce qui explique que nous soyons parfois intolérants.
Fort heureusement, le côté positif de notre spécificité est de pouvoir « bricoler » ce qu’on apprend de nos semblables, d’où les changements culturels. Les femmes et les hommes d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles et ceux qui vivaient il y a quatre ou cinq générations ; nos ancêtres du Moyen Âge ne comprendraient rien au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. On voudrait nous faire croire que nous vivons une période de régression du vivre ensemble, mais heureusement c’est tout le contraire : dans l’inconscient collectif, la diversité n’a jamais été aussi présente.
Avant tout, j’aime aller régulièrement à la rencontre des enfants, dans les écoles principalement, pour les écouter et les interroger, m’inspirer de leurs expériences. La première grande action de la fondation a été la publication en janvier dernier de « Mes étoiles noires ». Nous avons préparé pour la mi-octobre un outil pédagogique multimédia pour les enseignants de CM1-CM2 et leurs élèves. Ce sera une proposition de contribution à l’éducation contre le racisme sous la forme de deux DVD et d’un livret. Il sera envoyé gratuitement à tous les enseignants qui en feront la demande, le moment venu. La troisième grande action est une exposition consacrée aux exhibitions, qui, entre 1880 et 1931, ont vu défiler près d’un milliard d’occidentaux devant 40 000 « indigènes » montrés dans des « zoos humains ». L’exposition aura lieu au musée du quai Branly, de fin novembre 2011 à mai 2012. Elle participera à la déconstruction du racisme dans nos imaginaires. Elle voyagera ensuite en Espagne, en Allemagne et en Suisse, puis, nous l’espérons, en Angleterre et aux Etats-Unis.
Notes
Cf. site internet de la Fondation : www.thuram.org
Lilian Thuram, « Mes étoiles noires, de Lucy à Barack Obama », Editions Philippe Rey, 2010.
Avec le soutien de la banque CASDEN, de la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale) et la Fondation du FC Barcelone.
Voir encore:
Human Zoos or Ethnic Shows? Essence and contingency in Living Ethnological Exhibitons
Luis A. Sánchez-Gómez
Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense, Madrid, Spain
Culture & History Digital Journal
Dec. 22, 2013
INTRODUCTION
Between the 29th of November 2011 and the 3rd of June 2012, the Quai de Branly Museum in Paris displayed an extraordinary exhibition, with the eye-catching title Exhibitions. L’invention du sauvage, which had a considerable social and media impact. Its “scientific curators” were the historian Pascal Blanchard and the museum’s curator Nanette Jacomijn Snoep, with Guadalupe-born former footballer Lilian Thuram acting as “commissioner general”. A popular sportsman, Thuram is also known in France for his staunch social and political commitment. The exhibition was the culmination (although probably not the end point) of a successful project which had started in Marseille in 2001 with the conference entitled Mémoire colonial: zoos humains? Corps Exotiques, corps enfermés, corps mesurés. Over time, successive publications of the papers presented at that first meeting have given rise to a genuine publishing saga, thus far including three French editions (Bancel et al., 2002, 2004; Blanchard et al., 2011), one in Italian (Lemaire et al., 2003), one in English (Blanchard et al., 2008) and another in German (Blanchard et al., 2012). This remarkable repertoire is completed by the impressive catalogue of the exhibition (Blanchard; Boëtsch y Snoep, 2011). All of the book titles (with the exception of the catalogue) make reference to “human zoos” as their object of study, although in none of them are the words followed by a question mark, as was the case at the Marseille conference. This would seem to define “human zoos” as a well-documented phenomenon, the essence of which has been well-established. Most significantly, despite reiterating the concept, neither the catalogue of the exhibition, nor the texts drawn up by the exhibit’s editorial authorities, provide a precise definition of what a human zoo is understood to be. Nevertheless, the editors seem to accept the concept as being applicable to all of the various forms of public show featured in the exhibition, all of which seem to have been designed with a shared contempt for and exclusion of the “other”. Therefore, the label “human zoo” implicitly applies to a variety of shows whose common aim was the public display of human beings, with the sole purpose of showing their peculiar morphological or ethnic condition. Both the typology of the events and the condition of the individuals shown vary widely: ranging from the (generally individual) presentation of persons with crippling pathologies (exotic or more often domestic freaks or “human monsters”) to singular physical conditions (giants, dwarves or extremely obese individuals) or the display of individuals, families or groups of exotic peoples or savages, arrived or more usually brought, from distant colonies.[1]The purpose of the 2001 conference had been to present the available information about such shows, to encourage their study from an academic perspective and, most importantly, to publicly denounce these material and symbolic contexts of domination and stigmatisation, which would have had a prominent role in the complex and dense animalisation mechanisms of the colonised peoples by the “civilized West”. A scientific and editorial project guided by such intentions could not fail to draw widespread support from academic, social and journalistic quarters. Reviews of the original 2002 text and successive editions have, for the most part, been very positive, and praise for what was certainly an extraordinary exhibition (the one of 2012) has been even more unanimous.[2] However, most commentators have limited their remarks to praising the important anti-racist content and criticisms of the colonial legacy, which are common to both undertakings. Only a few authors have drawn attention to certain conceptual and interpretative problems with the presumed object of study, the “human zoos”, problems which would undermine the project’s solidity (Blanckaert, 2002; Jennings, 2005; Liauzu, 2005: 10; Parsons, 2010; McLean, 2012). Problems which may arise from the indiscriminate use of the concept of the “human zoo” will be discussed in detail at the end of this article.Firstly, however, a revision of the complex historical process underlying the polymorphic phenomenon of the living exhibition and its configurations will provide the background for more detailed study. This will consist of an outline of three groups which, in my view, are the most relevant exhibition categories. Although the public display of human beings can be traced far back in history in many different contexts (war, funerals and sacred contexts, prisons, fairs, etc…) the configuration and expansion of different varieties of ethnic shows are closely and directly linked to two historical phenomena which lie at the very basis of modernity: exhibitions and colonialism. The former began to appear at national contests and competitions (both industrial and agricultural). These were organised in some European countries in the second half of the eighteenth century, but it was only in the century that followed that they acquired new and shocking material and symbolic dimensions, in the shape of the international or universal exhibition.The key date was 1851, when the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations was held in London. The triumph of the London event, its rapid and continuing success in France and the increasing participation (which will be outlined) of indigenous peoples from the colonies, paved the way from the 1880s for a new exhibition model: the colonial exhibition (whether official or private, national or international) which almost always featured the presence of indigenous human beings. However, less spectacular exhibitions had already been organised on a smaller scale for many years, since about the mid-nineteenth century. Some of these were truly impressive events, which in some cases also featured native peoples. These were the early missionary (or ethnological-missionary) exhibitions, which initially were mainly British and Protestant, but later also Catholic.[3] Finally, the unsophisticated ethnological exhibitions which had been typical in England (particularly in London) in the early-nineteenth century, underwent a gradual transformation from the middle of the century, which saw them develop into the most popular form of commercial ethnological exhibition. These changes were initially influenced by the famous US circus impresario P.T. Barnum’s human exhibitions. Later on, from 1874, Barnum’s displays were successfully reinterpreted (through the incorporation of wild animals and groups of exotic individuals) by Carl Hagenbeck.The second factor which was decisive in shaping the modern ethnic show was imperial colonialism, which gathered in momentum from the 1870s. The propagandising effect of imperialism was facilitated by two emerging scientific disciplines, physical anthropology and ethnology, which propagated colonial images and mystifications amid the metropolitan population. This, coupled with robust new levels of consumerism amongst the bourgeoisie and the upper strata of the working classes, had a greater impact upon our subject than the economic and geostrategic consequences of imperialism overseas. In fact, the new context of geopolitical, scientific and economic expansion turned the formerly “mysterious savages” into a relatively accessible object of study for certain sections of society. Regardless of how much was written about their exotic ways of life, or strange religious beliefs, the public always wanted more: seeking participation in more “intense” and “true” encounters and to feel part of that network of forces (political, economic, military, academic and religious) that ruled even the farthest corners of the world and its most primitive inhabitants.It was precisely the convergence of this web of interests and opportunities within the new exhibition universe that had already consolidated by the end of the 1870s, and which was to become the defining factor in the transition. From the older, popular model of human exhibitions which had dominated so far, we see a reduction in the numbers of exhibitions of isolated individuals classified as strange, monstrous or simply exotic, in favour of adequately-staged displays of families and groups of peoples considered savage or primitive, authentic living examples of humanity from a bygone age. Of course, this new interest, this new desire to see and feel the “other” was fostered not only by exhibition impresarios, but by industrialists and merchants who traded in the colonies, by colonial administrators and missionary societies. In turn, the process was driven forward by the strongly positive reaction of the public, who asked for more: more exoticism, more colonial products, more civilising missions, more conversions, more native populations submitted to the white man’s power; ultimately, more spectacle.Despite the differences that can be observed within the catalogue of exhibitions, their success hinged to a great extent upon a single factor: the representation or display of human beings labelled as exotic or savage, which today strikes us as unsettling and distasteful. It can therefore be of little surprise that most, if not all, of the visitors to the Quai de Branly Museum exhibiton of 2012 reacted to the ethnic shows with a fundamental question: how was it possible that such repulsive shows had been organised? Although many would simply respond with two words, domination and racism, the question is certainly more complex. In order to provide an answer, the content and meanings of the three main models or varieties of the modern ethnic show –commercial ethnological exhibitions, colonial exhibitions and missionary exhibitions– will be studied.
ETHNOLOGICAL COMMERCIAL EXHIBITIONS: LEISURE, BUSINESS AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCE
Commercial ethnological exhibitions were managed by private entrepreneurs, who very often acted as de facto owners of the individuals they exhibited. With the seemingly-noble purpose of bringing the inhabitants of exotic and faraway lands closer to the public and placing them under the scrutiny of anthropologists and scholarly minds, these individuals organised events with a rather carnival-like air, whose sole purpose was very simple: to make money. Such exhibitions were held more frequently than their colonial equivalents, which they predated and for which they served as an inspiration. In fact, in some countries where (overseas) colonial expansion was delayed or minimal –such as Germany (Thode-Arora, 1989; Kosok y Jamin, 1992; Klös, 2000; Dreesbach, 2005; Nagel, 2010), Austria (Schwarz, 2001) or Switzerland (Staehelin, 1993; Minder, 2008)– and even in some former colonies –such as Brazil (Sánchez-Arteaga and El-Hani, 2010)– they were regular and popular events and could still be seen in some places as late as the 1950s. Even in the case of overseas superpowers, commercial exhibitions were held more regularly than the strictly-colonial variety, although it is true that they sometimes overlapped and can be difficult to distinguish from one another. This was the case in France (Bergougniou, Clignet and David, 2001; David, s.d.) and to an even greater extent in Great Britain, with London becoming a privileged place to experience them throughout the nineteenth century (Qureshi, 2011).Almost all of these exhibitions attracted their audiences with a clever combination of racial spectacle, erotism and a few drops of anthropological science, although there was no single recipe for a successful show. Dances, leaps, chants, shouts, and the blood of sacrificed animals were the fundamental components of these events, although they were also part of colonial exhibitions. All of these acts, these strange and unusual rituals, were as incomprehensible as they were exciting; as shocking as they were repulsive to the civilised citizens of “advanced” Europe. It is unsurprising that spectators were prepared to pay the price of admission, which was not cheap, in order to gain access to such extraordinary sights as these “authentic savages”. Over time, the need to attract increasingly demanding audiences, who quickly became used to seeing “blacks and savages” of all kinds in a variety of settings, challenged the entrepreneurs to provide ever more compelling spectacles.For decades the most admired shows on European soil were organised by Carl Hagenbeck (1844–1913), a businessman from Hamburg who was a seasoned wild animal showman (Ames, 2008). His greatest success was founded on a truly spectacular innovation: the simultaneous exhibition in one space (a zoo or other outdoor enclosure) of wild animals and a group of natives, both supposedly from the same territory, in a setting that recreated the environment of their place of origin. The first exhibition of this type, organised in 1874, was a great success, despite the relatively low level of exoticism of the individuals displayed: a group of Sami (Lap) men and women accompanied by some reindeer. Whilst not all of Hagenbeck’s highly successful shows (of which there were over 50 in total) relied upon the juxtaposition of humans and animals, all presented a racial spectacle of exotic peoples typically displayed against a backdrop of huts, plants and domestic ware, and included indigenous groups from the distant territories of Africa, the Arctic, India, Ceylon, and Southeast Asia. For many scholars Hagenbeck’s Völkerschauen or Völkerausstellungen constituted the paradigmatic example of a human zoo, which is also accepted by the French historians who organised the project under the same name. They tended to combine displays of people and animals and took place in zoos, so the analogy could not be clearer. Furthermore, the performances of the exhibited peoples were limited to songs, dances and rituals, and for the most part their activities consisted of little more than day-to-day tasks and activities. Therefore, little importance was attached to their knowledge or skills, but rather to the scrutiny of their gestures, their distinctive bodies and behaviours, which were invariably exotic but not always wild.However, despite their obvious racial and largely-racist components, Hagenbeck’s shows cannot be simply dismissed as human zoos. As an entrepreneur, the German’s objective was obviously to profit from the display of animals and people alike, and yet we cannot conclude that the humans were reduced to the status of animals. In fact, the natives were always employed and seem to have received fair treatment. Likewise, their display was based upon a premise of exoticism rather than savagery, in which key ideas of difference, faraway lands and adventure were ultimately exalted. Hagenbeck’s employees were apparently healthy; sometimes slender, as were the Ethiopians, or even athletic, like the Sudanese. In some instances (for example, with people from India and Ceylon) their greatest appeal was their almost-fantastic exoticism, with their rich costumes and ritual gestures being regarded as remarkable and sophisticated.Nevertheless, on many other occasions, people were displayed for their distinctiveness and supposed primitivism, as was the case on the dramatic tour of the Inuit Abraham Ulrikab and his family, from the Labrador Peninsula, all of whom fell ill and died on their journey due to a lack of appropriate vaccination. This is undoubtedly one of the best-documented commercial exhibitions, not because of an abundance of details concerning its organisation, but owing to the existence of several letters and a brief diary written by Ulrikab himself (Lutz, 2005). As can easily be imagined, it is absolutely exceptional to find information originating from one of the very individuals who featured in an ethnic show; not an alleged oral testimony collected by a third party, but their own actual voice. The vast majority of such people did not know the language of their exhibitors and, even if they knew enough to communicate, it is highly unlikely that they would have been able to write in it. All of this, coupled with the fact that the documents have been preserved and remain accessible, is almost a miracle.However, in spite the tragic fate of Ulrikab and his family, other contemporary ethnic shows were far more exploitative and brutal. This was the case with several exhibitions that toured Europe towards the end of the 1870s, whose victims included Fuegians, Inuits, primitive Africans (especially Bushmen and Pygmies) or Australian aboriginal peoples. Some were complex and relatively sophisticated and included the recreation of native villages; in others, the entrepreneur simply portrayed his workers with their traditional clothes and weapons, emphasising their supposedly primitive condition. Slightly less dramatic than these, but more racially stigmatising than Hagenbeck’s shows, were the exhibitions held at the Jardin d’Aclimatation in Paris, between 1877 and the First World War. A highly-lucrative business camouflaged beneath a halo of anthropological scientifism, the exhibitions were organised by the director of the Jardin himself, the naturalist Albert Geoffroy Saint-Hilaire (Coutancier and Barthe, 1995; Mason, 2001: 19–54; David, n.d.; Schneider, 2002; Báez y Mason, 2006). This purported scientific and educational institution enjoyed the attention of French anthropologists for a time; however, after 1886, the Anthropological Society in Paris distanced itself from something that was little more than it appeared to be: a spectacle for popular recreation which was hard to justify from an ethical point of view. In the case of many private enterprises from the 1870s and 1880s, in particular, shows can be described as moving away from notions of fantasy, adventure and exotism and towards the most brutal forms of exploitation. However, despite what has been said about France, Qureshi (2011: 278–279) highlights the role that ethnologists and anthropologists (and their study societies) played in Great Britain in approving commercial exhibitions of this sort. This enabled exhibitions to claim legitimacy as spaces for scientific research, visitor education and, of course, the advancement of the colonial enterprise.Leaving aside the displays of isolated individuals in theatres, exhibition halls, or fairgrounds (where the alleged “savage” sometimes proved to be a fraud), photographs and surviving information about the aforementioned commercial ethnological shows speak volumes about the relations which existed between the exhibitors and the exhibited. In nearly all cases the impresario was a European or North American, who wielded almost absolute control over the lives of their “workers”. Formal contracts did exist and legal control became increasingly widespread, especially in Great Britain, (Qureshi, 2011: 273) as the nineteenth century progressed. It is also evident, nevertheless, that this contractual relationship could not mask the dominating, exploitative and almost penitentiary conditions of the bonds created. Whether Inuit, Bushmen, Australians, Pygmies, Samoans or Fuegians, it is hard to accept that all contracted peoples were aware of the implications of this legal binding with their employer. Whilst most were not captured or kidnapped (although this was documented on more than one occasion) it is reasonable to be skeptical about the voluntary nature of the commercial relationship. Moreover, those very same contracts (which they were probably unable to understand in the first place) committed the natives to conditions of travel, work and accommodation which were not always satisfactory. Very often their lives could be described as confined, not only when performances were taking place, but also when they were over. Exhibited individuals were very rarely given leave to move freely around the towns that the exhibitions visited.The exploitative and inhuman aspects of some of these spectacles were particularly flagrant when they included children, who either formed part of the initial contingent of people, or swelled the ranks of the group when they were born on tour. On the one hand, the more primitive the peoples exhibited were, the more brutal their exhibition became and the circumstances in which it took place grew more painful. Conversely, conditions seemed to improve, albeit only to a limited extent, when individuals belonged to an ethnic group which was more “evolved”, “prouder”, held warrior status, or belonged to a local elite. This was true of certain African groups who were particularly resistant to colonial domination, with the Ashanti being a case in point. In spite of this, their subordinate position did not change.There was, however, a certain type of commercial show in which the relations between the employer and the employees went beyond the merely commercial. More professionalised shows often required natives to demonstrate skills and give performances that would appeal to the audience. This was the case in some (of the more serious and elaborate) circus contexts and dramatised spectacles, the most notable of which was the acclaimed Wild West show. Directed by William Frederick Cody (1846–1917), the famous Buffalo Bill, the show featured cowboys, Mexicans, and members of various Native American ethnic groups (Kasson, 2000). This attraction, and many others that followed in the wake of its success, could be considered the predecessors of present-day theme park shows. Many of the shows which continued to endure during the interwar period were in some measure similar to those of the nineteenth century, although they were unable to match the popularity of yesteryear. Whilst the stages were still set with reproduction native villages, as had been the case in the late-nineteenth and early-twentieth century, the exhibition and presentation of natives acquired a more fair-like and circus-like character, which harked back to the spectacles of the early-nineteenth century. Although it seems contradictory, colonial exhibitions at this time were in fact much larger and more numerous, as we shall see in the following section. It was precisely then, in the mid-1930s, that Nazi Germany, a very modern country with the most intensely-racist government, produced an ethnic show which illustrates the complexity of the human zoo phenomenon. The Deutsche Afrika-Schau (German African Show) provides an excellent example of the peculiar game which was played between owners, employees and public administrators, concerning the display of exotic human beings. The show, a striking and an incongruous fusion of variety spectacle and Völkerschau, toured several German towns between 1935 and 1940 (Lewerenz, 2006). Originally a private and strictly commercial business, it soon became a peculiar semi-official event in which African and Samoan men and women, resident in Germany, were legally employed to take part. Complicated and unstable after its Nazification, the show aimed to facilitate the racial control of its participants while serving as a mechanism of ideological indoctrination and colonial propaganda. Incapable of profiting from the show, the Nazi regime would eventually abolish it.After the Second World War, ethnic shows entered a phase of obvious decline. They were no longer of interest as a platform for the wild and exotic, mainly due to increasing competition from new and more accessible channels of entertainment, ranging from cinema to the beginnings of overseas tourism within Europe and beyond. While the occasional spectacle tried to profit from the ancient curiosity about the morbid and the unusual as late as the 1950s and even the 1960s, they were little more than crude and clumsy representations, which generated little interest among the public. Nowadays, as before, there are still contexts and spaces in which unique persons are portrayed, whether this is related to ethnicity or any other factor. These spectacles often fall into the category of artistic performances or take the banal form of reality TV.
NOTES
ABSTRACT
The aim of this article is to study the living ethnological exhibitions. The main feature of these multiform varieties of public show, which became widespread in late-nineteenth and early-twentieth century Europe and the United States, was the live presence of individuals who were considered “primitive”. Whilst these native peoples sometimes gave demonstrations of their skills or produced manufactures for the audience, more often their role was simply as exhibits, to display their bodies and gestures, their different and singular condition. In this article, the three main forms of modern ethnic show (commercial, colonial and missionary) will be presented, together with a warning about the inadequacy of categorising all such spectacles under the label of “human zoos”, a term which has become common in both academic and media circles in recent years.Figure 8. Postcard from the Deutsche Colonial-Ausstellung, Gewerbe Ausstellung (German Colonial Exhibition, Industrial Exhibition, Berlin 1896). Historische Bildpostkarten, Universität Osnabrück, Sammlung Prof. Dr. S. Giesbrecht (http://www.bildpostkarten.uni-osnabrueck.de).
[1]In order to avoid loading the text through the excessive use of punctuation marks, I have decided not to put words as blacks, savages or primitives in inverted commas; but by no means does this mean my acceptance of their contemporary racist connotations.
[3]Missionary exhibitions are not an integral part of the repertoire of exhibitions studied as part of the French project on “Human zoos”, nor do they appear at the great Quai de Branly exhibition of 2012.
[4]The Marseille and Paris exhibitions competed with each other. The Festival of Empire was organised in London to celebrate the coronation of George V, thus also being known as the Coronation Exhibition. For more information about these and other British colonial exhibitions, or exhibitions which had important colonial sections, organised between 1890 and 1914, see Coombes (1994: 85–108) and Mackenzie (2008).
REFERENCES
| ○ | Abbattista, Guido and Labanca, Nicola (2008) “Living ethnological and colonial exhibitions in liberal and fascist Italy”. In Human Zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires, edited by Blanchard, P. et al., Liverpool University Press, Liverpool, pp. 341–352. |
| ○ | Ageron, Charles-Robert (1984) “L’Exposition Coloniale de 1931: Mythe républicaine ou mythe impérial?” In Les lieux de mémoire, edited by Nora, Pierre, Gallimard, Paris, I, pp. 561–591. |
| ○ | Ames, Eric (2008) Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. University of Washington Press, Washington. |
| ○ | Anderson, Christopher J. (2006) “The world is our parish: remembering the 1919 Protestant missionary fair”. International Bulletin of Missionary Research (October) http://www.thefreelibrary.com/The world is our parish: remembering the 1919 Protestant missionary…-a0153692261. [accessed 11/October/2013] |
| ○ | Arnold, Stefan (1995) “Propaganda mit Menschen aus Übersee. Kolonialausstellungen in Deutschland 1896 bis 1940”. In Kolonialausstellungen. Begegnungen mit Afrika?, edited by Debusmann, Robert and Riesz, János, IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation, Frankfurt, pp. 1–24. |
| ○ | Báez, Christian and Mason, Peter (2006) Zoológicos humanos: Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardin d’Acclimatation de París, siglo XIX. Pehuén Editores, Providencia, Santiago. |
| ○ | Bancel, Nicolas; Blanchard, P.; Böetsch, G.; Derro, É. and Lemaire, S. (editors), (2002) Zoos humains. De la Vénus hottentote aux reality shows (XIXe et XXe siècles). Éditions La Decouverte, Paris. |
| ○ | Bancel, Nicolas; Blanchard, P.; Böetsch, G.; Derro, É. and Lemaire, S. (editors), (2004) Zoos humains. Au temps des exhibitions humains. Éditions La Découverte, Paris. |
| ○ | Bergougniou, Jean-Michel; Clignet, Rémi and David, Philippe (2001) “Villages noirs” et autres visiteurs africains et malgaches en France et en Europe (1870–1940). Éditions Karthala, Paris. |
| ○ | Blanchard, Pascal; Bancel, N.; Boëtsch, G.; Deroo, E.; Lemaire, S. and Forsdick, Ch. (editors), (2008), Human Zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires. Liverpool University Press, Liverpool. |
| ○ | Blanchard, Pascal; Bancel, N.; Boëtsch, G.; Deroo, E. and Lemaire, S. (editors), (2011), Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre. La Découverte, Paris. |
| ○ | Blanchard, Pascal; Boëtsch, Gilles and Snoep, Nanette J. (editors), (2011) Exhibitions. L’invention du sauvage. Actes Sud and Musée du Quai Branly, Paris. |
| ○ | Blanchard, Pascal; Bancel, N.; Boëtsch, G.; Deroo, E. and Lemaire, S. (editors), (2012) MenschenZoos. Schaufenster der Unmenschlichkeit. Les éditions du Crieur Public, Hamburg. |
| ○ | Blanckaert, Claude (2002) “Spectacles ethniques et culture de masse au temps des colonies”. Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 7: 223–232. http://dx.doi.org/10.3917/rhsh.007.0223 |
| ○ | Blévis, Laure et al. (editors), (2008) 1931: Les étrangers au temps de l’Exposition coloniale. Editions Gallimard and Cité nationale de l’histoire de l’inmigration, Paris. |
| ○ | Bloembergen, Marieke (2006) Colonial Spectacles: The Netherlands and the Dutch East Indies at the World Exhibitions, 1880–1931. Singapore University Press, Singapore. |
| ○ | Bottaro, Mario (1984) Genova 1892 e le celebrazione colombiane. Francesco Pirella Editore, Genoa. |
| ○ | Cantor, Geoffrey (2011) Religion and the Great Exhibition of 1851. Oxford University Press, Oxford. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199596676.001.0001 |
| ○ | Cheang, Sarah (2006–07) “Our Missionary Wembley: China, Local Community and the British Missionary Empire, 1901–1924”. East Asian History, 32–33: 177–198. |
| ○ | Considine, John J. (1925) The Vatican Mission Exposition: A Window on the World. The MacMillan Company, New York. |
| ○ | Coombes, Annie E. (1994) Reinventing Africa: Museums, Material Culture and Popular Imagination. Yale University Press, New Haven and London. |
| ○ | Cornelis, Sabine (2005) “Le colonisateur satisfait, ou le Conggo représenté en Belgique (1897–1958)”. In La mémoire du Congo. Le temps colonial, edited by Vellut, J-L, Musée Royal de l’Afrique centrale, Éditions Snoeck, Tervuren and Gand, pp. 159–169. |
| ○ | Coutancier, Benoît and Barthe, Christine (1995) “Au Jardin d’Acclimatation: représentations de l’autre (1877–1890)”. In L’Autre et Nous: “Scènes et Types”. Anthropologues et historiens devant les représentations des populations colonisées, des “ethnies”, des “tribus” et des “races” depuis les conquêtes coloniales, edited by Blanchard, Pascal; Blanchoin, S.; Bancel, N.; Böetsch, G. and Gerbeau, H., SYROS and ACHAC, Paris, pp. 145–150. |
| ○ | David, Philippe (n.d.) 55 ans d’exhibitions zoo-ethnologiques au Jardin d’Acclimatation. Available at http://www.jardindacclimatation.fr/article/le-jardin-vu-par. [accessed 24/July/2012] |
| ○ | Delhalle, Philippe (1985) “Convaincre par le fait: Les expositions universelles en tant qu’instruments de la propagande coloniale belge”. In Zaïre. Cent ans de regards belges 1885–1985, Coopération pour l’Education et la Culture, Brussels, pp. 41–45. |
| ○ | Dore, Gianni (1992) “Ideologia coloniale e senso comune etnografico nella mostra delle terre italiane d’oltremare”. In L’Africa in vetrina: Storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, edited by Labanca, N., Pagus, Paese, pp. 47–65. |
| ○ | Dreesbach, Anne (2005) Gezähmte Wilde. Die Zurschaustellung “exotischer” Menschen in Deutschland 1870–1940. Campus Verlag, Frankfurt and New York. |
| ○ | Exposition Coloniale (2006) L’Exposition Coloniale. 75 ans après, regards sur l’Exposition Coloniale de 1931. Paris, Mairie de Paris 12e. Available at http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id = 20543 [accessed 8/November/2006]. |
| ○ | Geppert, Alexander C. T. (2010) Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-de-Siècle Europe. Palgrave Macmillan, Basingstoke. http://dx.doi.org/10.1057/9780230281837 |
| ○ | Guardiola, Juan (2006) El imaginario colonial. Fotografía en Filipinas durante el periodo español 1860–1898. Barcelona, National Museum of the Philippines, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior de España, Casa Asia |
| ○ | Halen, Pierre (1995) “La représentation du Congo à l’Exposition Universelle de Bruxelles (1958). A propos d’une désignation identitaire”. In Kolonialausstellungen. Begegnungen mit Afrika?, edited by Debusmann, Robert and Riesz, János, IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation, Frankfurt, pp. 75–102. |
| ○ | Hasinoff, Erin L. (2011) Faith in Objects. American Missionary Expositions in the Early Twentieth Century. Palgrave Macmillan, New York. http://dx.doi.org/10.1057/9780230339729 |
| ○ | Heyden, Ulrich van der (2002) “Die Kolonial- und die Transvaal-Ausstellung 1896/97”. In Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche, edited by Heyden, U. van der and Zeller, J., Berlin Edition, Berlin, pp. 135–142. |
| ○ | Hodeir, Catherine and Pierre, Michel (1991) 1931. La mémoire du siècle. L’Exposition Coloniale. Éditions Complexe, Brussels. |
| ○ | Jennings, Eric T. (2005) “Visions and Representations of the French Empire”. The Journal of Modern History, 77: 701–721. http://dx.doi.org/10.1086/497721 |
| ○ | Kasson, Joy S. (2000) Buffalo Bill’s Wild West: Celebrity, Memory, and Popular History. Hill and Wang, New York. |
| ○ | Kivelitz, Christoph (1999) Die Propagandaausstellung in europäischen Diktaturen. Konfrontation und Vergleich: Nationalsozialismus, italienischer Faschismus und UdSSR der Stalinzeit. Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum. |
| ○ | Klös, Ursula (2000) “Völkerschauen im Zoo Berlin zwischen 1878 und 1952”. Bongo. Beiträge sur Tiergärtnerei und Jahresberichte aus dem Zoo Berlin, 30: 33–82. |
| ○ | Kosok, Lisa und Jamin, Mathilde (editors), (1992) Viel Vergnügen. Öffentliche Lustbarkeiten im Ruhrgebiet der Jahrhundertwende. Eine Ausstellung des Ruhrlandmuseums der Stadt Essen, 25. Oktober 1992 bis 12. April 1993. Ruhrlandmuseums der Stadt Essen, Essen. |
| ○ | Kramer, Paul A. (1999) “Making concessions: race and empire revisited at the Philippine Exposition, St. Louis, 1901–1905”. Radical History Review, 73: 74–114. |
| ○ | Küster, Bärbel (2006) “Zwischen Ästhetik, Politik und Ethnographie: Die Präsentation des Belgischen Kongo auf der Weltausstellung Brüssel-Tervuren 1897”. In Die Schau des Fremden: Ausstellungskonzepte zwischen Kunst, Kommerz und Wissenschaft, edited by Grewe, Cordula, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 95–118. |
| ○ | Lebovics, Herman (2008) “The Zoos of the Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931”. In Human Zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires, edited by P. Blanchard et al. Liverpool University Press, liverpool, pp. 369–376. |
| ○ | Lemaire, Sandrine; Blanchard, P.; Bancel, N.; Boëtsch, G. and Deroo, E. (editors), (2003) Zoo umani. Dalla Venere ottentota ai reality show. Ombre corte, Verona. |
| ○ | L’Estoile, Benoît de (2007) Le gout des autres. De l’Exposition Coloniale aux arts premiers. Flammarion, Paris. |
| ○ | Lewerenz, Susann (2006) Die Deutsche Afrika-Schau (1935–1940): Rassismus, Kolonialrevisionismus und postkoloniale Auseinandersetzungen im nationalsozialistischen Deutschland. Peter Lang, Frankfurt. |
| ○ | Leymarie, Michel (2009) “Les pavillons coloniaux à l’Exposition franco-britannique de 1908”. Synergies Royaume-Uni et Irlande, 2: 69–79. |
| ○ | Liauzu, Claude (2005) “Les historiens saisis par les guerres de mémoires coloniales”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52 (4bis): 99–109. |
| ○ | Lutz, Hartmut (editor), (2005) The Diary of Abraham Ulrikab. Text and Context. University of Ottawa Press, Ottawa. |
| ○ | Mabire, Jean-Christophe (editor), (2000) L’Exposition Universelle de 1900. L’Harmattan, Paris. |
| ○ | Mackenzie, John M. (2008) “The Imperial Exhibitions of Great Britain”. In Human Zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires, edited by Blanchard, P. et al., Liverpool University Press, Liverpool, pp. 259–268. |
| ○ | Mason, Peter (2001) The Live of Images. Reaktion Books, London. |
| ○ | Mathur, Saloni (2000) “Living Ethnological Exhibits: The Case of 1886”. Cultural Anthropology, 15 (4): 492–524. http://dx.doi.org/10.1525/can.2000.15.4.492 |
| ○ | McLean, Ian (2012) “Reinventing the Savage”. Third Text, 26 (5): 599–613. http://dx.doi.org/10.1080/09528822.2012.712769 |
| ○ | Minder, Patrick (2008) “Human Zoos in Switzerland”. In Human Zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires, edited by Blanchard, P. et al., Liverpool University Press, Liverpool, pp. 328–340. |
| ○ | Möhle, Heiko (n.d.) “Betreuung, Erfassung, Kontrolle – Afrikaner in Deutschland und die ‘Deutsche Gesellschaft für Eingeborenenkunde’ (1884–1945)”. berliner-postkolonial. Available at http://www.berlin-postkolonial.de/cms/index.php?option = com_content&view = article&id = 38:martin-luther-strasse-97&catid = 20:tempelhof-schoeneberg [accessed 10/October/2012]. |
| ○ | Morton, Patricia A. (2000) Hybrid modernities: architecture and representation at the 1931 Colonial Exposition, Paris. The MIT Press, Cambridge, Ma. |
| ○ | Nagel, Stefan (2010) Schaubuden. Geschichte und Erscheinungsformen. Münster. Available at http://www.schaubuden.de [accessed 29/April/2010]. |
| ○ | Nanta, Arnaud (2011) “Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne”. In Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’inventions de l’Autre, edited by Blanchard, P. et al., La Découverte, Paris, pp. 373–384. |
| ○ | Palermo, Lynn E. (2003) “Identity under construction: Representing the colonies at the Paris Exposition Universelle of 1889”. In The color of liberty: Histories of race in France edited by Peabody, Sue and Tyler, Stovall, Duke University Press, Durham, pp. 285–300. |
| ○ | Parezo, Nancy J. and Fowler, Don D. (2007) Anthropology Goes to the Fair: The 1904 Louisiana Purchase Exposition. University of Nebraska Press, Lincoln and London. |
| ○ | Parsons, Thad (2010) [Review of] “Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Éric Deroo and Sandrine Lemaire (eds), Teresa Bridgeman (trans.), Human Zoos: Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, Liverpool: Liverpool University Press, 2008, paperback £19.95, pp. X + 445.” Museum and Society, 8 (3): 215–216. Available at http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/volumes/volume8 [accesed 11/October/2013]. |
| ○ | Perrone, Michele (n.d.) “Esposizione Italo-Americana Genova 1892. Celebrativa del IV centenario della scoperta dell’ America”. Available at http://www.lanternafil.it/Public/Expo92/Esposizione.htm [accessed 26/October/2007]. |
| ○ | Qureshi, Sadiah (2011) Peoples on Parade: Exhibitions, Empire, and Anthropology in Nineteenth-century Britain. Chicago University Press, Chicago. http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226700984.001.0001 |
| ○ | Richter, Roland (1995) “Die erste Deutsche Kolonialsusstellung 1896. Der ‘Amtliche Bericht’ in historischer Perspektive”. In Kolonialausstellungen. Begegnungen mit Afrika?, edited by Debusmann, Robert and Riesz, János, IKO-Verlag für interkulturelle Kommunikation, Frankfurt, pp. 25–42. |
| ○ | Rydell, Robert W. (1984) All the world’s a fair: visions of Empire at American International Expositions, 1876–1916. University of Chicago Press, Chicago. |
| ○ | Rydell, Robert W. (1993) World of fairs. The century-of-progress expositions. The University of Chicago Press, Chicago. |
| ○ | Rydell, Robert W.; Findling, J. E. and Pelle, K. D. (2000) Fair America: World’s fairs in the United States. Smithsonian Institution Press, Washington DC. |
| ○ | Sánchez-Arteaga, Juanma and El-Hani, Charbel Niño (2010) “Physical anthropology and the description of the ‘savage’ in the Brazilian Anthropological Exhibition of 1882”. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 17 (2): 399–414. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702010000200008 |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2003) Un imperio en la vitrina: el colonialismo español en el Pacífico y la Exposición de Filipinas de 1887. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2006) “Martirologio, etnología y espectáculo: la Exposición Misional Española de Barcelona (1929–1930)”. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXI (1): 63–102. |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2007) “Por la Etnología hacia Dios: la Exposición Misional Vaticana de 1925”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LXII (2): 63–107. |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2009) “Imperial faith and catholic missions in the grand exhibitions of the Estado Novo”. Análise Social, 193: 671–692. |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2011) “Imperialismo, fe y espectáculo: la participación de las Iglesias cristianas en las exposiciones coloniales y universales del siglo XIX”. Hispania. Revista Española de Historia, 237: 153–180. |
| ○ | Sánchez-Gómez, Luis Á. (2013) Dominación, fe y espectáculo: Las exposiciones misionales y coloniales en la era del imperialismo moderno (1851–1958). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. |
| ○ | Schneider, William H. (2002) “Les expositions ethnographiques du Jardin zoologique d’acclimatation”. In Zoos humains. XIXe et XXe siècles, edited by Bancel, N. et al., Éditions La Decouverte, Paris, pp. 72–80. |
| ○ | Schwarz, Werner M. (2001) Anthropologische Spektakel: Zur Schaustellung “exotischer” Menschen, Wien 1870–1910. Turia und Kant, Vienna. |
| ○ | [Serén, Maria do Carmo] (2001) A Porta do Meio. A Exposição Colonial de 1934. Fotografias da Casa Alvão. Ministério da Cultura, Centro Portugués de Fotografia, Porto. |
| ○ | Siddle, Richard (1996) Race, Resistance and the Ainu of Japan. Routledge, London and New York. |
| ○ | Staehelin, Balthasar (1993) Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel 1879–1935. Basler Afrika Bibliographien, Basel. |
| ○ | Stanard, Matthew G. (2005) “‘Bilan du monde pour un monde plus deshumanisé’: The 1958 Brussels World’s Fair and Belgian perceptions of the Congo”. European History Quarterly, 35 (2): 267–298. http://dx.doi.org/10.1177/0265691405051467 |
| ○ | Stanard, Matthew G. (2009) “Interwar Pro-Empire Propaganda and European Colonial Culture: Toward a Comparative Research Agenda”. Journal of Contemporary History, 44 (I): 27–48. http://dx.doi.org/10.1177/0022009408098645 |
| ○ | Stanard, Matthew G. (2011) Selling the Congo. A History of European Pro-Empire Propaganda and the Making of Belgian Imperialism. University of Nebraska Press, Lincoln and London. |
| ○ | Thode-Arora, Hilke (1989) Für fünfzig Pfennig um die Welt. Die Hagenbeckschen Völkerschauen, Campus Verlag, Frankfurt and New York. |
| ○ | Tran, Van Troi (2007) “L’éphémère dans l’éphémère. La domestication des colonies à l’Exposition universelle de 1889”. Ethnologies, 29 (1–2): 143–169. http://dx.doi.org/10.7202/018748ar |
| ○ | Vargaftig, Nadia (2010) “Les expositions coloniales sous Salazar et Mussolini (1930–1940)”. Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 108: 39–53. |
| ○ | Wilson, Michael (1991) “Consuming History: The Nation, the Past and the Commodity at l’Exposition Universelle de 1900”. American Journal of Semiotics, 8 (4): 131–154. http://dx.doi.org/10.5840/ajs1991848 |
| ○ | Wynants, Maurits (1997) Des Ducs de Brabant aux villages Congolais. Tervuren et l’Exposition Coloniale 1897. Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren. |
| ○ | Wyss, Beat (2010) Bilder von der Globalisierung. Die Weltausstellung von Paris 1889, Insel Verlag, Franfurkt. |
Voir aussi:
Human zoos: When people were the exhibits
Annika Zeitler
Dw.com
10.03.2017
From the German Empire through the 1930s, humans were locked up and exhibited in zoos. These racist « ethnological expositions » remain a traumatizing experience for Theodor Wonja Michael.
« We went throughout Europe with circuses, and I was always traveling – from Paris to Riga, from Berne to Bucharest via Warsaw, » remembers Theodor Wonja Michael. He is the youngest son of a Cameroonian who left the then German colony at the turn of the century to live in the German Empire.
« We danced and performed along with fire-eaters and fakirs. I began hating taking part in these human zoos very early on, » says the now 92-year-old. For several years, did stopped talking about that period in his life. Then in 2013, Theodor Wonja Michael wrote about his and his family’s story in the book « Deutsch sein und schwarz dazu » (Being German and also Black).
Traveling with a human zoo
Theodor Wonja Michael’s father moved with his family from Cameroon to Europe at the end of the 19th century. In Berlin, he quickly realized that he wouldn’t be allowed to do normal jobs. The only available way of making a living was through ethnological expositions, also called human zoos.
At the time, performers of a human zoo would tour through Europe just like rock bands today. They were scheduled to do several presentations a day while visitors would gawk at them.
« In some cases, the performers had contracts, but they didn’t know what it meant to be part of Europe’s ethnological expositions, » says historian Anne Dreesbach. Most of them were homesick; some died because they didn’t manage to get vaccinated. That’s how an Inuit family, which was part of an exhibition, died of smallpox after shows in Hamburg and Berlin in 1880. Another group of Sioux Indians died of vertigo, measles and pneumonia.
Carl Hagenbeck’s exposition of ‘exotics’
A 1927 photo of Carl Hagenbeck, surrounded by the Somalians he put in a Hamburg zoo
Up until the 1930s, there were some 400 human zoos in Germany.
The first big ethnological exposition was organized in 1874 by a wild animal merchant from Hamburg, Carl Hagenbeck. « He had the idea to open zoos that weren’t only filled with animals, but also people. People were excited to discover humans from abroad: Before television and color photography were available, it was their only way to see them, » explains Anne Dreesbach, who published a book on the history of human zoos in Germany a few year ago.
An illusion of travel
The concept already existed in the early modern age, when European explorers brought back people from the new areas they had traveled to. Carl Hagenbeck took this one step further, staging the exhibitions to make them more attractive: Laplanders would appear accompanied by reindeer, Egyptians would ride camels in front of cardboard pyramids, Fuegians would be living in huts and had bones as accessories in their hair. « Carl Hagenbeck sold visitors an illusion of world travel with his human zoos, » says historian Hilke Thode-Arora from Munich’s ethnological museum.
« In these ethnological expositions, we embodied Europeans perception of ‘Africans’ in the 1920s and 30s – uneducated savages wearing raffia skirts, » explains Theodor Wonja Michael. He still remembers how strangers would stroke his curled hair: « They would smell me to check if I was real and talked to me in broken German or with signs. »
Hordes of visitors
Theodor Wonja Michael’s family was torn apart after the death of his mother, who was a German seamstress from East Prussia. A court determined that the father couldn’t properly raise his four children, and operators of a human zoo officially became the young Theodor’s foster parents in the 1920s. « Their only interest in us was for our labor, » explains Michael.
All four children were taken on by different operators of ethnological expositions and had to present and sell « a typical African lifestyle » for a curious public, like their father had done previously. For Theodor Wonja Michael, it was torture.
Just like fans want to see stars up close today, visitors at the time wanted to see Fuegians, Eskimos or Samoans. When one group decided to stay hidden in their hut during the last presentation of a day in a Berlin zoo in November 1881, thousands of visitors protested by pushing down fences and walls and destroying banks. « This shows what these expositions subconsciously triggered in people, » says Dreesbach.
Theodor Wonja Michael was nine years old when his father died in 1934, aged 55. He only has very few memories of him left. From his siblings’ stories, he knows that his father worked as an extra on silent films at the beginning of the 1920s. The whole family was brought with him to the studio and also hired as extras because they were viewed as « typically African. »
Several human zoos stopped running after the end of World War I. Hagenbeck organized his last show of « exotic people » in 1931 – but that didn’t end discrimination.
Theodor Wonja Michael’s book is available in German under the title, « Deutsch sein und Schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen » (Being German and also Black. Memoires of an Afro-German).
Voir de même:
REVIEW: The Strange Tale of a Coney Island ‘Doctor’ Who Saved 7,000 Babies
The Strange Case of Dr. Couney: How a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies by Dawn Raffel (Blue Rider Press, 284 pp.)
By Laura Durnell
The National Book Review
8.15. 2018
With a couturier’s skill, Dawn Raffel’s The Strange Case of Dr. Couney: How a Mysterious European Showman Saved Thousands of American Babies threads facts and education into a dramatic and highly unusual narrative. The enigmatic showman Martin Couney showcased premature babies in incubators to early 20th century crowds on the Coney Island and Atlantic City boardwalks, and at expositions across the United States. A Prussian-born immigrant based on the East coast, Couney had no medical degree but called himself a physician, and his self-promoting carnival-barking incubator display exhibits actually ended up saving the lives of about 7,000 premature babies. These tiny infants would have died without Couney’s theatrics, but instead they grew into adulthood, had children, grandchildren, great grandchildren and lived into their 70s, 80s, and 90s. This extraordinary story reveals a great deal about neonatology, and about life.
Raffel, a journalist, memoirist and short story writer, brings her literary sensibilities and great curiosity, to Couney’s fascinating tale. Drawing on extraordinary archival research as well as interviews, her narrative is enhanced by her own reflections as she balanced her shock over how Couney saved these premature infants and also managed to make a living by displaying them like little freaks to the vast crowds who came to see them. Couney’s work with premature infants began in Europe as a carnival barker at an incubator exposition. It was there he fell in love with preemies and met his head nurse Louise Recht. Still, even allowing for his evident affection, making the preemies incubation a public show seems exploitative.
But was it? In the 21st century, hospital incubators and NICUs are taken for granted, but over a hundred years ago, incubators were rarely used in hospitals, and sometimes they did far more harm than good. Premature infants often went blind because of too much oxygen pumped into the incubators (Raffel notes that Stevie Wonder, himself a preemie, lost his sight this way). Yet the preemies Couney and his nurses — his wife Maye, his daughter Hildegard, and lead nurse Louise, known in the show as “Madame Recht” — cared for retained their vision. The reason? Couney was worried enough about this problem to use incubators developed by M. Alexandre Lion in France, which regulated oxygen flow.
Today it is widely accept that every baby – premature or ones born to term – should be saved. Not so in Couney’s time. Preemies were referred to as “weaklings,” and even some doctors believed their lives were not worth saving. While Raffel’s tale is inspiring, it is also horrific. She does not shy away from people like Dr. Harry Haiselden who, unlike Couney, was an actual M.D., but “denied lifesaving treatment to infants he deemed ‘defective,’ deliberately watching them die even when they could have lived.”
Haiselden’s behavior and philosophy did not develop in a vacuum. Nazi Germany’s shadow looms large in Raffel’s book. Just as they did with America’s Jim Crow laws, Raffel acknowledges the Nazis took America’s late nineteenth and early twentieth century fascination with eugenics and applied it to monstrous ends in the T4 euthanasia program and the Holocaust. To better understand Haiselden’s attitude, Raffel explains the role eugenics played throughout Couney’s lifetime. She dispassionately explains the theory of eugenics, how its propaganda worked and how belief in eugenics manifested itself in 20th century America.
Ultimately, Couney’s compassion, advocacy, resilience, and careful maintenance of his self-created narrative to the public rose above this ignorant cruelty. True, he was a showman, and during most of his career, he earned a good living from his incubator babies show, but Couney, an elegant man who fluently spoke German, French and English, didn’t exploit his preemies (Hildegard was a preemie too). He gave them a chance at the lives they might not have been allowed to live. Couney used his showmanship to support all of this life-saving. He put on shows for boardwalk crowds, but he also, despite not having a medical degree, maintained his incubators according to high medical standards.
In many ways, Couney’s practices were incredibly advanced. Babies were fed with breast milk exclusively, nurses provided loving touches frequently, and the babies were held, changed and bathed. “Every two hours, those who could suckle were carried upstairs on a tiny elevator and fed by breast by wet nurses who lived in the building,” Raffel writes. “The rest got the funneled spoon.”
Yet the efforts of Dr. Couney’s his nurses went largely ignored by the medical profession and were only mentioned once in a medical journal. As Raffel writes in her book’s final page, “There is nothing at his grave to indicate that [Martin Couney] did anything of note.” The same goes for Maye, Louise and Hildegard. Louise’s name was misspelled on her shared tombstone (Louise’s remains are interred in another family’s crypt), and Hildegard, whose remains are interred with Louise’s, did not even have her own name engraved on the shared tombstone.
With the exception of Chicago’s Dr. Julius Hess, who is considered the father of neonatology, the majority of the medical establishment patronized and excluded Couney. Hess, though, respected Couney’s work and built on it with his own scientific approach and research; in the preface to his book Premature and Congenitally Diseased Infants, Hess acknowledges Couney “‘for his many helpful suggestions in the preparation of the material for this book.’” But Couney cared more about the babies than professional respect. His was a single-minded focus: even when it financially devastated him to do so, he persisted, so his preemies could live.
A Talmud verse Raffel cites early in her book sums up Martin Couney: “If one saves a single life, it is as if one has saved the world.” The Strange Case of Dr. Couney gives Couney his due as a remarkable human being who used his promotional ability for the betterment of premature infants, and for, 7,000 times over, saving the world.
Laura Durnell’s work has appeared in The Huffington Post, Fifth Wednesday Journal, Room, The Antigonish Review, Women’s Media Center, Garnet News, others. She currently teaches at DePaul University, tutors at Wilbur Wright College, one of the City Colleges of Chicago, and is working on her first novel. Twitter handle: @lauradurnell
Voir par ailleurs:
Une Théorie du complot, c’est quoi ?
 Une théorie du complot (on parle aussi de conspirationnisme ou de complotisme) est un récit pseudo-scientifique, interprétant des faits réels comme étant le résultat de l’action d’un groupe caché, qui agirait secrètement et illégalement pour modifier le cours des événements en sa faveur, et au détriment de l’intérêt public. Incapable de faire la démonstration rigoureuse de ce qu’elle avance, la théorie du complot accuse ceux qui la remettent en cause d’être les complices de ce groupe caché. Elle contribue à semer la confusion, la désinformation, et la haine contre les individus ou groupes d’individus qu’elle stigmatise.Les 7 commandements de la théorie du complot
Une théorie du complot (on parle aussi de conspirationnisme ou de complotisme) est un récit pseudo-scientifique, interprétant des faits réels comme étant le résultat de l’action d’un groupe caché, qui agirait secrètement et illégalement pour modifier le cours des événements en sa faveur, et au détriment de l’intérêt public. Incapable de faire la démonstration rigoureuse de ce qu’elle avance, la théorie du complot accuse ceux qui la remettent en cause d’être les complices de ce groupe caché. Elle contribue à semer la confusion, la désinformation, et la haine contre les individus ou groupes d’individus qu’elle stigmatise.Les 7 commandements de la théorie du complot
1. Derrière chaque événement un organisateur caché tu inventeras
 Derrière chaque actualité ayant des causes accidentelles ou naturelles (mort ou suicide d’une personnalité, crash d’avion, catastrophe naturelle, crise économique…), la théorie du complot cherche un ou des organisateurs secrets (gouvernement, communauté juive, francs-maçons…) qui auraient manipulé les événements dans l’ombre pour servir leurs intérêts : l’explication rationnelle ne suffit jamais. Et même si les événements ont une cause intentionnelle et des acteurs évidents (attentat, assassinat, révolution, guerre, coup d’État…), la théorie du complot va chercher à démontrer que cela a en réalité profité à un AUTRE groupe caché. C’est la méthode du bouc émissaire.
Derrière chaque actualité ayant des causes accidentelles ou naturelles (mort ou suicide d’une personnalité, crash d’avion, catastrophe naturelle, crise économique…), la théorie du complot cherche un ou des organisateurs secrets (gouvernement, communauté juive, francs-maçons…) qui auraient manipulé les événements dans l’ombre pour servir leurs intérêts : l’explication rationnelle ne suffit jamais. Et même si les événements ont une cause intentionnelle et des acteurs évidents (attentat, assassinat, révolution, guerre, coup d’État…), la théorie du complot va chercher à démontrer que cela a en réalité profité à un AUTRE groupe caché. C’est la méthode du bouc émissaire.
2. Des signes du complot partout tu verras
 La théorie du complot voit les indices de celui-ci partout où vous ne les voyez pas, comme si les comploteurs laissaient volontairement des traces, visibles des seuls « initiés ». Messages cachés sur des paquets de cigarettes, visage du diable aperçu dans la fumée du World Trade Center, parcours de la manifestation Charlie Hebdo qui dessinerait la carte d’Israël… Tout devient prétexte à interprétation, sans preuve autre que l’imagination de celui qui croit découvrir ces symboles cachés. Comme le disait une série célèbre : « I want to believe ! »
La théorie du complot voit les indices de celui-ci partout où vous ne les voyez pas, comme si les comploteurs laissaient volontairement des traces, visibles des seuls « initiés ». Messages cachés sur des paquets de cigarettes, visage du diable aperçu dans la fumée du World Trade Center, parcours de la manifestation Charlie Hebdo qui dessinerait la carte d’Israël… Tout devient prétexte à interprétation, sans preuve autre que l’imagination de celui qui croit découvrir ces symboles cachés. Comme le disait une série célèbre : « I want to believe ! »
3. L’esprit critique tu auras… mais pas pour tout
La théorie du complot a le doute sélectif : elle critique systématiquement l’information émanant des autorités publiques ou scientifiques, tout en s’appuyant sur des certitudes ou des paroles « d’experts » qu’elle refuse de questionner. De même, pour expliquer un événement, elle monte en épingle des éléments secondaires en leur conférant une importance qu’ils n’ont pas, tout en écartant les éléments susceptibles de contrarier la thèse du complot. Son doute est à géométrie variable.
4. Le vrai et le faux tu mélangeras
 La théorie du complot tend à mélanger des faits et des spéculations sans distinguer entre les deux. Dans les « explications » qu’elle apporte aux événements, des éléments parfaitement avérés sont noués avec des éléments inexacts ou non vérifiés, invérifiables, voire carrément mensongers. Mais le fait qu’une argumentation ait des parties exactes n’a jamais suffi à la rendre dans son ensemble exacte !
La théorie du complot tend à mélanger des faits et des spéculations sans distinguer entre les deux. Dans les « explications » qu’elle apporte aux événements, des éléments parfaitement avérés sont noués avec des éléments inexacts ou non vérifiés, invérifiables, voire carrément mensongers. Mais le fait qu’une argumentation ait des parties exactes n’a jamais suffi à la rendre dans son ensemble exacte !
5. Le « millefeuille argumentatif » tu pratiqueras
C’est une technique rhétorique qui vise à intimider celui qui y est confronté : il s’agit de le submerger par une série d’arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance, pour remplacer la qualité de l’argumentation par la quantité des (fausses) preuves. Histoire, géopolitique, physique, biologie… toutes les sciences sont convoquées – bien entendu, jamais de façon rigoureuse. Il s’agit de créer l’impression que, parmi tous les arguments avancés, « tout ne peut pas être faux », qu’ »il n’y a pas de fumée sans feu ».
6. La charge de la preuve tu inverseras
I ncapables (et pour cause !) d’apporter la preuve définitive de ce qu’elle avance, la théorie du complot renverse la situation, en exigeant de ceux qui ne la partagent pas de prouver qu’ils ont raison. Mais comment démontrer que quelque chose qui n’existe pas… n’existe pas ? Un peu comme si on vous demandait de prouver que le Père Noël n’est pas réel.
ncapables (et pour cause !) d’apporter la preuve définitive de ce qu’elle avance, la théorie du complot renverse la situation, en exigeant de ceux qui ne la partagent pas de prouver qu’ils ont raison. Mais comment démontrer que quelque chose qui n’existe pas… n’existe pas ? Un peu comme si on vous demandait de prouver que le Père Noël n’est pas réel.
7. La cohérence tu oublieras
A force de multiplier les procédés expliqués ci-dessus, les théories du complot peuvent être totalement incohérentes, recourant à des arguments qui ne peuvent tenir ensemble dans un même cadre logique, qui s’excluent mutuellement. Au fond, une seule chose importe : répéter, faute de pouvoir le démontrer, qu’on nous ment, qu’on nous cache quelque chose. #OnTeManipule !
Voir enfin:
« Le clip de Nick Conrad illustre la montée de la haine raciale en France »
Céline Pina
Le Figaro
28/09/2018
FIGAROVOX/TRIBUNE – Réagissant au clip du rappeur Nick Conrad appelant à massacrer des «Blancs», Céline Pina assure que cet épisode n’est que la partie visible d’une idéologie raciste de plus en plus violente, prenant les «Blancs» pour cible.
Ancienne élue locale, Céline Pina est essayiste et militante. Elle avait dénoncé en 2015 le salon de «la femme musulmane» de Pontoise et a récemment publié Silence Coupable (éd. Kero, 2016). Avec Fatiha Boutjalhat, elle est la fondatrice de Viv(r)e la République, mouvement citoyen laïque et républicain, appelant à lutter contre tous les totalitarismes et pour la promotion de l’indispensable universalité des valeurs républicaines.
«Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs,
attrapez-les vite et pendez leurs parents
Écartelez-les pour passer le temps
Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands.
Fouettez-les fort, faites-le franchement,
Que ça pue la mort, que ça pisse le sang»
Si vous pensez que l’État islamique donne maintenant ses ordres en rimes laborieuses ou que la nouvelle mode est de semer la haine et de lancer des appels au meurtre en chanson, c’est, d’après l’auteur de ce texte, que vous êtes plein de préjugés racistes. Certes tuer des enfants dans les écoles ou les crèches est bien un mot d’ordre que les terroristes islamistes ont lancé, certes le clip de ce rappeur appelle au meurtre de masse des Blancs, mais, selon ses défenseurs, il s’agit d’Art, de création, d’amour incompris. En fait, être choqués par ces paroles, témoignerait d’un refus collectif de prendre conscience de nos fautes et de celles de nos pères et serait un effet de notre racisme ontologique puisque le rappeur explique avoir voulu «inverser les rôles, (…) le système, de manière à ce que Blancs comme noirs puissent se rendre compte de la situation.». Son clip serait «une fiction qui montre des choses qui sont vraiment arrivées au peuple noir.». Rappelons qu’il s’agit ici de montrer des actes de torture, d’humiliation puis l’exécution d’un homme blanc, le tout filmé avec une jouissance sadique.
Au regard de la ligne de défense du rappeur on peut constater d’abord que s’il chante la haine, c’est qu’il la porte en lui. Il la légitime d’ailleurs par l’histoire. Dans son imaginaire et sa représentation du monde, tuer des «blancs» est une œuvre de justice pour un «noir» puisqu’il ne ferait que remettre les compteurs de l’histoire à zéro et venger les souffrances de son peuple, victime de l’esclavage. Sauf que pour raisonner ainsi il faut être profondément inculte et ne pas craindre la falsification historique. L’historien Olivier Petré-Grenouilleau a travaillé sur l’histoire des traites négrières. À l’époque il fut violemment attaqué car son travail déconstruisait un discours idéologique visant à réduire l’esclavage à la seule histoire de l’oppression de l’homme blanc sur l’homme noir. Or la réalité est bien plus diverse. Il y eut trois types de traite: la traite africaine, celle où des noirs capturaient et vendaient des esclaves noirs, on estime cette traite à 14 millions de personnes déportées. La traite arabo-musulmane où les marchands arabes capturaient et vendaient des esclaves noirs, celle-ci a concerné 17 millions d’individus et avait une particularité notable, la castration systématique de tous les hommes. Enfin la traite transatlantique, celle des «blancs», qui a concerné 11 millions d’individus.
Au vu de ce triste constat, nul ne peut pavoiser. Aucune couleur de peau ne peut revendiquer un quelconque avantage moral sur l’autre. En revanche, ce sont les Européens qui ont aboli les premiers l’esclavage, à l’issue d’un travail intellectuel et politique amorcé durant Les Lumières, qui changèrent la conception de l’homme et de la société. Grâce au concept d’égale dignité de l’être humain, il devenait impossible pour un homme d’en posséder un autre. Cette idée d’égalité est une construction, une représentation, une vision de l’homme et du monde qui rendit l’esclavage illégitime. En Europe, cette situation perdure car elle est liée à une perception du monde sur laquelle nous nous efforçons d’appuyer nos lois et nos mœurs. En Afrique et en Orient, l’esclavage existe encore (souvenez-vous des images du marché d’esclaves en Libye) et le combat pour l’abolir complètement est très discret, alors que la mémoire de l’esclavage, en Occident, finie par être instrumentalisée à des fins politiques douteuses. L’esclavage n’intéresse les idéologues gauchistes que pour faire le procès du blanc et justifier tous les passages à l’acte. Ce qui ne sert ni la connaissance historique, ni la lutte contre les discriminations.
Quant à l’excuse par l’art, mobilisée pour donner un boulevard à la haine et censurer ceux qui s’en indignent, elle a pour corollaire le droit de juger et de rejeter du spectateur. Elle a également pour limite l’appel au meurtre. Souvenez-vous de la radio Mille collines au Rwanda. Un bien joli nom pour une entreprise génocidaire. A coup d’appels enflammés et de texte haineux auquel celui-ci n’a rien à envier, elle sema sciemment la détestation et la mort. Et elle fut entendue. Largement.
C’est ce que fait à son niveau ce rappeur. Car son délire ne lui appartient pas en propre. Il relaie une logique, un discours de haine et un projet politique qui a été forgé d’abord aux États-Unis et qui revient ici porté par le PIR (Parti des Indigènes de la République), par l’extrême-gauche et par leurs alliés islamistes. Ce discours de haine raciale est légitimé et s’installe dans nos représentations car cette idéologie trouve des relais politiques et intellectuels. Elle se développe même au sein des universités à travers l’imposture du champ des études post-coloniales, où l’on préfère souvent former des activistes politiques, plutôt que s’astreindre à l’aride rigueur de la démarche scientifique. Ce discours est porté politiquement dans les banlieues où il construit les représentations des jeunes, il est accueilli dans les médias mainstream où les lectures raciales de la société se développent de plus en plus. Cette dérive violente est nourrie par un travail politique mené par des forces identifiables et il porte ses fruits: oui, il y a bien un racisme «anti-blancs» qui se développe dans les banlieues. Oui, on peut se faire agresser pour le seul crime d’être «blanc». Oui, la montée de la haine raciale aujourd’hui participe aux passages à l’acte et à l’explosion de la soi-disant violence gratuite.
Mais cela, une partie du système médiatique le nie, participant aussi à la légitimation de ceux qui font monter les tensions raciales. Imaginons juste qu’un chanteur ait chanté les mêmes horreurs à propos des noirs. Croyez-vous que la presse lui aurait ouvert ses colonnes pour qu’il se justifie? N’eût-il été immédiatement mis au ban par ses pairs? Quand les bien-pensants réclament qu’Eric Zemmour soit interdit d’antenne, alors que sa sortie ridicule n’a rien à voir de près ni de loin avec un appel au meurtre, ils sont curieusement muets quand il s’agit d’un rappeur pourtant indéfendable sur le fond et qui, lui, lance des appels à la haine.
Pire encore, pour ne pas avoir à se positionner sur des sujets épineux, ils vont jusqu’à nier la réalité. C’est Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui refuse de voir monter la haine raciale érigée en posture politique et estime que le racisme anti-blanc n’est qu’une invention de l’extrême-droite. Même son de cloche chez le député France insoumise Eric Cocquerel. En cela, la justification du rappeur qui prétend «inverser», mettre le blanc à la place du noir et évoque un clip copié sur le passage d’un film américain où deux membres du Klu Klux Klan font subir les mêmes atrocités à un homme noir, est calibrée pour fermer la bouche à ceux qui confondent gauche et repentance. Et cela marche. Pourtant le raisonnement sous-tendu par cette référence est stupide: les membres du KKK appartiennent à une idéologie particulière. Ils ne sont pas des références, ni des modèles, encore moins des exemples. Ils font honte à leurs concitoyens et leurs idées politiques sont combattues et rejetées. Ils ne représentent pas les «blancs». Leur donner une telle portée symbolique, c’est un peu comme confondre nazi et allemand ou islamistes et musulmans.
Quant à l’ultime provocation du rappeur, le fait que d’après lui, si on creuse un peu, derrière le couplet «pendez les blancs», c’est de l’amour que l’on entend, nous avons déjà eu droit à ce salmigondis stupide quand Houria Bouteldja a tenté de défendre son livre raciste: «les Blancs, les Juifs et nous». Et s’il fallait une preuve de ce que ce rappeur pense vraiment, la phrase de Malcom X qui clôt son clip nous le rappelle: «Le prix pour faire que les autres respectent vos droits humains est la mort.». Une phrase qui ne peut être entendue par les jeunes que comme un appel au meurtre dans le contexte du clip. Pire, même, qui voit dans le fait de donner la mort, la marque de ceux qui savent se faire respecter. Phrase toute aussi terrible et impressionnante que fausse: le prix pour faire que les autres respectent vos droits est la reconnaissance de l’égale dignité des êtres humains, la fraternité qui naît du partage de cette condition humaine et les devoirs qu’elle nous donne les uns envers les autres. Et la couleur de la peau n’a aucune importance dans cette histoire-là.
Voir par ailleurs:
Un safari parc transformé en exposition coloniale
Françoise Lancelot
L’Humanité
13 Avril 1994
Le temps des expositions coloniales serait-il revenu? L’affaire que vient de révéler le Syndicat des musiciens CGT de Loire-Atlantique rappelle, en tout cas, beaucoup cette période peu glorieuse de la République. Elle fait grand bruit dans le département. Au «Safari Parc» de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique, vingt-cinq hommes, femmes et enfants venus tout droit de Côte-d’Ivoire, vont devoir, pendant sept mois, travailler, s’exposer et danser en tenue traditionnelle devant le public fréquentant le zoo. Il y a quelques jours, «Ouest France» publiait en une une photo racoleuse ne correspondant guère à l’éthique déclarée de ce quotidien: une Africaine aux seins nus faisait de la publicité pour le «village africain» de Port-Saint-Père. Ce beau parc animalier, créé il y a un an et qui bénéficie du soutien du conseil général, a déjà accueilli 450.000 visiteurs au milieu de ses 100 hectares, d’animaux et de constructions reconstituant l’univers africain.
Constructions qui jusqu’ici étaient restées vides. Le directeur, Dany Laurent, a tenté d’expliquer à «l’Humanité» le recours à des personnages réels: «Dans le village traditionnel, il y aura des artisans et des danseurs. Non, la publicité n’était pas exagérée: dans la danse des jeunes filles, les seins sont nus. J’ai moi-même choisi tout le monde dans les villages de brousse. Ils sont tous volontaires et sont hébergés dans nos bâtiments. Ils vivent ici comme en Afrique: pour eux, il n’y a que le sol qui change…»
Un voyeurisme qui choque
Le directeur espère 600.000 visiteurs cette année et un grand succès touristique pour la Côte-d’Ivoire. Car, il le précise bien, «je ne suis pas l’employeur. J’ai signé une convention spéciale avec le ministère du Tourisme ivoirien, dont ces vingt-cinq personnes dépendent». Résultat, les Africains n’ont pas de visa de travail, pas de salaire (une indemnité a été versée au village dont ils dépendent, et seul l’ancien de la troupe reçoit une somme d’argent, qu’il est chargé de distribuer à son gré. Pas de Sécurité sociale non plus. «En cas de maladie, ils seront rapatriés dans leur pays», annonce sans état d’âme le directeur. Interrogé sur la scolarisation des enfants, il explique qu’ils n’iront pas à l’école du village, mais seront pris en charge par l’ancien «comme dans une école de cirque», a-t-il déclaré à «Ouest France».
A l’aube de l’an 2000, on reste stupéfait devant une telle exhibition, digne des expositions coloniales d’antan. La vie des peuples africains aujourd’hui a-t-elle un quelconque rapport avec cette présentation en parallèle d’animaux vivant en semi-liberté et d’hommes et de femmes auquel on demande de mimer leur propre existence devant des touristes – sous un autre climat, dans une société qui leur est complètement étrangère et derrière les grilles d’un parc? Ce voyeurisme choque, alors même qu’à 30 kilomètres de là, à Nantes, ancien port négrier, une exposition sur la traite des Noirs, «Les anneaux de la mémoire» touche à sa fin…
Un projet rétrograde
Lundi, les musiciens CGT ont, lors d’une conférence de presse, dénoncé cette atteinte au droit du travail et ces atteintes à la dignité de l’homme. Ils ont saisi la préfecture (qui a accordé des visas de tourisme, mais qui estime que tout est en règle), alerté la DDASS au sujet des enfants (qui ne sont apparemment pas avec leurs parents) et demandé à l’inspecteur du travail d’intervenir et de prononcer la fermeture du parc, tant que la situation de ces hommes et de ces femmes n’aura pas été régularisée.
«Ce sont les lois sociales françaises et le statut des artistes en représentation qui s’appliquent, cela d’autant plus que la troupe est là pour sept mois…» Une exception, dira-t-on? Tolérer ce genre d’accord, n’est-ce pas demain ouvrir la porte ici à une réserve d’Indiens, là un village d’Esquimaux, un bantoustan africain, tous sous-payés et échappant aux lois sociales.
C’est aujourd’hui qu’a lieu l’inauguration du village, en présence du premier ministre ivoirien et de trois autres ministres de cet Etat et d’une large délégation d’élus français. On en saura peut-être plus alors sur les hautes personnalités françaises qui ont permis à ce projet rétrograde de voir le jour.
Voir de plus:
“Our culture and traditional dress are what attract tourists to our coast,” Mbura told The Anadolu Agency in an interview.
“There were times when you would enter a hotel and find our girls dance traditional Mijikenda dances. They would dance bare-chested, with their firm breasts for all to see,” she said.
“How will we attract back the tourists back if all our women are wearing modern clothes like jeans and miniskirts?” asked Mbura, herself a member of the Mijikenda tribe.
She said that when tourists come to Mombasa, they want to visit the Old Town and eat traditional Swahili and Arab food.
“And if they go to Mijikenda towns and villages, they want to see the traditional dress of the Mahando,” she added.
Mijikenda women, like many other African tribes in Kenya, went topless before the arrival of the Arabs and British colonizers and the ensuing spread of Islam and Christianity.
“When the Mijikenda started wearing clothes, tourism slumped – besides the impact of insecurity,” Mbura, a Christian, said on Facebook on Tuesday.
She told AA that her suggestion was meant to help the local tourism sector, still reeling from a spate of recent terrorist attacks.
“I only want to see the tourism sector revamped,” the lawmaker insisted. “The coast depends on tourism. It has been a difficult ride for many locals since tourists stopped visiting.”
She added: “I once worked at a hotel and lost my job when tourists stopped coming, so I know what it feels like.”
Kenya’s coastal region is known for its sandy beaches, its historical Swahili-Arab heritage sites and its cultural diversity.
Recent attacks – blamed on Somalia’s Al-Shabaab militant group and rising militancy among the youth – have led several western countries to issue travel advisories to their citizens against travelling to the area.
After agriculture, tourism represents Kenya’s second biggest foreign currency earner.
-Rebuked-
Mbura’s suggestion has drawn the rebuke of many Kenyans.
“This is a culture of the past; the dignity of women must be maintained,” Sheikh Abdullah al-Mandhry, a Muslim religious leader in Mombasa, told AA.
“The senator’s suggestion borders on immoral,” he asserted. “This is pushing our women to prostitution in the name of saving of our economy.”
The Mombasa and Coast Tourist Association (MCTA) likewise criticized the proposal.
“The senator’s statement was unfortunate,” Millie Odhiambo, CEO of the MCTA, told AA. “How will we classify this when marketing our destination?”
“It’s a product that isn’t marketable and not sustainable. We also reject it on moral grounds,” insisted Odhiambo. “On the contrary, it will lower or standards as a world-class destination.”
Local social media, meanwhile, has been abuzz with debate over Mbura’s suggestion.
“Someone tell Senator Emma Mbura that nudity isn’t the answer to everything,” Betty Waitherero, a popular Kenyan blogger, tweeted. “I blame thinking based on genitalia.”
A twitter account under the name “Mr B” called on Senator Mbura to “lead by example on her tourist attraction suggestion.”
Another commentator, Sir Chege wa KImani, blasted Mbura’s critics.
“Kenyans are funny. You shouted from rooftops, ‘my dress, my choice’ – now you condemn Emma Mbura,” KImani tweeted, in reference to recent protests by women and rights activists following a spate of attacks on women wearing miniskirts.
“What changed?” KImani asked.
Voir encore:
Les femmes seins nus vont-elles sauver le tourisme kenyan ?
Au Kenya, une sénatrice a exhorté les femmes à revêtir l’habit traditionnel pour attirer davantage de touristes. Problème : certaines tenues propres à la culture nationale laissent apparaître la poitrine. Est-il nécessaire de se dénuder pour promouvoir son pays ? La proposition de l’élue a suscité un vif débat sur la toile.
Antoine Lagadec
Terrafemina
21 juillet 2015
En prenant la question du tourisme à bras le corps, Emma Mbura ne s’attendait pas à se trouver sous le feu de telles critiques. Sénatrice de la région côtière du Kenya depuis mars 2013, l’élue affirmait en début d’année la nécessité pour la communauté Mijikenda (qui regroupe les neuf tribus établies le long des côtes du Kenya, de la Somalie et de la Tanzanie) de mettre en valeur toute la richesse de sa culture pour faire revenir les touristes dans la région.
Le tourisme dépendant des tenues traditionnelles ?
Parmi les conseils de la sénatrice établie à Mombasa, le recours aux tenues traditionnelles, comme le mahando ou leso, jugées par Emma Mbura comme un atout majeur de la promotion du Kenya et l’un des leviers pour remettre à flot le secteur clé du tourisme. En berne depuis plus de deux, ce dernier pâtit en effet de l’insécurité et des menaces terroristes dans le pays, le Kenya ayant été le théâtre de plusieurs attentats, attribués aux sympathisants des shebab.
La proposition aurait pu passer inaperçue si elle n’impliquait pas, pour les femmes concernées sur la côte kenyanne, de laisser tomber le haut pour laisser apparaître leur poitrine, comme l’imposent certaines tenues auxquelles fait référence la sénatrice. « Elles n’habillent que le bas du corps avec le mahando, ce qui attire les touristes, a affirmé Emma Mbura au quotidien Nation. Comme vous le savez, les femmes Mijikenda sont naturellement belles ». Et la sénatrice d’enfoncer le clou en interrogeant le lien de cause à effet qui pourrait exister selon elle entre les tenues des Kenyannes et l’activité touristique du pays : « Quand les Mijikenda ont commencé à s’habiller, le tourisme s’est effondré. Serait-ce à une des raisons pour lesquelles nous attirions les touristes ? ».
Si des femmes n’ont vu aucun inconvénient à revêtir l’habit traditionnel, d’autres se sont montrées sceptiques, compte tenu du contexte actuel. Mais les plus violentes réactions sont venues des réseaux sociaux où de nombreux habitants se sont indignés du peu de considération de la parlementaire, prête à sacrifier la pudeur de ses compatriotes sur l’autel de la réussite économique du pays. Certains allant même jusqu’à demander à la sénatrice de montrer l’exemple, non sans ironie.
Sentant le vent tourner, Emma Mbura a tenté courant mars de se défendre, argumentant qu’elle n’avait jamais demandé aux habitantes de la région de se dévêtir. « Je n’ai jamais demandé à personne de se mettre nu. Mais nous devons savoir d’où nous venons », a-t-elle soutenu lors d’une interview à la chaîne de télévision kenyanne K24. « Ce sont mes opinions. Je demandais seulement si les Mijikenda renouaient avec leur culture, raviverait-on le secteur du tourisme ? » Joignant le geste à la parole, la sénatrice a même participé à une conférence quelques jours plus tard, en arborant une tenue traditionnelle.
D’autres pays d’Afrique ont appris à faire commerce de leur tradition s’est encore défendue Emma Mbura dans un post Facebook. « Vous êtes vous déjà demandé pourquoi les films du Nigeria, du Ghana ou de la Tanzanie se vendaient mieux que le reste des films africains ? La réponse est simple : la Culture. Ils ont incorporé leur culture dans le cinéma et la musique », a écrit la sénatrice dans un parallèle à peine voilé à la récente polémique.
Incorporer la culture nationale dans les arts et le tourisme n’est pourtant pas synonyme de nudité forcée. Face à ces déclarations, beaucoup accusent Mbura d’avoir voulu se mettre en scène. Les récents évènements internationaux, et notamment la menace terroriste, sont peu à peu en train de mettre à mal l’économie nationales. Plages désertées, hôtels laissés à l’abandon… Avec à peine plus d’un million de touristes en 2013, le Kenya a enregistré une baisse de fréquentation de 11 % par rapport à 2012. Les années 2014 et 2015 ne devraient pas apporter de signe d’amélioration notable pour les habitants des zones concernéees.
Voir enfin:
Nobukhosi Mtshali felt a little lost when she first arrived in Johannesburg. She was beginning a degree in education at Wits University, and Johannesburg felt a world away from where she grew up, just outside Pietermaritzburg. Here, in the big city, it was hard to find space to express her traditions and culture.
“In Joburg, people say, wow, that’s different, no we don’t do that. It was a shock at first,” she told the Mail & Guardian.
For example, on Heritage Day, there were a lot of women walking around with traditional clothes, she says. “But everyone had their breasts covered. But at a traditional gathering at home I could walk around with my breasts uncovered. In Joburg, if I did that, it would be a mess. It’s almost like we’ve been told that we have to cover up, that we are backward.”
Now four years into her degree, Mtshali has found her place in the city. She has conversations with her friends about their cultural differences – and similarities – and she has also joined Gauteng-based cultural societies.
“We get together, we do dance practises, we sing songs … We do the Reed Dance together. Not only are we learning about our culture and traditions, things we wouldn’t normally receive through mainstream culture, but you interact with other girls so you know you’re not alone in your view and how you are.”
Like most university students, Mtshali and her friends are active on social media, and they would enthusiastically share images and videos of themselves singing and dancing on sites like YouTube and Facebook.
But they noticed that something strange was happening to many of the videos that showed their bare breasts: they were being marked as “age-restricted” by YouTube, or taken down entirely, as if the content was somehow sexual in nature.
“The last Reed Dance, we got all excited, we wanted to show off. I could tell you that half of the girls…say their images had been taken down. You get this message saying your images are inappropriate,” she said.
For Mtshali this is a direct attack on her culture – and also a threat to the longevity of its traditions. “As black South Africans, we’ve always been told our culture is uncivilised, our culture is backward. Because of social media platforms reinforcing these stereotypes it becomes harder. As a young person why would you want to celebrate something that is constantly being mocked on social media platforms?”
Mtshali and her friends are not alone. Lazi Dlamini is the head of TV Yabantu, an online video production company that aims to produce content that “protects, preserves and restores African values”. The TV Yabantu YouTube channel launched in 2016, and it caught on quick, adding 3000-4000 new subscribers every month
And then, beginning in April last year, YouTube started slapping age restrictions on cultural content that featured bare-breasted women. Over 50 videos were affected. Viewer and subscriber numbers plummeted because the channel was now much harder to access.
At the same time, this content was labelled as “not suitable for most advertisers”, which hit TV Yabantu’s bottom line. Although the restrictions were applied haphazardly – some videos were deemed inappropriate, while others with similar content were left alone – the impact was significant.
“They started removing advertising from our videos, then the views started dropping, the revenues started dropping,” said Dlamini. “We don’t care about the revenues, we care about the insult to our culture.”
He contacted Google, which owns YouTube, to try and explain that his context was not inappropriate, but simply reflected the cultural values of his community. But Google didn’t buy it: they said the content violated the platform’s community standards, according to Dlamini.
“You talk about community standards, but you’re only talking about western community, not African community. But they did not engage with that. They just said these are our standard terms, if you don’t like it then you don’t have to use the platform,” said Dlamini.
Working with more than 200 cultural groupings across the country and in neighbouring Swaziland, Dlamini is organising a series of protests against Google to force them to rethink their position.
The first took place in Durban on Saturday, attracting around one hundred people, including at least a dozen women who posed bare-breasted with placards that read “Google a racist” and “My breasts are not inappropriate”.
On Thursday, Dlamini also sent a letter to Google, on behalf of TV Yabantu, slamming the company for its “cultural chauvinism” and its “eurocentric norms and practices”. He said Google used these platforms to “ruthlessly” enforce “racist policies and censorship on Africans” and especially degraded African women.
“You are an organisation that perpetrates racism, and oppression of black people, beliefs, culture and values.”
The Mail & Guardian contacted Google South Africa for comment, but the company did not respond in time to questions.
YouTube’s community guidelines on nudity state:
“A video that contains nudity or other sexual content may be allowed if the primary purpose is educational, documentary, scientific, or artistic, and it isn’t gratuitously graphic. For example, a documentary on breast cancer would be appropriate, but posting clips out of context from the same documentary might not be…In cases where videos do not cross the line, but still contain sexual content, we may apply an age-restriction so that only viewers over a certain age can view the content.”
For Mtshali, these community guidelines are not good enough. She said that in the modern world, when it is difficult enough already to cling on to traditions, Google is making it even harder.
“I, as a South African, want to celebrate my culture. Having my photos labelled as inappropriate or regarded as porn, I take that as a direct attack on my cultural heritage. I take it as a sign of ignorance. If I’m posing in a sexually suggestive manner that is one thing, but if I’m posting pictures of me standing there in my traditional attire, that is a completely different context,” she said.
“It gets so frustrating, so maddening to talk about it. You can shake your boobs in a music video and it’s fine, because its normalised. But you see a woman just standing there with their boobs out and then, oh, it’s offensive.”
Update: Subsequent to publication, the M&G received the following from a representative for Google: “Google says it has lifted the restriction on the videos that were age-restricted as it is not its policy to restrict nudity in such instances where it is culturally or traditionally appropriate.”









 Publié par jcdurbant
Publié par jcdurbant 





























