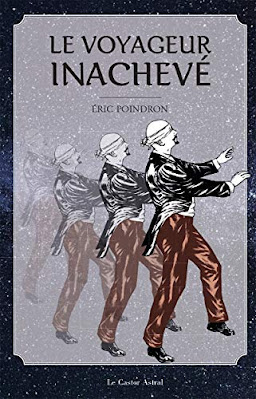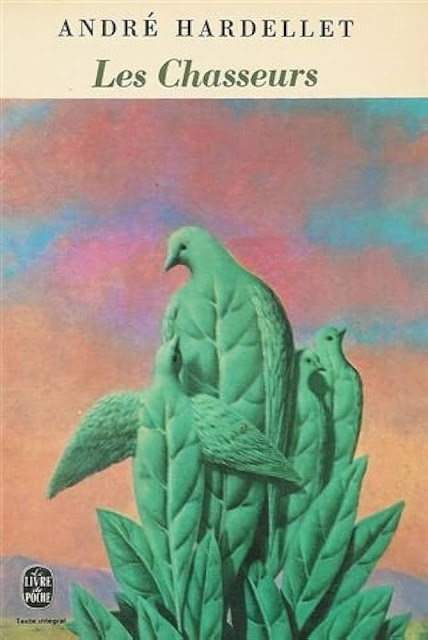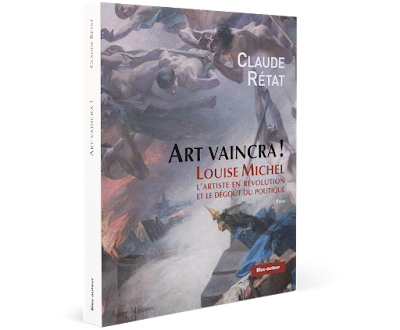A Aigurande, en ce jour de Toussaint, j'avais donc acheté Le Bal des Conscrits de Louis Peygnaud. A la ferme de La Font du Four, celle des grands-parents maternels où je naquis en 1960, il n'y avait en dehors des livres d'école que quelques livres de littérature générale, je me souviens de Typhon de Joseph Conrad et de cet ouvrage de Louis Peygnaud, De la vallée de George Sand aux collines de Jean Giraudoux, publié chez Charles-Lavauzelle en 1949, et couronné par l'Académie française.
Cette distinction n'a pas rendu l'homme célèbre et j'ai beaucoup peiné à trouver une notice biographique sur Louis Peygnaud (Google vous refourgue aussitôt une masse de sites sur Louis Pergaud, c'est très agaçant). En insistant, j'ai néanmoins trouvé quelques lignes sur le pdf d'un groupe de marcheurs de Bonnac-la-Côte en Haute-Vienne, département d'origine de Louis Peygnaud, né le 9 août 1895 dans le hameau de Chasseneuil (commune de Saint-Symphorien-sur-Couze). Après ses études primaires et secondaires, il rejoint l’école normale de Limoges. Mobilisé en 1915, il est blessé en 1918 et démobilisé en 1919. De retour à la vie civile, il est nommé instituteur à Saint-Sornin-Leulac en Haute-Vienne. En 1930, il passe l’examen d’inspecteur primaire, fonction qu’il exerce d’abord à Gordon-Murat en Corrèze et à partir de 1931 à La Châtre (Indre). Il y restera au-delà de sa retraite prise en 1958. Proche d’Aurore Dudevant (1866-1961), la petite-fille de George Sand, il était souvent invité à Nohant. Dans les dernières années de sa vie, il rejoint sa Haute-Vienne natale, où il s’éteint le 12 mai 1988 à l’âge de 92 ans. (Source : Bulletin des Amis du Vieux La Châtre, n°3, 2011).
Le Bal des Conscrits a été publié sans mention d'éditeur en 1968, imprimé par les bons soins de l'imprimerie Rault, fondée en 1934 par Arsène Rault pour son fils Roger, et toujours existante (reprise en 2017 par le groupe Paragon, elle est la seule entreprise importante qui subsiste à Aigurande). Le volume que j'ai acheté comporte une dédicace que je ne vois qu'aujourd'hui, et qui m'émeut car elle s'adresse à Monsieur et Madame Renaud : "Croyez bien que je n'ai pas oublié le temps de Crozon qui s'éloigne si vite !" Crozon qui est ma commune natale...
Le livre s'ouvre sur une citation de Chateaubriand, que Louis Peygnaud reprend et prolonge dans sa préface : "Dans une page admirable, Chateaubriand se souciait du sort réservé par l'avenir à la mémoire de tous ces paysans laissés en Russie - et ailleurs : "Il n'y a peut-être que moi qui, dans les soirées d'automne, en regardant les oiseaux du Nord, se souvienne qu'ils ont vu la tombe de nos compatriotes"."
Et Peygnaud poursuit ainsi : "Comme Chateaubriand, pourquoi, certains soirs autour de la Toussaint, ne resterions-nous pas attentifs à toutes ces voix étranges, mystérieuses, qui se mêlent au vent de la nuit ? Ces clameurs, ces plaintes dans le ciel ? : celle des âmes tourmentées qui n'ont pas eu accès au paradis, pensaient nos anciens, mais, bien sûr, point les âmes pures de nos infortunés petits conscrits." (p. 10-11)
La Toussaint était ainsi étrangement évoquée, jour même de l'achat du livre, et de la bande dessinée de Davodeau, Chute de vélo, où l'intrigue tourne autour du personnage de Toussaint, et de son terrible secret. Toussaint qui retrouve Irène, la grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, sur le bord de la rivière, au grand soulagement de ses enfants.
"Bon pour les filles ! » Le conseil de révision a tranché : bon pour le service, trois ans sous l’uniforme, la vie loin d’ici, du quotidien. Et l’honneur de ne pas avoir été réformé. Bon pour les filles…
Désiré, lui, n’a pas franchi la toise, pour se coiffer du képi et empoigner un Lebel. Pas de chance, et adieu Mathilde, la fille du boulanger, pourtant bien jolie. Les autres y étaient, eux, bon pour les filles. Et bientôt pour les tranchées, la boue. Bon pour la peur, la fosse commune ou le poteau d’exécution.
Alors, tout faire quand même, pour aider les copains, sur le front à quelques kilomètres de là. Pour exister aux yeux de Mathilde et de son cocardier de père. Le récit court, percutant, d’une tranche de guerre « à côté » : le désespoir de ne pas en être et l’apprentissage de l’horreur, pour les yeux d’une fille que l’on aura jamais."
"Bon pour les filles", c'est cet insigne militaire qu'on décernait au conscrit à l'issue du conseil de révision, et dont quelques exemples ornent le dos de couverture de l'album.
"Le 22 octobre 1914, sept garçons de dix-neuf ans s'en revenaient de Nantiat et regagnaient leurs villages de la vallée de la Couze. sur toutes les routes qui partaient du chef-lieu d'autres garçons cheminaient vers toutes les communes du canton. Ils venaient de passer le conseil de révision."
Ces sept garçons, on les retrouve pour ainsi dire dans cette case de la page 8 :

Or, à la page 27 du Bal des conscrits, Louis Peygnaud raconte une autre conscription, celle du 10 mars 1793, an II de la République, où eut lieu la première levée en masse de 300 000 hommes. De tous les villages affluaient les hommes célibataires ou veufs sans enfants de dix-huit à quarante ans. Le 15 juillet, l'Assemblée législative avait proclamé la Patrie en danger. De fait, cette première journée ayant donné peu de résultats, il fallut remettre le couvert le 17 mars. Ainsi, au Péchereau, près d'Argenton, seuls deux volontaires s'étaient inscrits le 10 mars. Et le 17, 45 hommes durent se soumettre à la voix du sort. Le maire avait préparé 33 bulletins blancs et 12 bulletins portant la mention "soldat", et chacun vient tirer un bulletin dans un chapeau : "Mais soudain, minute pathétique entre toutes, alors que sept volontaires nationaux viennent d'être désignés, voici que se présente devant le fatidique chapeau, non plus un garçon mais un homme d'environ cinquante ans, qui dissimule avec peine son émotion. C'est Sylvain LAMOUREUX, laboureur, qui vient tirer à la place de son fils empêché par la maladie. L'assistance, quelque peu animée, devient brusquement silencieuse. Tous les présents ont le sentiment de la gravité du geste de ce père qui va décider du sort de son enfant. Le père de François LAMOUREUX prend un billet et le tend au maire qui l'ouvre et annonce le fatidique : "soldat"."