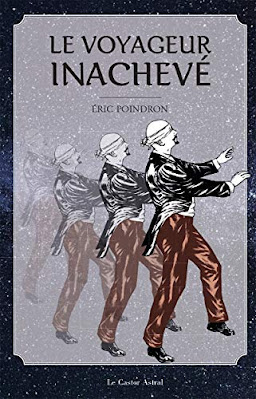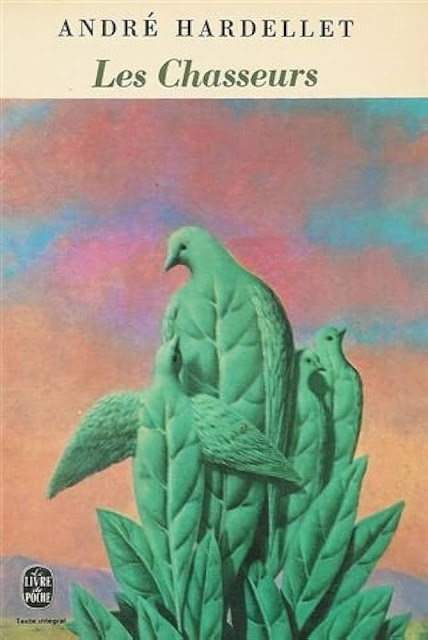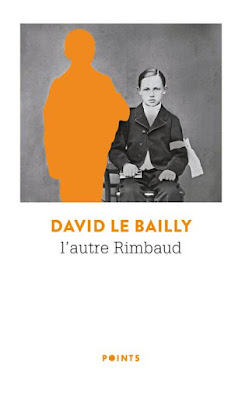"Je ne suis vraiment qu'un chasseur de souvenirs imaginaires..."
André Hardellet
Citation en exergue du livre Le voyageur inachevé d'Eric Poindron. Et cela seul aurait suffi à me convaincre d'emporter l'ouvrage en question, posé sur la table des nouveautés (ce qu'il n'est pas vraiment, ayant été publié en 2021). D'Eric Poindron, je ne connaissais que le blog Curiosa & Coetera, et n'avais lu aucun de ses nombreux livres. J'avais souvenir aussi d'une agréable causerie musicale l'an dernier au café Equinoxe à l'occasion de l'Envolée des livres, qu'il avait animé en compagnie, entre autres, de CharlElie Couture et de Jean-Pierre Siméon.
André Hardellet, l'un de ces écrivains méconnus et secrets que j'affectionne, que j'ai eu le plaisir de citer dans plusieurs articles, se trouvait donc être au début mais aussi à la conclusion de ce livre inclassable d'Eric Poindron, que Richard Blin, dans le Matricule des Anges de juin 2021, décrit fort justement : "Dans Le Voyageur inachevé, ce rôdeur des frontières du sens, ce disciple d’André Hardellet, « notre frère de chemins de tangente », ce chasseur de hasards et de coïncidences, qui se croit et s’espère « enfant naturel » de Restif de La Bretonne, nous propose un voyage à l’intérieur des livres qu’il aime, de la littérature et de lui-même ou plutôt du musée « aux pièces sombres et aux miroirs ombrageux » que chaque homme porte en lui. Un voyage en vingt-six nuits comme les vingt-six chapitres des Nuits d’octobre de Gérard de Nerval. "
"Chaque homme porte en lui un musée aux pièces sombres et aux miroirs ombrageux" est la première phrase de la Nuit I, "Vestibule en guise de préambule", page 17. Une première phrase que j'ai immédiatement notée parce qu'elle venait si fort en résonance avec le Tlön Uqbar Orbis Tertius de Borges, dont j'avais tiré chronique au matin même de de ce 27 janvier. Résonance avec la première phrase de la nouvelle que j'avais déjà relevée en ce qu'elle venait percuter la propre histoire de Serge Lehman : "C'est à la conjonction d'un miroir et d'une encyclopédie que je dois la découverte d'Uqbar. Le miroir inquiétait le fond d'un couloir d'une villa de la rue Gaona à Ramos Mejia ; l'encyclopédie s'appelle fallacieusement The Anglo-American Cyclopoedia (New York, 1917)."
Cette rencontre n'était pas fortuite. Borges n'allait pas tarder à se montrer ; c'était deux pages plus loin :
"Je pousse la mystification jusqu'au bord du précipice. L'art du faux ou du presque vrai est une bien séduisante vérité. Et le taquin voyant Borges d'ajouter qu'il n'est peut-être personne qui, pour écrire, ne se dédouble ou, pour le moins, n'exagère ses singularités et ses certitudes."
Et vingt pages en aval, encore, associé à cette réminiscence de l'Islay du troll de la rue Mouffetard :
"Il pleut des lanternes sur Inverness.Un jour, au bord du Loch Ness, par ce que les eaux froides ne sont jamais si froides. Un autre jour, sur l'Ile de Islay, pour des couchers de soleil qui durent encore plus longtemps que l'imaginationIl pleut sur les Borgesiana fragiles qui révèlent les secrets du temps et de l'autre." (p. 39)
 |
| Jorge Luis Borges, 1984 by Ferdinando Scianna |
Et, pour en finir provisoirement, cette allusion à Pierre Michon, dans la salle du bestiaire de la Nuit III :
"Avec Pierre, l'écrivain & homme de vigie, il nous arrive de converser quand les étoiles apparaissent, que les chats sont gris et que nous ne le sommes pas encore. Il me parle de mansuétude, du "chat-qui-s'en-va-tout-seul", de l'Argentine de Borges et de la Creuse. Nous sauvons des mots anciens et n'échafaudons aucune théorie. L'amitié, cette lanterne vivace qui éclaire les chemins de crête et de contrebande." (p. 41)
Cette rencontre de la Creuse et de l'Argentine me ravit particulièrement. Moi, l'Aigurandais, qui vécut si longtemps en cette frontière entre Indre et Creuse, sur la ligne de partage des eaux entre ces deux rivières, seuil entre cités gauloises rivales, Lémovices et Bituriges, dont les noms baptisèrent Bourges et Limoges, moi, l'Aigurandais qui inaugura en ce premier contrefort du Massif Central les longues amitiés qui durent toujours, et se ravivent chaque année en février, à la confluence des trois zones de vacances scolaires, réunissant les comparses dispersé(e)s en ce lieu désormais pour nous mythique de la Forêt-du-Temple, en Creuse précisément, juste à côté du monument aux morts où l'on peut lire qu'Emma Bujardet, après la mort de ses proches dans les lointaines tranchées de l'Argonne et d'ailleurs, mourut de chagrin.
Puis je m'avise aussi que deux des citations d'Eric Poindron comportent une lanterne. Mot clé : l'auteur dit d'ailleurs que le livre aurait pu s'intituler Le Flâneur de lanternes, expression qu'il reprend à la page suivante en l'associant au miroir : "Flâneur de lanternes et bibliographe consciencieux, il collectionnait les épigraphes et les logogriphes qu'il conservait derrière le miroir sans fond, dans les coulisses d'un musée battu par les vents du vieil harmonium." (p. 19)
Page 11, l'épigraphe du chapitre introductif, Sur le seuil, est empruntée une nouvelle fois à André Hardellet, et l'on ne sera pas surpris d'y observer une nouvelle lanterne (même si Vieille ici, pour le coup) :
"Il vous faudra seulement de la patience et le goût de humer le vent sur les bords de la Seine, ou parmi des rues dont je ne peux même pas vous garantir l'existence ; la rue de la Vieille-Lanterne par exemple."
Lanterne qui fascinait aussi Hardellet. Dans la préface à Les Chasseurs, ce petit livre merveilleux que je découvris en Poche alors que je n'avais pas vingt ans, avec une toile de Magritte en couverture, il met lui-même en épigraphe cette phrase d'André Breton, puisée dans Arcane 17 : "Où va si tard le voiturier, peut-être ivre, qui n'a même pas l'air d'avoir de lanterne ?", et commente ensuite :
"Soudain, au tournant de la page, une telle phrase nous arrête net ; nous y avons reconnu aussitôt le timbre que de très rares voix seulement nous permirent d'entendre, le don de faire lever les souvenirs de leurs sillons.Je tiens cette phrase, isolée de son contexte, pour un poème achevé qui, en trois lignes, s'étend jusqu'à de mystérieux territoires défendus par l'ombre."
"Ce voiturier, écrit-il un paragraphe plus loin, qui n'a pas besoin d'une lampe-tempête pour y voir clair dans l'obscurité, évoque cet autre enchanteur : R.L. Stevenson. Pew et John Silver se tient non loin de là, en alerte."
Sur le nom de Stevenson, une note de bas de page précise : "Parmi les vivants, je ne connais guère que Borges et Mac-Orlan qui rendent hommage convenablement à ce très grand écrivain."