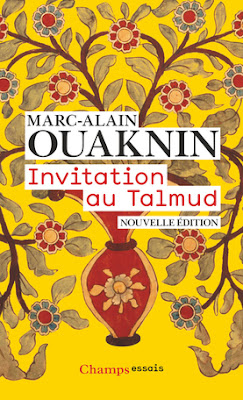C'est que les graphiques ne sont pas le tout de l'ouvrage : la moitié demeure sous forme de notes plus ou moins brèves, qui commentent et prolongent les dits-graphiques. Et ce que ces notes expriment le plus souvent, c'est un questionnement. D'ailleurs, dès le prologue, le ton est donné : "J'ai question à tout. C'est mon mode de fonctionnement depuis toujours. Je me demande en permanence ce que font les gens, pourquoi ils le font, à quoi ils pensent, autant de possibilités de mener une journée, une existence."
Le même jour où je lisais Delwart, je me suis replongé aussi dans L'invitation au Talmud de Marc-Alain Ouaknin (Champs-essais, 2018, nouvelle édition), et je suis tombé immédiatement sur un passage affirmant que la pensée talmudique est une pensée de la question :
"Étonnante langue hébraïque qui nous enseigne que le mot "homme", adam, possède la même valeur numérique que le mot mah qui veut dire "quoi ?". Cela ne revient-il pas à dire qu'il est impossible de définir l'homme ? L'homme n'est-il pas justement cet être tout à fait singulier qui échappe à toute possibilité de définition ? Cet existant qui se définit par l'absence de définition possible ? L'essence de l'homme n'est-elle pas de ne pas avoir d'essence ? Paradoxe que la langue hébraïque énonce parfaitement. L'essence se dit mahout, de la racine mah, signifiant "quoi ?". L'essence, mahout, est la "quoibilité", néologisme que nous créons pour dire cette essence questionnante de l'homme, cette questionnabilité qui maintient l'être ouvert à la possibilité de ses possibles et de son futur." (p. 146)
Sur la question, Charly Delwart cite encore l'écrivain espagnol Javier Cercas, avec un extrait de son livre Le point aveugle, recueil de cinq conférences données à Oxford :
De son côté, Marc-Alain Ouaknin en appelait à Flaubert - "L'interprétation c'est la patience du sens : pour renoncer, selon l'expression de Flaubert, à la "rage de vouloir conclure" - mais aussi à Milan Kundera et à son Art du roman, en sa dernière partie, Le discours de Jérusalem. L'art du roman, un essai que j'avais adoré. Je vais chercher le Folio dans la bibliothèque, la date au stylo vert (ce qui me surprend car j'use rarement du vert) donne le 25 avril 1995, à Lyon. Et c'est encore en vert que sont soulignés certains passages. Il y a d'abord cette expression "la sagesse du roman". "Tous les vrais romanciers, écrit Kundera, sont à l'écoute de cette sagesse supra-personnelle, ce qui explique que les grands romans sont toujours un peu plus intelligents que leurs auteurs. Les romanciers qui sont plus intelligents que leurs oeuvres devraient changer de métier." Et puis, quelques lignes plus loin : "Il y a un proverbe juif admirable : L'homme pense, Dieu rit. Inspiré par cette sentence, j'aime imaginer que François Rabelais a entendu un jour le rire de Dieu et que c'est ainsi que l'idée du premier grand roman européen est née. Il me plaît de penser que l'art du roman est venu au monde comme l'écho du rire de Dieu." (passages précis soulignés en vert).« Le roman n’est pas un genre responsif mais interrogatif : Écrire un roman consiste à se poser une question complexe et à la formuler de la manière la plus complexe possible, et ce, non pour y répondre ou pour y répondre de manière claire et certaine ; écrire un roman consiste à plonger dans une énigme pour la rendre insoluble, non pour la déchiffrer (à moins que la rendre insoluble soit, précisément, la seule manière de la déchiffrer). Cette énigme, c’est le point aveugle, et le meilleur que ces romans ont à dire, ils le disent à travers elle : à travers ce silence pléthorique de sens, cette cécité visionnaire, cette obscurité radiante, cette ambiguïté sans solution. Ce point aveugle, c’est ce que nous sommes. »
En cherchant pour ce billet le passage de Javier Cercas sur le point aveugle (par paresse, pour gagner du temps, copier-coller au lieu de recopier laborieusement), je suis parvenu sur un article de la revue en ligne Diacritik, écrit par Lucien Raphmaj en mars 2017. Où celui-ci invoque justement l'écrivain tchèque et son Art du roman :
"C’est au « premier moment du roman », celui inauguré par Don Quichotte selon Milan Kundera dans son Art du roman, que Cercas souhaite s’alimenter, revenant sur l’hybridation des genres si fertile désormais : « La littérature authentique ne rassure pas, elle inquiète ; elle ne simplifie pas la réalité, elle la complique. Les vérités de la littérature, surtout celle du roman, ne sont jamais claires, précises et manifestes, mais ambigües, contradictoires, polyédriques, fondamentalement ironiques »."
Cet article en appelait un autre, rédigé un an plus tôt par Christine Marcandier, toujours dans Diacritik, article où je trouvai la citation recherchée et qui se terminait par l'évocation d'un autre livre de Cercas, Mobile :
Flaubert est encore ici à l'honneur - et je vous prierai de prendre acte du vertigineuse qui mériterait bien d'enrichir la contribution flaubertienne à l'inventaire des vertiges. Notons enfin que la photo de la couverture de Mobile, avec son escalier en spirale ouvrant sur un trou noir, appelle en écho le Vertigo hitchcockien."Álvaro, le protagoniste de Mobile (comme avant lui Kafka ou ses personnages) travaille dans un cabinet juridique. Mais c’est surtout à la littérature qu’il a « subordonné » sa vie, la littérature qui, il le sait, est une « maîtresse exigeante« . Il se consacre à sa tâche, écrire « une œuvre ambitieuse de portée universelle« , de manière obsessionnelle, presque maladive. Après avoir hésité entre plusieurs formes, il choisit le roman, maintes fois mis à terre, en état de mort annoncé, pourtant toujours vivant puisqu’aucun autre « instrument ne pouvait capter avec une telle précision et une telle richesse de nuances la complexité infinie du réel« . En référence à Flaubert, il écrira donc « l’épopée inouïe de quatre personnages banals« , dont l’un, bien sûr, post-modernisme oblige, écrit justement un roman ambitieux. Le Mobile est l’épopée vertigineuse d’une écriture lancée dans sa propre recherche, l’aventure du roman et de son point aveugle, déjà."