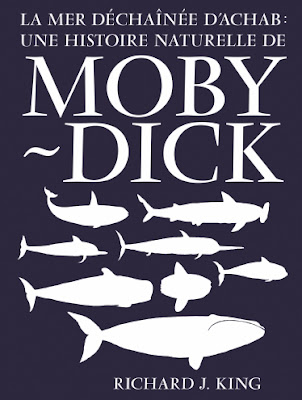L'âne
Parfois je rêve que Mario Santiago
Vient me chercher sur sa moto noire.
Et que nous quittons la ville et à mesure
Que les lumières disparaissent
Mario Santiago me dit qu'il s'agit
D'une moto volée, la dernière moto
Volée pour voyager dans les terres pauvres
Du Nord, direction le Texas,
A la poursuite d'un rêve innommable
Inclassable, le rêve de notre jeunesse,
C'est-à-dire le rêve le plus courageux de tous
Nos rêves. [...]
Roberto Bolaño, Poèmes, Points/Seuil, p. 454
Vertiges, de Jean-Pierre Dupuy, est un essai riche de multiples questionnements, auxquels l'auteur répond en s'appuyant sur l’œuvre de Borges, qui l'a accompagnée toute sa vie. Dans un entretien passionnant qu'il a accordé au site Le Grand Continent, il en donne une liste non exhaustive : "Il y a des questions aussi diverses que le Carnaval brésilien et les paniques financières, la catastrophe de Tchernobyl, les élections présidentielles américaines, l’arme et la guerre nucléaires, la mort, la violence et le sacré, l’antisémitisme chrétien, le nouveau roman et la nature de la littérature et, surtout, omniprésent, lancinant, le grand mystère du temps qui ne peut s’approcher que par une démarche où abondent les paradoxes." Le grand mystère du temps. C'est bien cela qui me taraude ces jours-ci, lors de l'examen des motifs débusqués dans la lecture. L'attention portée à Blaise Pascal a fait resurgir Giordano Bruno et le projet Manhattan avec la bombe-test de Trinity. Le feu du bûcher qui emporta le génial Italien sur le Campo de Fiori le 17 février 1600 et le feu nucléaire du 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique, où Robert Oppenheimer se souvint d'un verset de la Bhagavad-Gita : « Si dans le ciel se levait tout à coup la Lumière de mille soleils, elle serait comparable à la splendeur de ce Dieu magnanime…"
Car ce n'est pas la première fois que Le Trinity monument, l'obélisque de lave de 3,7 mètres, marquant depuis 1965 l'emplacement de l'hypocentre de l'explosion, se retrouve associé au philosophe de la pluralité des mondes. Un article du 5 avril 2020 en témoigne, dont le titre, Sur le sentier confus et magnétique des ânes et des poètes, est emprunté au poème de Roberto Bolaño dont je donne ici le début.
J'avais acheté Le Banquet des Cendres en revenant de Grenade, le 8 février 2019. J'avais un peu de temps avant de reprendre mon train pour Châteauroux, alors j'avais quitté le RER à Saint-Michel pour me rendre à pied jusqu'à Austerlitz. Sans l'avoir aucunement programmé, j'étais passé par la rue Linné, où Georges Perec a vécu ses dernières années, au numéro 13. Deux numéros plus loin, au 17, se trouve la librairie des éditions Sillage. Je n'étais jamais venu là. Je vis en devanture ce livre de Giordano Bruno. Bruno qui ne m'était pas inconnu, grâce surtout à la lecture de L'art de la mémoire de Frances A. Yates.
L'horizon négatif, de Paul Virilio, fut acheté par Nunki Bartt dans la même librairie Sillage. Il raconta l'anecdote dans un mail adressé au Doc et à moi-même :
"Moi je peux t'en parler de la librairie "Sillage" Doc, puisque j'y suis passé il y a un an presque jour pour jour. Je rentrais de mon exposition au Grand Palais, ma toile sous le bras (c'était pas encore Knok le Zout ) en compagnie de G...(...). Le brave homme m'avait hébergé pour la nuit et m'avait également offert le couvert et le gorgeon. Le lendemain matin, après une longue marche de la rue Brezin (14ème), jusqu'à Austerlitz (5ème), je lui demandais:
- Hé, Baron !( son nom de guerre) Hé, baron! lui dis-je, j'ai une petite heure à perdre avant le départ, je te paye un café quelque part ?
C'est ainsi que le Baron et Bibi avons traversé le jardin des plantes, allègrement (moi, toujours avec ma croûte sous le bras (Knok le Zout n'est plus si loin), et sommes sortis dans la rue Linné, si chère à Perec, au cours de laquelle, sans difficulté, nous avons dégoté un bistrot, un bon bistrot parisien, bien entretenu sans être labellisé "lounge". Et tenez-vous bien ! Qu'y avait-il de l'autre côté de la rue Linné ? Une librairie, une librairie que mon Baron, obsédé par l'objet "livre", la truffe encore chaude, tel un Saint-Hubert trop longtemps confiné, s'empressait de fouiller. (...) Imaginez-moi rentrer dans une librairie de taille plutôt modeste, avec une toile d'une bonne taille au repos, non de dieu.
J'en viens à la chute. Alors que mon Baron faisait une razzia boulimique de bouquins, qui vous aurait laissé tous les deux sur le flanc (position confortable pour Linné pour une bonne vivisection), je faisais quant à moi la fine bouche dans cette "bouquinerie" où régnait un véritable capharnaüm (...) quant, tout à coup, au détour d'une table envirussée de volumes, je tombais sur un ouvrage de Paul Virilio, dit le "furtif", intitulé magiquement "L'horizon négatif". (...) "
J'avais écrit peu avant, le 23 mars 2020, un article mentionnant Paul Virilio, et Nunki m'avait apporté (c'était en temps de confinement) son volume. Et j'avais été immédiatement frappé par des coïncidences : "Le triangle évidemment s'impose de lui-même. La stèle de la couverture du Virilio représentant le monument érigé sur les lieux de la première explosion nucléaire, l'essai atomique Trinity du 16 juillet 1945, sur la base de White Sands dans le Nouveau-Mexique, fait écho au triangle aux fines lignes rouges, même inachevé, du livre de Bruno.
Mais ce n'est pas tout : à mi-hauteur des deux triangles, que voyons-nous ? un carré dans les deux cas. Le carré dans le triangle."
Cinq ans plus tard, resurgit donc ce binôme Bruno-Trinity. Avec cette question : cette boucle temporelle a-t-elle un sens ? Et, à vrai dire, je n'en sais rien. Je constate, c'est tout, j'enregistre. On pourra toujours dire bien sûr que ce rapprochement est aussi fortuit que la première fois. Peut-être.
Je voudrais tout de même ajouter quelque chose. Le 1er avril 2020, j'avais reçu un livre d'un certain Jacques Bonnet, A l'enseigne de l'amitié (Liana Levi, 2002). Il me semble que c'était le Doc qui me l'avait recommandé.
Originalité du roman : il s'agit d'un polar se déroulant à Paris en décembre 1582, deux inconnus pénètrent chez Nicolas Heucqueville, riche libraire parisien, et massacrent la famille entière : lui, son père, son épouse, ses deux fils, son nouveau-né et leur bonne. Non loin de là, Rue de Latran habite Giordano Bruno, de passage dans la capitale, et voilà notre philosophe qui se pique d'enquêter sur cette tuerie, aidé du jeune narrateur, Jean Hennequin, en collaboration plus ou moins étroite avec Dagron, le lieutenant de police. Le 22 mai 2003, Philippe Lançon rend compte du livre dans Libération, un article ma foi assez élogieux intitulé Giordano brio. Il souligne la malignité de l'auteur, qui commence tout d'abord par placer son intrigue en un temps absent : "En 1582, une bulle du pape Grégoire XIII remplace le calendrier julien par le calendrier grégorien : le 15 octobre succède à Rome au 4 octobre. Dans la France catholique d'Henri III, ce changement s'effectue en décembre et provoque un certain désordre : dix jours n'auront jamais existé. Jacques Bonnet place son premier roman, une enquête menée par le philosophe Giordano Bruno sur un fait divers sanglant, pendant ces journées absentes : du 10 au 19 décembre. Il occupe, librement et sans le révéler dans son livre, en truite espiègle et narrative, un trou de l'Histoire."
Le temps est décidément au cœur de notre affaire.
Autre supercherie du livre dévoilée par Lançon : le fait divers est soi-disant tiré d'un passage des Registres-Journaux de Pierre de L'Estoile : "Cet audiencier à la chancellerie du Parlement, célèbre mémorialiste de l'époque, dressa son herbier quotidien des événements de 1574 à 1611. Il est très sûr lorsqu'il évoque des faits survenus à Paris. Le massacre qu'il rapporte brièvement le 10 décembre se déroule justement à Paris. Le texte est précis. Mais il est faux : Bonnet l'a inventé. A l'enseigne de l'amitié est une œuvre gigogne, semée de faux documents d'époque et de petits pièges pour érudits."
Dans le prologue, l'auteur affirme avoir trouvé le manuscrit de Jean Hennequin dans une vieille édition originale du Candelaio de Giordano Bruno acheté en 1972 pendant ses études parisiennes. Encore une fois, tout est faux, mais on peut s'y méprendre tant tout semble vrai, comme le signale Philippe Lançon.
_frontespizio.jpg) |
| Le Candelaio est une comédie philosophico-satirique de Giordano Bruno, éditée à Paris en 1582, à l'Enseigne de l'Amitié |
J'ai donc lu ce livre en 2020 (et relu entièrement ces jours-ci), et pourtant je n'en ai jamais parlé ici. J'ai retrouvé cette note dans mon cahier vert de l'époque, à la date du 3 avril : "Fini hier soir le roman de Jacques Bonnet. Un peu déçu. Et pourtant c'est un livre intéressant en beaucoup de points. Mais ne se sont pas produites ces épiphanies de lecture qui me saisissent parfois. J'ai relevé cependant certains signaux." Je n'ai pas développé alors la nature de ces signaux, et il est trop tard pour le faire.
Je voudrais juste citer deux passages de l'épître liminaire que Bruno adresse au très illustre Seigneur de Mauvissière, ambassadeur de France en Angleterre (Le Banquet des Cendres est publié à Londres en 1584).
Point de nectar, Monseigneur, dans le banquet que je vous offre ici : il n'a pas la majesté du banquet de Jupiter tonnant. Ni les effets, désastreux pour l'humanité, du repas de nos premiers parents [...] ; ni la philosophie du banquet de Platon, ni la misère du repas de Diogène. Ce n'est pas une bagatelle, comme le banquet des sangsues ; [...] ni une comédie, comme le banquet de Bonifacio dans le Candelaio. [...]
Quel symposium, quel banquet est-ce là, me demanderez-vous ? C'est un souper. Quel souper ? Un souper des Cendres. Que veut dire souper des Cendres ? Vous aurait-on servi pareille pitance ? Pourra-t-on dire à cette occasion : cinarem tamquam panem manducabam ? Nullement ; il s'agit d'un banquet qui a réuni les convives après le coucher du soleil, en ce premier jour de carême que nos prêtres appellent dies cinerum, ou parfois jour du memento.
Memento fait référence au verset de la Genèse (Gn 3,19) que le prêtre prononce après avoir tracé une croix de cendre sur le front des fidèles : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » (en latin : Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris).
Dernière remarque : Philippe Lançon écrit en 2003 que "Jacques Bonnet a traduit Norbert Elias, écrit un livre sur le peintre renaissant Lorenzo Lotto, travaillé dans l'édition. Il vit désormais dans la Creuse à Sainte-Sévère, le village où Tati tourna Jour de fête". Faisant juste une petite erreur : Sainte-Sévère est dans l'Indre, non dans la Creuse. Village où je me suis rendu cent fois, comme en témoigne cette petite chronique du 20 janvier 2011, dite du Nomade pédagogique :
Peu à peu tu t'es déshabitué du fracas des cantines. La pause de midi, tu l'as ancrée de plus en plus dans la solitude.
Tu as ainsi constitué au fil des ans une famille d'endroits discrets, plutôt que secrets, où déjeuner avec la seule rumeur des eaux ou des oiseaux, lire le journal ou écouter la radio.
L'un de ces endroits est à Sainte-Sévère, en-deça de la place où Tati tourna Jour de fête. Une porte donne sur un parc dominant la vallée de l'Indre, la mousse et la ronce y colonisent d'antiques balustrades.
Jamais personne. Même aujourd'hui, avec 0°, c'est là que tu as aimé être.
Chronique précédée de cette citation de Julien Gracq, où le vertige est présent :
"Rarement je pense au Cézallier, à l'Aubrac, sans que s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir : sur ces hauts plateaux déployés où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre à tomber, m'incite à y courir, à m'y rouler, à perdre de vue, à perdre haleine."
Julien Gracq, Carnets du grand chemin, José Corti, 1992, p. 64.